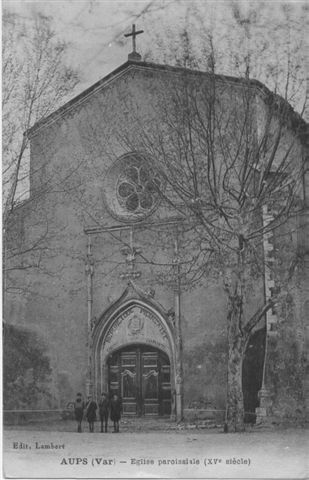Notes et souvenirs sur Aups
Publié en feuilleton en 1890 par le journal réactionnaire dracénois L’Indépendant du Var, ce texte a en fait été écrit en septembre 1881, quelques semaines après l’inauguration, le 31 juillet, du monument à la mémoire des citoyens tombés à Aups pour la défense de la Constitution. Son auteur, Pierre-Germain Escolle, est un avocat et notaire aupsois, né le 1er mai 1827 à Correns, membre d’une famille de riches propriétaires de la région. Dans son ouvrage sur la résistance varoise[1], Noël Blache lui prête un rôle dans une tentative de médiation entre le préfet Pastoureau et les républicains le 9 décembre. Élu conseiller général du canton d’Aups en juillet 1889, il devient maire de la ville en 1896. Connu sous la Seconde République pour ses opinions légitimistes, les services préfectoraux le classent parmi les royalistes en 1889 et les ralliés en 1896.
Ce texte est donc un spécimen unique d’une vision légitimiste des années 1880 de la résistance varoise au coup d’Etat du 2 décembre 1851.
Sauf mention contraire, les notes ont été établies par nos soins afin de renvoyer le lecteur aux études publiées sur les faits relatés par Pierre Escolle.
L’Indépendant du Var, 6 juillet au 14 septembre 1890
Notes et souvenirs sur l’insurrection de 1851 à Aups (Var) par Pierre Escolle troisième partie
Après la déroute. – Préfet Pastoureau et Capitaine Houlez. – Panique. – 2e exécution de Martin Bidouret.
Pendant que la troupe opérait ainsi du côté des Aires et dans la plaine d’Uchanne, au nord et au sud de la ville, les soldats qui avaient délivré les otages à l’hôtel Crouzet, se livraient à des perquisitions dans cet hôtel et dans les maisons voisines, et faisaient de nombreux prisonniers. Ceux-ci enfermés pêle-mêle dans une petite pièce dépendante de la justice de paix, passèrent ensuite par les mains d’un gendarme qui les ligotait.
Une digression à ce sujet. M. Maquan a raconté qu’un gendarme prisonnier des insurgés avait eu un œil arraché à l’aide d’un clou. M. Blache traite de fable ce récit, et d’autres historiens n’hésitent pas de crier à la calomnie. Je ne veux et ne puis prendre aucun parti dans cette question, m’étant imposé l’obligation de ne raconter que ce que j’ai vu autour de moi-même, ou ce que j’ai appris par des témoins très honorables, mais je certifie que l’un des premiers otages qui sortit de l’hôtel de ville fut un gendarme ayant un bandeau sur l’œil, que ce gendarme, dans le paroxysme de la fureur, me demanda un fusil, un sabre, un bâton, une arme quelconque pour assommer, disait-il, les misérables insurgés qui l’avaient maltraité… Je certifie qu’une heure après, j’ai revu ce même gendarme sans armes, mais occupé à attacher les prisonniers que l’on extrayait de la salle de la justice de paix. Je ne sais s’il avait perdu un œil, mais je constate que ce soldat paraissait profondément irrité contre les insurgés, et ne gardait envers eux aucun ménagement.
(à suivre)
Les perquisitions dans les maisons voisines de l’hôtel Crouzet étaient faites par des soldats, la baïonnette au bout du fusil précédés par un sergent porteur d’une lanterne. On fouillait partout, sondant avec la baïonnette, furetant tous les coins et recoins. Je me souviens qu’on trouva ainsi trois hommes collés contre la meule d’un moulin à tan, et autant dans un grenier à fourrage.
Le sergent faillit même faire un mauvais parti à mon père. Sur l’ordre d’ouvrir sa maison, mon père déclara sur l’honneur, qu’il l’avait quittée fermée au moment de l’arrivée de la troupe, et qu’il était sûr que pas un insurgé ne s’y trouvait. Le sergent insista, et que l’on juge de la stupéfaction de tous, lorsqu’on trouva deux hommes à cheval l’un sur l’autre dans un étroit passage connu sous le nom de troumblo servant à faire passer le fourrage du grenier à l’écurie.
Ces hommes surpris dans l’hôtel Crouzet, s’étaient enfuis par les toits et s’étaient glissés par la toiture dans notre maison dans le grenier à fourrage et de là, dans la troumblo, le sergent furieux faillit nous arrêter en même temps que les deux hommes.
Ce fut aussi dans le cours de ces perquisitions, que les soldats trouvèrent cachés sous un lit de l’hôtel Crouzet, Isoard, le président de la commission municipale. Quelqu’un ayant laissé échapper qu’Isoard était un chef de l’insurrection, deux soldats conduisirent le malheureux au préfet et aux autorités militaires stationnant au milieu de l’Esplanade.
La cause fut vite entendue, et ordre fut donné de fusiller le prisonnier. Vainement, le juge de paix insista pour faire relâcher celui-ci. Le préfet hors de lui fut jusqu’à menacer du même sort le juge de paix.
Je venais de quitter mon père, à la suite de la perquisition opérée chez nous, lorsque je me trouvais face à face avec Isoard conduit à la mort : « Venez à mon secours, me dit le pauvre diable. On dit que je suis un chef, et on va me fusiller ; vous savez bien que je n’ai pas fait le mal. Sauvez-moi… »
Je racontai immédiatement au préfet ce qu’avait fait Isoard pendant la dernière nuit, et ce que nous étions en droit d’attendre de lui, et répondant de son honneur, je fus assez heureux pour obtenir l’ordre de le remettre en liberté.
Moins heureux furent la plupart des 80 citoyens arrêtés et enfermés dans la salle de la justice de paix.
Tous ces prisonniers solidement attachés furent alignés deux par deux sur le perron de l’hôtel de ville. Parmi eux figuraient quelques habitants d’Aups fort inoffensifs. Sur leurs justes réclamations appuyées par d’honorables témoignages, ils furent relâchés, ne laissant dans les rangs que ceux qui, étant complètement inconnus, ne pouvaient fournir aucune référence. Après avoir parcouru les rangs de ces hommes, le capitaine Houlez[1] s’approcha du préfet, M. Pastoureau, avec lequel je m’entretenais du chef de la commission, M. Isoard, que je venais de faire mettre en liberté, et lui demanda brusquement où il pouvait faire fusiller les prisonniers saisis les armes à la main et tombant sous le coup de la loi martiale. – Il fallait les fusiller quand vous les avez saisis les armes à la main, répondit M. Pastoureau. En ce moment, ils appartiennent à la justice qui prononcera !!
Je n’ai vu M. Pastoureau que ce jour, 10 décembre 1851. Je fus même, je l’avoue, fort irrité contre lui, lorsque immédiatement après cette scène, et malgré mes protestations, il donna l’ordre de désarmer tous les habitants d’Aups, et de partir pour Salernes, en emportant toutes les armes que les insurgés nous avaient involontairement laissées ; mais je dois lui rendre cette justice que si l’on a pas à déplorer des malheurs plus grands, c’est à sa résistance aux ordres militaires basés sur l’état de siège qu’on le doit.
Comment donc concilier cette conduite avec celle qu’on lui prête dans l’affaire Martin Bidouret, dont je vais bientôt raconter les derniers et pénibles incidents.
En attendant, je dois faire justice d’une allégation de mon honorable ami M. Blache tendant à faire croire que la troupe chantait insolemment victoire.
« La fusillade cessait à peine dans la plaine d’Uchanne, écrit M. Blache, quand retentit tout à coup un feu de peloton.. Les prisonniers venaient-ils d’être fusillés par les soldats ? chacun le crut… Cette fusillade, dont les insurgés survivants ont gardé un effrayant souvenir, fut, assure-t-on, une sorte de bravade des soldats, heureux de la facile défaite des républicains… »
Eh bien ! non, les soldats ne firent point de bravade. Les détonations répétées qui ont effrayé les insurgés… au loin, causèrent à Aups même, une panique extrême. Elles ne provenaient pourtant que des précautions prises par les soldats et les habitants de la ville de décharger en les tirant les armes qu’ils avaient encore ou qui jonchaient le sol après la fuite des insurgés. A certains moments ces détonations furent si fréquentes que l’on crut à un retour offensif des insurgés, et que ceux qui étaient enfermés dans les maisons aussi bien que ceux qui se trouvaient dans les rues, perdant la tête se sauvèrent dans les champs en criant : « les voici, sauvez-vous !… »
(à suivre)
Avec quelques honorables citoyens, j’étais en ce moment occupé à relever les morts. Nous avions dépassé l’homme à la jambe de bois, lorsque ce cri nous frappa. Nous revînmes en toute hâte sur l’esplanade du cours où nous ne trouvâmes personne. Un silence lugubre régnait dans la ville complètement déserte. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous avaient fui. On parle encore d’une femme enceinte qui, sautant d’un premier étage, se sauva à travers champs, d’un vieillard qui, habitué à ne pas sortir de la ville, courut toute la nuit à travers bois… et de bien d’autres qui ne craignirent pas d’aller pendant 6 ou 8 heures droit devant eux, croyant avoir tous les insurgés à leurs trousses.
Au reste, la population toute entière était prédisposée à cette panique par une terreur inexprimable, causée de puis trois jours par les publications sauvages, les perquisitions, les réquisitions, et le roulement de la fusillade à l’arrivée de la troupe. Pour en donner une idée je citerai un exemple :
Lorsque après la déroute, quelques hommes de cœur eurent la pensée d’aller visiter les champs de bataille pour relever les morts et sauver les blessés, je courus faire appel au concours de quelques citoyens groupés devant l’église et le café du Cours, et que quelques heures auparavant j’avais vu en armes dans les rangs des insurgés. Je ne pus rien obtenir. En vain, je leur parlai de la possibilité de sauver quelques blessés ; en vain, j’essayai de faire vibrer les cordes de l’humanité la plus ordinaire, il faut avouer que je fus bien peu éloquent, et que les sentiments républicains étaient bien morts en ces hommes, car je ne pus détacher du groupe un seul individu ; je dus donc venir tristement annoncer l’insuccès de ma mission à ceux qui préparaient les attelages dans les remises de l’hôtel Crouzet. On était atterré ! on ne sentait plus rien !
Le lendemain, jeudi 11, on reprit les recherches interrompues la veille par la panique, et l’on transporta à l’hôpital les 18 cadavres relevés percés de coups. Chose étrange ! les actes de l’état civil à Aups, sont complètement muets sur les noms de ces victimes de la guerre civile.
On les connaît pourtant. Ce sont :
Aymard[2], Bonnet François[3], Bonnet[4] Cristian[5], Emeric[6], Ganzin[7], Jourdan[8], Martin[9], Maurel[10], Henri[11], et Villeclère[12], du Luc.
Aymard[13], du Muy.
Dufort[14], de Brignoles.
Félix[15], de Bargemon.
Ferlandy[16], de Salernes.
Motus[17], de Vidauban.
Bienvenu[18], dit la Jambe de bois, de Lyon.
A ces 17 cadavres, que nous avons vu étendus sous le hangar de l’hospice, il faut ajouter :
Aragon[19] et Imbert[20], du Muy ; Coulet[21], des Arcs ; Cayol[22], de Vidauban, tous quatre fusillés à Lorgues.
Jassaud[23], du Luc, que M. Blache, dans son histoire, dit avoir été tué près du pont de l’Argens par les volontaires Lorguiens, sans pourtant se rendre garant de l’exactitude du fait.
Laborde[24], du Luc, blessé à Aups, et décédé au Luc.
Féraud[25] de Salernes, trouvé mort dans le quartier de l’Amendeireto, près Sillans, que les uns prétendent avoir été assassiné par un gendarme ; et les autres par des insurgés dont il ne partageait pas les idées.
Et enfin, Martin dit Bidouret[26], de Barjols, dont il me reste à raconter la deuxième exécution.
En tout vingt-cinq morts.
On le voit, il y a loin de ce chiffre (toujours trop fort, hélas !) au chiffre accusé par tous ceux qui ont écrit l’histoire de ces journées néfastes. Mal renseignés sur la force, la position et les intentions de l’armée insurrectionnelle, le préfet, M. Pastoureau, et le colonel Trauers, après la déroute des insurgés, s’étaient empressés d’évacuer la ville d’Aups, se dirigeant sur Salernes. Le lendemain, une compagnie commandée par le capitaine Erard était revenue, par ordre, occuper notre petite ville. Tout semblait fini, lorsque Martin Bidouret fit son entrée dans notre hôpital.
Martin ,laissé pour mort sur la route de Tourtour, n’était qu’étourdi. Quand le dernier soldat l’eut dépassé, il se releva et se réfugia dans la ferme dépendant du château de la Baume, où il fut accueilli et soigné par le fermier. Mais celui-ci, craignant d’être compromis, fut, le soir même, aviser le maire de Tourtour de ce qui se passait chez lui. Un ou deux jours après, l’émissaire de Duteil était saisi et emporté dans une charrette à l’hôpital d’Aups.
On a dit d’abord que la présence de ce malheureux à la Baume avait été dénoncé par M. de la Baume lui-même. Erreur, le propriétaire était alors à Draguignan avec sa famille. On sait aujourd’hui, qu’après le 4 septembre 1870, l’on a trouvé à la préfecture de Draguignan des lettres, ne laissant aucun doute sur la participation de M. de la Baume à ces événements : et M. A. Gariel lui-même, l’un des proscrits de 1851, reconnaît dans sa brochure[27], que c’est à une lettre du maire de Tourtour, adressée au préfet, que l’on doit faire remonter la responsabilité de la dénonciation. M. Gariel ajoute ensuite que Martin Bidouret fut transporté à Aups « mourant et garrotté pendant 48 heures dans un lit d’hôpital, malgré ses blessures qui le rendaient impuissant à se mouvoir… »
(à suivre)
Et M. Blache répète ainsi qu’il suit, un récit que lui a fait sœur Sainte-Philomène, religieuse dudit hôpital.
« Bidouret avait à la jambe une blessure causée par un coup de sabre ; il portait derrière l’oreille une éraflure produite par une balle. Il pria doucement la religieuse de le panser. Cette dernière, avec un soin évangélique, s’empressa de le soigner. En ce moment, sans doute, l’autorité fut avertie de l’arrivée de l’insurgé : le pansement était à peine fini que deux gendarmes et quatre soldats se présentèrent à l’hôpital. Sur leur réquisition, la supérieure les conduisit auprès de Martin… les soldats furent placés en sentinelle à la porte de la salle. Les deux gendarmes s’approchèrent de Bidouret, et lui lièrent, avec des cordes, les poignets et les chevilles… » Eh bien ! n’en déplaise à M. Gariel, M. Blache à la religieuse, dont les souvenirs en 1869 sont précis, dit-on, sur ces points là, n’est point encore la vérité.
Elle n’est pas non plus dans la narration suivante, écrite par M. Granier de Cassagnac[28], et basée sur une lettre du capitaine Erard, commandant la compagnie du 50e restée à Aups, et qui fit exécuter Martin, lettre datée du 31 janvier 1878, publiée dans le journal de Bordeaux du 8 avril suivant :
« Cependant l’insurgé laissé pour mort le matin au bord de la route, n’était que blessé. Relevé par des habitants et porté à l’hospice d’Aups, les malades et les sœurs firent les plus grandes difficultés pour l’admettre, parce qu’on venait de reconnaître en lui un exalté démagogue, qui avait fait régner la terreur dans le pays.
Informé de cette résistance, le capitaine Erard, laissé à Aups pour garder la ville, le plaça sous la protection d’un gendarme et d’un soldat.
D’un autre côté, les instructions du colonel Trauers ordonnaient au capitaine Erard de faire rechercher activement l’homme laissé pour mort sur la route, sectaire de la pire espèce, qu’on nommait Martin Bidouret, et de tout faire pour s’emparer de lui. Or, la résistance des sœurs et des malades lui apprirent que le blessé porté à l’hôpital était précisément l’homme qu’il cherchait.
Isolé à Aups, entouré d’insurgés qui interrompaient les communications, sans rapport avec le colonel ou avec le préfet, le capitaine Erard réfléchissait sur sa capture fortuitement opérée, lorsque dans la nuit du 13 au 14, le maire de la ville vint lui exprimer les profondes inquiétudes que la présence de Martin Bidouret, même blessé, inspirait à la population. Il lui représenta que les insurgés, reformés de nouveau, allaient se ruer sur la ville pour délivrer leur complice, et il ne doutait pas que cette invasion imminente n’amènerait de nouvelles et plus graves atrocités. Au nom des alarmes de la ville entière, le maire d’Aups requit le capitaine Erard de les conjurer à tout prix.
Celui-ci avait reçu de son colonel les instructions les plus précises et les pouvoirs les plus étendus, dérivant de l’état de siège, à l’égard d’un insurgé pris les armes à la main. Il devait, pour maintenir la tranquillité et la sécurité des habitants, user de toute son énergie, ne reculer devant aucun obstacle, et décider du sort de Martin Bidouret, s’il parvenait à le saisir, comme d’un homme de la plus dangereuse espèce. En ces circonstances, le capitaine Erard jugea qu’il pouvait et devait faire passer son prisonnier par les armes. Martin Bidouret fut fusillé le 14 au matin.
Le prêtre qui venait de recevoir sa confession lui dit, en lui livrant ce malheureux : « Capitaine, il avoue qu’il a mérité son sort. »
Dans M. Gariel comme dans M. Blache, dans M. Granier de Cassagnac, comme dans la lettre du capitaine Erard, presque autant d’erreurs que de mots ! Au nom de l’humanité, je proteste contre les récits tendant à faire croire que Martin mourant a été garrotté et gardé à vue par 4 soldats et 2 gendarmes. Au nom de la ville d’Aups, je proteste contre le récit du capitaine Erard et les commentaires de M. de Cassagnac faisant retomber sur le maire et ses administrés la responsabilité de la deuxième exécution de Martin.
Voici la vérité :
A son entré à l’hôpital, Martin Bidouret fut reçu par les sœurs, le docteur Jean et un administrateur, M. Boyer, notaire. Il fut panser par le docteur. Ses blessures étaient sans gravité. L’une au mollet causée par un coup de sabre divisant l’épiderme seulement et mesurant 3 ou 4 centimètres, l’autre, très légère, à l’oreille.
Deux soldats furent mis à la porte de la salle par le capitaine Erard, qui manifestait dès lors la pensée de faire fusiller Martin ; mais il est faux que des gendarmes l’aient garrotté. Il n’y avait du reste à Aups, en ce moment, que le brigadier Boniface, autorisé à rester auprès de sa femme mourante, toute la brigade ayant suivi la colonne et les autorités. Martin ne fut pas le moins du monde torturé, et la supérieure, alors malade et gardant le lit, ou toute autre sœur religieuse n’eut pas à protester contre des atrocités qui ne furent point commises. Martin Bidouret se confessa, ne prononça pas un mot, ne fit ses adieux à personne, et chose triste à dire, fut traîné, demi mort de peur, sur le lieu de l’exécution, à quelques pas de l’hospice.
(à suivre)
L’autorité militaire seule doit être responsable de cette mort. Le capitaine Erard obéissait peut-être à des instructions verbales de ses chefs, il exécutait à coup sûr les ordres donnés en suite de la déclaration de l’état de siège, comme le capitaine Houlez se montrait décidé à s’y conformer rigoureusement quand il demandait en ma présence au préfet : « Où il pouvait faire fusiller les prisonniers.. » et il n’est pas besoin de chercher d’autres responsabilités. D’après M. Blache, les soldats auraient rougi du rôle qu’on leur faisait jouer. Ceux qui ont tiré sur Martin auraient même jeté leurs armes avec dégoût. Il n’en est rien ! J’ai entendu moi-même le lendemain de l’exécution, un des soldats qui y avaient assisté se glorifier d’avoir logé une balle dans la tête de l’infortuné émissaire.
Quant à la population, complètement étrangère à ce drame, elle ne l’apprit que par le bruit des coups de feu, quelques enfants seuls y ayant assisté ; et il est faux de dire qu’elle avait demandé par l’intermédiaire de son maire, à être délivrée à tout prix des inquiétudes que la présence de Martin lui inspirait. Il n’est pas moins faux de soutenir qu’elle apprit cette exécution avec consternation. Effrayée par les scènes de violence dont elle avait été témoin, elle ne manifesta ni joie, ni douleur sur le moment. Elle fut indifférente, la force lui manquant pour sortir de sa léthargie.
Telle est la vérité sur les faits qui se sont déroulés à Aups en décembre 1851. J’ai dit impartialement ce que j’ai vu et ce que j’ai entendu moi-même, et si j’ai raconté quelques épisodes auxquels je n’ai pas assisté, c’est que, je le répète, je les tenais de témoins irréprochables à tous les points de vue.
Le lecteur peut aujourd’hui juger en parfaite connaissance de cause. Je crois avoir compléter le dossier de l’affaire de décembre 1851 à Aups.
Y a-t-il eu héroïsme, lâcheté, brigandage ? – Catégories d’insurgés.
En tête de cette narration, j’aurais dû placer pour épigraphe une phrase prise dans le discours que M. Gambetta a prononcé au Neubourg, le 4 septembre 1881.
« Les statues que l’on élèverait à ceux qui ne les auraient pas méritées ni par la grandeur d’âme, ni par les services rendus, ne seraient que le signe de la décadence d’un grand peuple, qui se donnerait le stérile plaisir d’avoir des grands hommes sans avoir de grands justes… »
Je me suis demandé en lisant ce discours, si M. Gambetta, qui avait connaissance de la fête du 31 juillet à Aups, n’avait pas, dans cette phrase, visé cette fête dont il jugeait l’inopportunité. Dans tous les cas, on ne risque rien d’appliquer le jugement du puissant tribun à la pensée qui a malencontreusement dirigé l’érection à Aups d’un monument en l’honneur des insurgés du Var en 1851.
Ces insurgés par leur héroïsme, par leur grandeur d’âme, par les services rendus, méritent-ils la glorification dont ils viennent d’être l’objet, les honneurs qu’on leur a rendus ?
Ou bien méritent-ils les épithètes de brigands et de lâches, dont on les a abreuvés pendant près de trente ans ?
Je n’hésite pas à le dire : les insurgés que nous avons vus à Aups, en 1851, ne méritent ni cet excès d’honneur, ni cette indignité. Et je le prouve :
Pour les historiens républicains : MM. Ténot, Blache, Gariel et autres, ces insurgés sont des héros. Il en est de même pour la presse républicaine de nos jours, dont un organe imprimait le lendemain de l’inauguration de la pyramide élevée à Aups en leur honneur : « que le département tout entier était venu témoigner de son admiration pour les hommes vaillants et héroïques qui, impuissants à empêcher le crime, luttèrent contre lui jusqu’à la mort… ; »
Pour M. le Préfet, M. A. Rey, qui dans son discours, lors de la fête, va jusqu’à dire :
« Vous savez tous quel a été l’héroïsme, quel a été le dévouement, quelles ont été les cruautés de la victoire, quelles ont été aussi les gloires de la défaite… ; »
Pour ceux qui annonçaient dans leurs journaux le programme de la fête du 31 juillet ne craignaient pas d’écrire :
« Le département tout entier est convié à cette tragique fête, où les souvenirs les plus douloureux s’uniront aux élans de la reconnaissance populaire, où les triomphateurs seront traînés aux gémonies de l’histoire, et les vaincus rétablis dans la gloire qu’ils ont attendue 30 ans. »
Mais si héroïsme signifie en français : ce qui est propre aux héros, c’est-à-dire comme dit Littré, à ceux qui se distinguent par une valeur extraordinaire ou des succès éclatants à la guerre, ou à ceux qui se distinguent par la force de caractère, la grandeur d’âme, une haute vertu, comment peut-on justifier, dans l’espèce, l’application que l’on fait de ce mot ?
On sait, en effet, qu’Arrambide et sa compagnie, forte de 7 à 800 hommes, ont pris honteusement la fuite à la vue du premier soldat, et sans tirer un coup de fusil.
Que Duteil et son armée toute entière, et quoique dans une position inexpugnable, se sont débandés sans attendre le choc de la troupe régulière dix fois moins nombreuse.
(à suivre)
Que la compagnie envoyée à Vérignon, que celle sous la conduite de M. Cotte, envoyée au pont d’Aiguines, ont abandonné armes et chevaux au premier coup de feu entendu à plusieurs kilomètres de distance.
Qu’à Fox-Amphoux le commandant de la compagnie occupant ce village par ordre de Duteil a été arrêté et conduit au chef-lieu par un pauvre infirme, le maître d’école.
Et que les malheureux qui ont été frappés, sauf le citoyen à la jambe de bois, et la compagnie de la Garde-Freinet, complètement à l’abri derrière les oliviers, n’ont fait aucune résistance.
Ces insurgés ont eu vraiment des élans d’héroïsme qu’à Salernes, lorsque Duteil envoya une compagnie à l’assaut d’une montagne sur laquelle on arrêta deux chasseurs inoffensifs ; et lorsque, sur une fausse alerte donnée par M. Dauphin[29], pendant la nuit, près de 2500 hommes, quittant leurs lits, volèrent au combat sans chapeau et sans veste, ainsi que se plait à le constater M. Blache.
En dehors de ces deux faits, où est l’héroïsme ?
Est-on mieux venu d’accuser de brigandage et de lâcheté la majorité des hommes campés à Aups ? Je ne le pense pas.
Cette armée insurrectionnelle se composait d’éléments fort hétérogènes, ne pouvant former corps ensemble, et devant, au premier choc, se séparer brusquement.
Des 6000 hommes qui se trouvaient à Aups, les uns, formant une phalange peu nombreuse, je le reconnais sans aucune espèce de foi politique, pouvaient être considérés comme très dangereux. Opprobe de tous les partis, ces gens-là déshonoraient tout drapeau qui voudrait les couvrir.
Les autres un peu plus nombreux, s’occupant de questions politiques, mais les comprenant peu ou mal pour la plupart, croyaient en se levant sauver la République en danger, et conquérir des droits qu’ils ne savaient définir, étaient de bonne foi. Ils obéissaient au mot d’ordre de quelques meneurs subalternes, tout en étant convaincus que l’insurrection était victorieuse, puisqu’on leur disait que le Prince Président était enfermé à Vincennes, et par suite, ils ne pensaient courir aucun danger sérieux.
Les autres, enfin, formant la très grande majorité, incorporés malgré eux dans les bandes insurrectionnelles, n’avaient quitté leurs foyers que contraints et forcés par les menaces et de sauvages publications.
Et que l’on ne dise pas que j’exagère, mon appréciation est basée sur ce que j’ai vu moi-même. Du reste, que l’on consulte certains auteurs républicains, et entr’autres Ch. Dupont[30], ancien conseiller général des Bouches-du-Rhône, l’une des victimes du coup d’Etat, et l’on sera convaincu :
« On avait eu tort, en effet, dit M. Dupont dans sa brochure, les Républicains et les Monarchistes dans le Var en décembre 1851, dans plusieurs communes d’enrôler, malgré eux, les indifférents et même les adversaires du parti républicain. Au premier coup de fusil ces hommes devaient être les premiers à pousser les cris d’alarme et par conséquent à paralyser le courage des citoyens dévoués… »
Les deux premières catégories de ces hommes, j’en conviens, auraient pu et dû résister, mais leur foi républicaine n’était pas robuste, et leur conduite a frisé la lâcheté plutôt que l’héroïsme, mais ils n’étaien,t qu’une petite minorité. Quant à troisième catégorie, peut-on, en conscience, lui reprocher d’avoir lâché pied devant les soldats dont ils bénissaient l’arrivée qu’ils regardaient comme une délivrance ?
Il serait donc bien injuste de dire, en généralisant, que l’armée insurrectionnelle a fui lâchement toute entière.
Il n’y a eu de fuite honteuse que pour ceux qui connaissant la situation, ont poussé les ignorants à prendre les armes ; mais la grande masse composant, malgré elle, l’armée insurrectionnelle n’était pas lâche en abandonnant un drapeau qui n’était pas le sien. Les mêmes raisons doivent s’appliquer au reproche de brigandage.
Oui, il a été commis des crimes, on a assassiné, on a procédé à des arrestations arbitraires, crimes contre lesquels ont protesté, il faut le reconnaître, la plupart des écrivains républicains. On a fait des réquisitions coupables, mais doit-on faire retomber la responsabilité de ces abominations commises par quelques-uns, sur tous ceux qui composaient l’armée insurrectionnelle ? Je ne le crois pas.
A ces hommes il fallait l’oubli ! Il le fallait dans l’intérêt même de la République !
Comme M. Granier de Cassagnac, j’ai toujours cru qu’il n’y avait pas de doctrine politique dans la prise d’armes de 1851. J’ai vécu pendant plus de 24 heures au milieu des insurgés ; j’ai vu et étudié leurs chefs, j’ai lu presque tout ce qui a été publié sur eux, et mon jugement est tel aujourd’hui qu’il y a trente ans.
(à suivre)
Beaucoup d’imprudents, des ambitieux que la gloriole de diriger un groupe avait enivrés, comme le dit M. de Cassagnac, et j’ajouterai pour le département du Var, beaucoup d’ignorants, mais point de question politique, pour les neuf dixièmes des hommes enrôlés.
Et, s’il y a eu des victimes, que la responsabilité en retombe sur ceux qui, par besoin de se ménager une retraite sûre, ont poussé brutalement des masses d’ignorants à un soulèvement à la ruine, à la mort.
Je m’explique :
Par l’abandon sans résistance du drapeau sous lequel ils marchaient, les insurgés ont suffisamment prouvé qu’ils n’obéissaient à aucune pensée politique ; mais à l’appui de cette thèse, je veux apporter aux débats un argument des plus probants.
Dans tous les mouvements, qu’ils s’appellent émeute ou révolution, le peuple est sous la main d’un ou plusieurs hommes qui l’instruisent de ce qu’ils disent être ses droits, le conseillent, le poussent, triomphent ou tombent avec lui. Et, pour me servir des propres termes de M. Casimir Bouis (retour de Nouméa), candidat malheureux dans certaines élections du Var, le premier devoir de tout homme de cœur, c’est de faire lui-même ce qu’il conseille aux autres, c’est de mettre d’accord ses actions avec ses promesses. Or, dans le parti républicain, autant que tout autre, on tient à honneur de défendre ce principe. Eh bien ! que l’on me montre un seul de ces citoyens qui, ayant vraiment mission de conseiller et de conduire en 1851 le parti républicain, se soit levé et mit à la tête des bandes insurrectionnelles du Var ? Quand on voit des hommes de la valeur de M. Pastoret[31], chef incontesté des républicains du Var, de MM. Pascal d’Aix[32], Pellicot[33], Lucien Guigues[34], Barbaroux de Brignoles[35], Achard[36] et Fassy[37], pour ne parler que de notre région septentrionale, non seulement se recueillir, mais pour la plupart, si nous en croyons certains historiens, engager leurs amis à ne point prendre part au mouvement, c’est qu’il y avait en jeu autre chose qu’une doctrine politique.
Aussi, de deux choses l’une : Ou le mouvement dans le Var en 1851 n’a eu d’autre but que de venger la Constitution violée, et alors, les citoyens qui ont été et dont les survivants sont encore considérés comme les chefs, sont des lâches et des traîtres ; ou ces hommes n’ont jamais démérité, et alors pourquoi glorifier ces journées de décembre 1851 ?
Mais, dira-t-on, à défaut des Pastoret, Pellicot, Guigues, Barbaroux et Pascal, les citoyens Duteil, Campdora et Brunet ne peuvent-ils pas compter comme chefs de parti ? Duteil ? On ne sait pas encore aujourd’hui ce qu’il a été. Etait-il vraiment républicain ? Etait-il agent provocateur ? Etait-il traître ? Toutes les hypothèses sont permises. Tour à tour acclamé par l’armée insurrectionnelle, suspect, menacé de mort, provoqué de traître, ce journaliste étranger au département du Var peut-il franchement être considéré comme le chef du parti républicain militant ?
Et Campdora, ce chirurgien attaché à l’aviso le Pingoin, pouvait-il parler et agir au nom d’un département auquel il était aussi étranger que Duteil ? Brave et intelligent, je le veux bien, il rêvait peut-être pendant ses longues heures de traversée, la République de Platon ; la nouvelle de l’insurrection lui fit croire que son rêve allait se réaliser, et désertant son bord il vint se mettre à la disposition de ceux qu’il croyait appelés à sauver la République. Mais quels brisements de cœur, quelles désillusions dût ressentir cet imprudent jeune homme pour que, dans un moment d’abandon, il ait pu dire à Aups à un de ses amis, qui nous l’a répété lui-même :
« Que faire avec un tas de bandits pareils ! » condamnant ainsi le mouvement dans lequel il s’était engagé.
Ce jugement concorde bien avec celui porté par le général Duteil[38] lui-même, dans les lignes suivantes :
« En arrivant à Brignoles, je croyais trouver des républicains, je n’y rencontrai que des pillards… (…) Avant d’arriver à Salernes, j’eus horreur de mon armée, et envie de déserter, pour ne point assumer sur ma tête la responsabilité possible d’une Jacquerie… »
(la fin au prochain numéro)
Je ne sache pas que jusqu’à présent, aucun historien ait aussi énergiquement jugé l’armée insurrectionnelle de 1851, que les deux hommes que cette armée revendiquait comme ses chefs.
Que dirai-je du citoyen Brunet, une mouche du coche, pérorant à Draguignan, pérorant à Aups, pesant sur les municipalités, installant des commissions, réquisitionnant les populations, et rentrant dans l’ombre au moment suprême ?
Non, je le répète, s’il y avait eu en jeu une doctrine politique, nous aurions vu de véritables chefs diriger le mouvement. Et ces chefs ont complètement manqué.
Et cependant, à la tête de ces bandes armées marchaient quelques citoyens qui s’étaient imposés. Pour ceux-là, officiers subalternes, simples comparses, si je puis m’exprimer ainsi, les conseils de prudence émanés d’en haut étaient arrivés trop tard. Ils s’étaient compromis et sous peine de se voir mettre au collet la main d’un gendarme, il fallait marcher. C’est alors qu’ils s’entourèrent de quelques hommes dévoués, et que, payant d’audace, ils furent, de village en village, croissant en nombre par suite de menaces, de réquisitions et de publications insensées. L’objectif de ces chefs était le Piémont et non Draguignan. Parfaitement au courant de ce qui se passait à paris, ils n’en laissaient rien transpirer en dehors de leur petit cercle. Les courriers qu’ils interceptaient ne laissaient aucun doute sur le succès du Coup-d’Etat et la folie de leur entreprise. Ils connaissaient l’arrivée prochaine de la troupe, marchant à leur poursuite, et se savaient perdus sans ressources, s’ils ne parvenaient pas à gagner la frontière. Abusant de l’ignorance de leurs hommes qui leur étaient nécessaires pour masquer et assurer leur retraite, ils disaient hautement que l’insurrection était victorieuse partout, et qu’ils allaient eux-mêmes marcher sur Draguignan, dont ils s’éloignaient pourtant, et ils parvenaient ainsi à empêcher les désertions.
Enfin, comment qualifier cet emprunt de 100000 francs, alors que l’on savait que le colonel Trauers, n’était qu’à quelques kilomètres d’Aups ?
L’armée insurrectionnelle devait-elle profiter de cet argent ? Non, certes, nourrie, vêtue, logée par les réquisitions dans les pays qu’elle traversait, elle ne pensait pas à la solde : mais ces 100000 fr. avaient leur place marquée dans les sacs de certains hommes. Qui donc osera dire qu’il y avait là un sentiment républicain, une idée politique ?
Je me résume :
Abstention complète de tous les vrais chefs du parti républicain, voire même blâme de quelques-uns des principaux ; partant, point de foi politique en jeu, point de résistance, pas le moindre petit fait d’armes, par suite d’héroïsme.
Point de bien politique, point de solidarité entre les bandes armées réunies à Aups, et par conséquent, point de lâcheté honteuse dans la débandade de ces troupes.
Les organisateurs de la fête du 14 juillet 1881 ont eu le tort de confondre le particulier avec le général, de prendre pour l’élan d’une indignation patriotique les passions malfaisantes qui ont éclaté dans certains points de notre département et se sont manifestées à Aups.
Point n’était nécessaire d’élever un monument aux insurgés de 1851 dans notre ville.
Je n’entends me faire ici ni le détracteur, ni l’apologiste d’une insurrection qui a eu cette singulière fortune de n’avoir à Paris que des généraux sans soldats, et dans le Var, que des soldats sans généraux ; – j’eusse été des premiers à réclamer honneur et réparation pour ceux qui auraient mérités d’être considérés comme les victimes de leur foi politique. Mais j’estime qu’il faut savoir distinguer l’origine des ruines que l’on veut relever, « Suum cuique : à chacun selon ses œuvres. »
A la masse ignorante, plus que coupable, notre profonde pitié ; à ceux qui dans un intérêt inavouable ont spéculé sur l’ignorance des uns et les mauvaises passions des autres, la honte ou l’oubli ; mais pas de monument à des héros qui n’ont jamais existé !
ESCOLLE
Conseiller Général du canton d’Aups
Le 18 juillet 1890, La Voix du Peuple du Var (journal de Gustave Cluseret, alors député du Var, siégeant à l’extrême gauche), polémique sur la publication des articles d’Escolle : Draguignan. La conciliation prêchée par l’Indépendant du Var. En vain nous dira-t-on que l’Indépendant du Var est une feuille sérieuse : si quelques-uns l’ont pensé ainsi, leur désillusion, aujourd’hui, doit être complète. En effet, que penser d’un journal qui fait appel aux royalistes, impérialistes et républicains, si ce n’est que cette feuille voulant servir toutes les causes, commence à n’en servir aucune. L’Indépendant du Var insère dans ses colonnes une série d’articles plus ou moins fantaisistes, qui sous le titre de Souvenirs de 1851, rappelle des faits oubliés depuis longtemps est qui mériteraient un contrôle moins intéressé et surtout plus autorisé que le nom de celui qui ravive chez nous de si lugubres et si douloureux détails. Il n’y avait qu’une feuille comme l’est l’indépendant pour donner accès dans ses colonnes à cette dernière vengeance d’un parti complètement en déroute. Derrière ces lignes apparaît la main des Torquemada à robes courtes tenant le poignard toujours aiguisé de frais, cette arme de sainte inquisition ! Et la dévote feuille s’empresse, sans doute pour être en contradiction avec l’appel qu’elle fait aux républicains, de leur faire croiser le fer avec leurs plus terribles ennemis, les impérialistes. Nous appelons cela faire de la conciliation à la Loyola ! Vraiment, ces gens-là s’imaginent que le sang répandu dans la plaine d’Aups (dans le Var) et sur les bords de la Durance (dans les Alpes), répandu, disons-nous, par les sbires d’un gouvernement maudit et par les pourvoyeurs des commissions mixtes, ne crie pas toujours vengeance !! Allons donc ! faux tonsurés, Messieurs qui vous confessez et vous absolvez mutuellement de vos méfaits, nos fils ne peuvent oublier que leurs pères tombaient assassinés pour la défense de nos droits et la revendication de nos libertés ; ils ne peuvent donc donner à leurs assassins le baiser Lamourette[1]. (…)
[1] Il est ici fait référence à la proposition faite le 7 juillet 1792 par Antoine-Adrien Lamourette aux députés de l’Assemblée législative d’une embrassade générale destinée à la réconciliation.
[1] Jean-Jacques Houlez, capitaine à la compagnie de gendarmerie du Var.
[2] Jean-Baptiste Aymard, ouvrier maçon, natif du Muy.
[3] François Bonnet, cultivateur.
[4] Il y a là confusion entre Joseph Victor Bonnet, dit Volant, cultivateur et Chrétien Muller.
[5] Chrétien Muller, cordonnier d’origine suisse.
[6] Cyprien Emeri, dit Mérigon, cultivateur natif de Vidauban.
[7] Joseph Augustin Ganzin, dit le Russe, cultivateur.
[8] Clair Jourdan, ménager.
[9] Denis Léon Martin, dit Ferrari, propriétaire.
[10] Hyppolite Maurel, maçon.
[11] François Henry, dit Praxède, natif de Cabasse, est en fait cordonnier aux Mayons.
[12] Etienne Vileclair, menuisier.
[13] En fait, la même personne que celle citée résidente au Luc.
[14] François Louis Dufort, cultivateur.
[15] Antoine Emmanuel Philip, maître cordonnier à Vidauban, natif de Bargemon, a en fait été fusillé à Lorgues.
[16] Jean-Baptiste Ferlandy, sans profession.
[17] Ambroise Motus, maçon, natif de Draguignan.
[18] François Goigoux, ouvrier tailleur au Luc, natif de Nevers.
[19] François Aragon, ouvrier charron à Vidauban, natif du Muy.
[20] C’est une erreur. Il doit y avoir confusion avec Emmanuel Inguimbert, charron du Muy, condamné à Cayenne et qui en est revenu vivant. (cf. Négrel Frédéric, « Morts pour la République », Bulletin de l’Association 1851, n°24, juillet 2003)
[21] François Coulet, cultivateur de Vidauban, natif des Arcs.
[22] Célestin Gayol, bouchonnier.
[23] Louis Jassaud, 17 ans. Sa mort est confirmée par une lettre du maire du Luc (AC Aups, 1 M 16, lettre au maire d’Aups du 4 février 1880).
[24] Joseph Antoine Laborde, perruquier, décédé au Luc le 23 décembre 1851.
[25] Jean Joseph Féraud, ménager.
[26] Ferdinand Martin, dit Bidouré, peigneur de chanvre. Voir Merle René, « Martin Bidouré, fusillé deux fois », Bulletin de l’Association 1851-2001, n°12, octobre/novembre 2000.
[27] Gariel Alexandre, Le coup d’Etat de décembre 1851 dans le Var, Draguignan, 1878 (deux premiers chapitres)
[28] Granier de Cassagnac Adolphe, Récit authentique des événements de décembre 1851 à Paris et dans les départements. Nouvelle édition précédée d’une introduction sur les coups d’Etat, Paris, Dentu, in 12, 1869, l44.p.
[29] Honoré Dauphin, dit l’Américain, perruquier.
[30] Dupont Charles, Les républicains et les monarchistes dans le Var en décembre 1851, Paris, 1883
[31] Honoré Pastoret, avocat dracénois, cible privilégiée du préfet Haussmann. Il était président du club des Allées que l’on nomma plus tard club du Jeu de Paume. Il n’était pas partisan de l’insurrection de Décembre et en dissuada le parti dracénois. Il s’enfuit à Nice où il fit fortune comme avocat d’affaires. Il revint dans le Var en 1871. Il fût élu conseiller général du canton de Fayence (il était originaire de Seillans), puis président du conseil général pendant 9 ans. Célèbre pour ses colères, c’était un anti-clérical virulent.
[32] Avocat dracénois, représentant en 1848.
[33] Avocat dracénois.
[34] Originaire de Callas, commissaire du gouvernement provisoire dans le Var en 1848, élu représentant (modéré) la même année. Mort en exil à Nice en 1861.
[35] Voir Cauvin M., « L’insurrection de 1851 : le docteur Barbaroux », Bulletin de l’Académie du Var, 2001, pp. 208-234
[36] S’agit-il du maire de Barjols ou du délégué républicain de Grasse ?
[37] Eugène Fassy, patron tanneur, adjoint au maire de Barjols, exilé à Nice, maire d’opposition en 1865, ami de Paul Cotte.
[38] Duteil Camille, Trois jours de Généralat ou un épisode de la guerre civile dans le Var (décembre 1851), Savone, F. Rossi, 1852
|