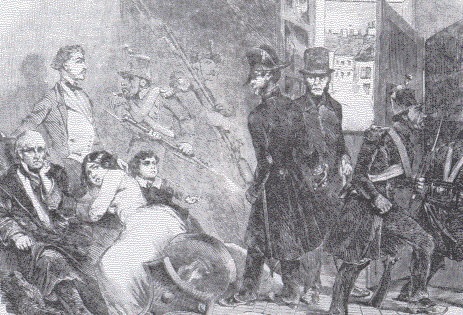Le coup d’Etat
de Louis-Napoléon Bonaparte par Philippe Vigier Au matin du mardi 2 décembre 1851 – jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier en 1804 et de la victoire d’Austerlitz en 1805 -, les Parisiens découvrent sur les murs de la ville deux affiches-proclamations, adressées à la population et à l’armée. Le président de la IIéme République, Louis-Napoléon Bonaparte, y annonce la dissolution de l’Assemblée législative, qui a refusé de modifier la Constitution de 1848 et l’empêche ainsi de solliciter un nouveau mandat présidentiel en 1852 ; il invite le peuple de France à lui donner mandat pour rédiger une nouvelle Constitution lui permettant de se maintenir à la tête de l’Etat, avec des pouvoirs accrus.
Le Prince-président viole donc les principes du régime républicain. Or, les premiers visés sont les députés, en majorité royalistes : l’Assemblée élue en mai 1849 est en effet dominée par le très réactionnaire parti de l’Ordre. Et, dès l’aube, un important détachement de soldats, dont les chefs sont gagnés à la cause napoléonienne, occupe le Palais-Bourbon. Quelque soixante mille hommes sont concentrés dans la capitale. La police est également mobilisée. Et c’est de main de maître que ce pronunciamento, remarquablement préparé, est dirigée par une poignée d’aventuriers et de spéculateurs : le comte de Morny, ministre de l’Intérieur et demi-frère de Louis-Napoléon, Persigny et Mocquard, vieux fidèles du prince, le maréchal Saint-Arnaud et le nouveau préfet de police, Émile de Maupas, récemment gagnés, eux, à la cause du prince.
Dès l’aube, toujours, commissaires et agents de police arrêtent, à leur domicile, soixante-dix-huit personnes dont seize représentants du peuple, pourtant « inviolables » selon les termes de la Constitution. En dépit de leurs protestations, sont ainsi conduits à la nouvelle prison de Mazas, dans le XIIème arrondissement actuel, aussi bien des monarchistes tels Adolphe Thiers, les généraux Changarnier, Lamoricière ou Bedeau, Charles de Rémusat, que des républicains aux idées avancées comme Martin Nadaud, Greppo, Jules Miot, Agricol Perdiguier, tous populaires parmi les travailleurs de la capitale.
Pourtant, dans un premier temps, les ouvriers parisiens demeurent dans l’expectative : ils se sentent plus proches de Louis-Napoléon Bonaparte, l’auteur de L’Extinction du paupérisme (1844), que de la plupart des membres de l’assemblée dissoute. D’autant qu’après s’être vu refuser l’accès du Palais-Bourbon par l’armée, quelque deux cent vingt représentants, appartenant presque tous au parti de l’Ordre, se sont réunis en fin de matinée à la mairie du Xème arrondissement. Après avoir décrété la déchéance du président de la République, ils se sont laissé arrêter et transférer, eux aussi, à Mazas – se gardant bien d’appeler le peuple au secours… Des armes pour la République Dans ces conditions, l’appel aux armes viendra de la minorité républicaine de l’Assemblée. Après diverses réunions tenues chez tel ou tel représentant démocrate, un comité de résistance, comprenant, entre autres, Victor Hugo, Victor Schoelcher, Michel de Bourges et Hippolyte Carnot, est constitué en fin de journée. Il y est décidé que, dès le lendemain matin, les députés « montagnards » arpenteront les quartiers populaires de l’Est parisien pour appeler les travailleurs à dresser des barricades. Mais seule une vingtaine de représentants, ceints de leur écharpe tricolore, se trouvent, le 3 décembre, vers huit heures du matin, dans le faubourg Saint-Antoine. Ils ne parviennent pas à convaincre les ouvriers de défendre une république qui les a fait mitrailler en juin 1848. Et c’est sur une frêle barricade que se fait tuer Alphonse Baudin, représentant de l’Ain, fusillé par un détachement de soldats, et auquel on prêtera ce mot célèbre, qu’il faut savoir mourir pour vingt francs (1). Le libérateur des esclaves, Victor Schoelcher, est le principale animateur de cette sanglante échauffourée et le premier historiographe d’un drame qui marquera durablement la mémoire républicaine.
Peu après, on peut croire qu’il va se passer quelque chose dans l’autre secteur traditionnel des révolutions parisiennes : les quartiers centraux du Temple ou de l’Hôtel de Ville. Rues Greneta, Saint-Denis, Transnonain et Rambuteau, quelques barricades s’édifient. Le préfet Maupas s’inquiète, mais pas son ministre, Charles de Morny. Ce dernier sait qu’en dépit des efforts déployés par un curieux comité central des corporations (animé par Jules Leroux, frère du socialiste utopiste Pierre Leroux), il n’y a aucune mesure entre le nombre des « insurgés » parisiens de décembre 1851 et celui des combattants de juillet 1830 ou de février et juin 1848. En effet, on ne compte pas plus de mille à mille deux cents contestataires derrière les soixante-dix barricades qui se dressent finalement, le 4 au matin, au coeur du vieux Paris. Et dès l’après-midi les insurgés sont écrasés.
Les Parisiens seront durablement frappés par la « fusillade des Boulevards » qui éclate vers quinze heures. Elle se produit entre le boulevard des Italiens et le boulevard Bonne-Nouvelle, durant le passage des colonnes chargées d’attaquer le périmètre insurgé par le nord. De jeunes bourgeois, des « gants jaunes », installés aux terrasses des cafés à la mode (Tortoni, Frascati) ou massés sur les trottoirs situés devant la Maison dorée ou le grand magasin Sallandrouze, regardent défiler les troupes en criant : « Vive la Constitution ! Vive l’Assemblée nationale ! » Enervés par cette attitude hostile ou goguenarde, les soldats s’affolent lorsque retentissent quelques coups de feu, tirés d’on ne sait où…
Une terrible fusillade éclate alors et se propage du boulevard Bonne-Nouvelle au boulevard des Italiens. « Pendant un quart d’heure, c’est un véritable ouragan de feu et de plomb (2) » rapporte Eugène Ténot, l’un des spectateurs les plus fidèles de ce drame qui s’abat sur les badauds. Bilan : quelque deux cents victimes et de gros dégâts matériels. « L’impression produite dans Paris par ce fatal évènement fut immense, ajoute Eugène Ténot. La nouvelle s’en répandit rapidement, grossie par la rumeur publique. L’indicible épouvante de ceux qui avaient échappé se transmit aux masses et les glaça. Ce furent, dès le soir, une stupeur, une prostration universelles. (3)« 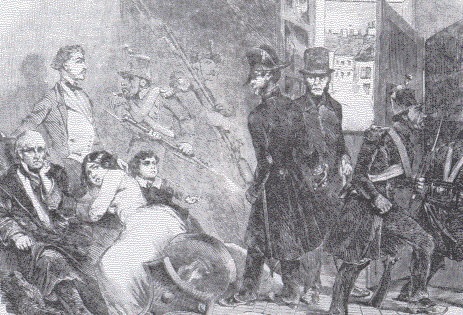
Désormais, Paris ne bougera plus. Mais il n’en va pas de même de la province dont la résistance constitue pour nombre d’historiens, français aussi bien qu’anglo-saxons, un phénomène de première importance, dont on a trop longtemps sous-estimé le poids ou défiguré le sens. Entendons-nous bien. La plus grande partie de la province (celle qui a voté en mai 1849 pour les candidats du « parti de l’Ordre » – essentiellement à l’ouest, au nord et au nord-est de la capitale) n’a pas réagi, habituée qu’elle était à suivre les impulsions des notables locaux et des représentants de Paris : préfets, procureurs ou généraux ont, à quelques exceptions près, accepté le coup d’Etat. Et dans les grandes villes, inondées de troupes, il n’y eut que des protestations verbales. Typique, à cet égard, est le cas de Lyon qui, à l’époque, fait figure de capitale de la « province rouge », réfractaire aux directives parisiennes. Et pourtant, « elle conserva, malgré les opinions bien connues de sa population, une tranquillité matérielle absolue. Les formidables dispositions militaires prises par le général Castellane prévinrent toute tentative de résistance et permirent de détacher des troupes contre les graves insurrections du Midi » (4). L’armée républicaine en marche C’est en effet le Sud-Est, ainsi que quelques départements du Sud-Ouest et du Centre, qui fournissent ses principaux contingents à la résistance républicaine. Les points forts de la crise se situent, dans ces régions, les vendredi 5 , samedi 6 et dimanche 7 décembre, alors que l’ordre bonapartiste règne déjà à Paris. Ce décalage s’explique en grande partie par la lenteur des communications, dans une France où la révolution des chemins de fer n’en est qu’à ses débuts.
Dans les Basses-Alpes (5) (cas unique en France par l’ampleur et la durée de la résistance), c’est seulement le mardi 9 que les républicains locaux, qui se sont rendus maîtres du département les jours précédents, apprennent que le coup d’Etat a réussi. La plupart des dirigeants du mouvement demandent alors à leurs troupes de se disperser. Seul le commandant en chef, Ailhaud de Volx, ancien garde général des Eaux et Forêts, révoqué en 1849 pour raison politique, décide de continuer la lutte avec quelques irréductibles – ce qui le conduira, après plusieurs mois d’errance dans la montagne de Lure, au bagne de Cayenne, où il mourra. Il est vrai que les Basses-Alpes ont mobilisé plus de protestataires – surtout des paysans – que Paris. Toute la partie méridionale du département, autour de la « ville rouge » de Manosque, avec son maire démocrate-socialiste, Joseph Buisson, s’est soulevée le 5 décembre. Comme ailleurs, il s’agissait de « neutraliser » les administrateurs ralliés à la cause bonapartiste, tel le sous-préfet de Forcalquier, Paillard, qui, fait prisonnier et grièvement blessé, n’est sauvé d’un destin plus funeste que grâce à l’intervention des chefs républicains (ce dont il témoignera ultérieurement debant les tribunaux).
Après s’être emparés de presque toutes les communes des arrondissements de Forcalquier et de Sisteron, ainsi que de la partie sud-ouest de l’arrondissement de Digne (avec les petites villes de Riez, Valensole ou Gréoux), six à sept mille républicains ont donc marché, le samedi 6, sur Digne, préfecture du département. Plusieurs colonnes armées y font leur entrée durant les premières heures du dimanche 7. Ne pouvant pas compter sur la faible garnison dont il dispose pour défendre la ville – quatre cent vingt jeunes recrues, qui déposeront vite les armes -, le préfet a quitté Digne en cachette pour se réfugier dans les Hautes-Alpes. Pour le remplacer, les chefs des insurgés constituent un comité départemental de résistance, qui administrera les Basses-Alpes du 7 au 10 décembre. Les mesures qu’ils prennent permettent de mieux saisir le projet de république démocratique et sociale pour lequel ils militent depuis plusieurs années. Quand sonne le tocsin Si les Basses-Alpes représentent un cas unique, les départements voisins du Var, de la Drôme et, à un moindre titre, du vaucluse, connaissent, eux aussi, des rassemblements armés et des affrontements souvent sanglants entre « insurgés » républicains et forces de l’ordre. Dans le Var, des colonnes armées tentent de contrôler les centres administratifs (6). La plus importante regroupe la quasi-totalité de la population adulte (les femmes accompagnant parfois, voire encourageant leurs maris, pères ou parents) des gros bourgs ou villages du centre du département, gagnés dès 1849 à la cause républicaine : Vidauban, La Garde-Freinet ou Le Luc. Le mouvement « démarre » vraiment au cours de la journée du 5 : le vendredi 5 et le samedi 6, trois mille Varois insurgés se rejoignent au Luc, puis à Vidauban. Mais ils renoncent à marcher sur la préfecture du Var : Draguignan est mieux gardé que Digne et la plupart des leaders républicains locaux, des bourgeois, sont hostiles à la résistance armée. Le « général en chef de l’armée démocratique du Var« , Camille Duteil, journaliste marseillais arrivé impromptu à Vidauban, prend alors la tête des révoltés (7). Ceux-ci abandonnent la route de Draguignan et se portent vers le nord-ouest. Leur but ? Rallier les habitants de la partie occidentale du département, qui n’ont guère bougé jusqu’alors, et rejoindre les insurgés des Basses-Alpes ; mais, du même coup, ils s’éloignaient de leurs bases pour entrer dans une région « blanche », surtout dominée par des notables légitimistes. A Lorgues, par exemple, les républicains sont très fraîchement accueillis dans l’après-midi du 7.
Dans ces conditions, l’aventure se termine en catastrophe…Parvenus le mardi 9 au soir à Aups, à l’extrémité nord-ouest du département, les insurgés varois, découragés par les nouvelles qui leur parviennent du reste de la France, se laissent surprendre par les militaires. C’est un massacre. Après une véritable chasse à l’homme, trois mille cent quarante-sept « individus arrêtés ou poursuivis » (soit 12% des républicains) passent devant la commission mixte départementale en février 1852 et sont jugés par des « tribunaux » d’exception.
Le département de la Drôme, quant à lui, s’est moins engagé que les deux précédents. Mais les combats entre insurgés et forces de l’ordre y ont été plus importants et plus meurtriers qu’ailleurs. Il est vrai que les sept principaux cantons soulevés sont voisins, peuplés, et situés au coeur du département, de part et d’autre de la rivière Drôme, enserrant la petite ville de Crest qui domine économiquement la région. Là aussi, c’est seulement le vendredi 5 que débute un vaste mouvement armé, retardé jusqu’alors par les hésitations et les consignes contradictoires venues de Valence, chef-lieu du département. Les meneurs républicains sont en effet impressionnés par l’attitude résolue du préfet Ferlay, qui est d’une autre trempe (et dispose de plus de troupes) que son collègue des Basses-Alpes. Finalement, dans la nuit du 5 au 6 et dans la journée du samedi 6, des émissaires parcourent les cantons de Crest, Bourdeaux, Saillans et Dieulefit, pour transmettre l’ordre de départ, tant attendu, aux républicains, qui se sont déjà assurés des administrations municipales. De part et d’autre de la vallée, le tocsin sonne, les appelant à s’emparer de la ville de Crest avant de marcher sur Valence dont la « libération » permettrait de couper les relations entre Paris, Lyon et Marseille.
Or Ferlay, qui sait que le danger viendra essentiellement de cette région où les protestants sont nombreux et traditionnellement hostiles à toute mise au pas, a envoyé à Crest, dès le 4, un important détachement de troupes et deux canons. Dans la soirée du 6, celui-ci repousse, sans trop de difficultés, un premier assaut mené par les communes rurales les plus proches. Le dimanche 7, d’importants contingents républicains arrivent de Dieulefit (petite cité manufacturière, où l’organisateur du mouvement est le pharmacien Darier), Bourdeaux (où le chef indiscuté est le notaire Oscar Vernet, seul conseiller catholique de ce chef-lieu majoritairement protestant), Marsanne et Crest-Sud. Une épopée qui finit en catastrophe Pendant trois heures, cinq à sept mille républicains tentent d’enlever les positions tenues par les forces de l’ordre. Mais l’armement de ces dernières est supérieur au leur. Les canons font de terribles ravages dans les rangs des assaillants, qui avancent en masses compactes (groupés par villages) en chantant La Marseillaise ou Le Chant des paysans de Pierre Dupont. Si bien qu’en dépit de leur courage, ils doivent se replier vers dix-sept heures, laissant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés sur le terrain. Les marches sur Valence et Montélimar ayant également échoué, le département de la Drôme est dès lors livré à l’armée. Les colonnes mobiles traquent le républicain. Et les prisonniers s’entassent, en cet hiver particulièrement rude, dans la vieille tour de Crest, qui deviendra le symbole de la résistance et du martyre de la Drôme républicaine.
A la différence des trois départements précédents qui avaient majoritairement voté « à gauche » (c’est-à-dire républicain « montagnard ») lors des élections législatives de mai 1849, le Vaucluse avait, quant à lui, choisi le parti de l’Ordre, dominé par les légitimistes : seul l’arrondissement d’Apt avait voté républicain. Mais depuis lors, les communes situées de part et d’autre du Lubéron (Pertuis, Cadenet, Bonnieux, Ménerbes) ou le long de la vallée supérieure du Coulon avaient rejoint le camp républicain. En apprenant que les insurgés se sont rendus maîtres du département voisin, et après un mot d’ordre venu de Manosque, les communes rurales se soulèvent donc et marchent sur Apt, prise dans la journée du 7. Le lundi 8, une colonne armée de cinq à six cents hommes quitte bravement la ville pour rallier à sa cause l’Ouest du département. Sans succès, on s’en doute: le 10 au matin, elle est dispersée aux portes de Cavaillon par les troupes du colonel de France, renforcées par la garde civique qu’avait consituée la Société de l’ordre légitimiste qui régnait sur la ville.
Dans le département du Gard, sur l’autre rive du Rhône (8), les légitimistes dominent également. Comme en Avignon ou à Cavaillon, les autorités et les milices légitimistes et catholiques d' »autodéfense » (comptant beaucoup d' »hommes du peuple ») n’ont guère de mal à empêcher que Nîmes, Uzès ou Alès tombent au pouvoir des villageois démocrates (en majorité protestants) des communes de la Vaunage ou de la région de Saint-Jean-du-Gard, soulevées dès le 4 et le 5. La répression n’en est pas moins sévère : neuf cent cinquante républicains seront poursuivis (environ trois mille cinq cents personnes ont participé au mouvement insurrectionnel)..
Par son ampleur, comme par la gravité des évènements qui s’y produisent, le département voisin de l’Hérault est le dernier grand foyer contestataire du Sud-Est. Le mouvement se limite à la partie occidentale du département, où l’arrondissement de Béziers est le théâtre d’affrontements sanglants. Le premier a lieu le jeudi 4. Appelés à la rescousse par les chefs républicains de la ville, les villages du Biterrois (Pézenas, Capestang, Servian, etc.) se lèvent en masse, au petit matin. Rejoints par les républicains de la cité – ce qui fait, en tout, trois à quatre mille hommes -, ils somment le sous-préfet d’abandonner ses fonctions, au profit de « délégués du peuple ». Collet-Meygret répond en faisant donner la troupe, qui tire sur les manifestants place de la Sous-Préfecture : « Près de soixante-dix hommes tombèrent morts ou blessés. C’étaient les plus énergiques de la colonne populaire« , note Ténot ; si bien que Béziers et ses alentours ne connaîtront plus que des incidents sporadiques.
Mais plus au nord, Bédarieux (dix mille habitants environ, à cette date, et cité la plus industrielle du département, avec ses fabriques de draps) est le théatre d’évènements dont l’écho retentira dans tout le pays. Faute de garnison, le maire conservateur doit, dès le 4 décembre, laisser la place à une Commission municipale républicaine, qui administre la cité jusqu’au 10. Or celle-ci ne peut éviter que la colère populaire se déchaîne contre les gendarmes (détestés à cause des procès-verbaux dressés pour braconnage ou même délit politique). Enfermés dans leur caserne, tirant sur leurs assaillants, dont plusieurs sont tués ou blessés, trois d’entre eux sont abattus. Tous les républicains du département seront victimes de la répression qui s’ensuivra. Avec deux mille huit cent quarante « individus » déférés devant la commission mixte, l’Hérault vient juste derrière le Var au martyrologue de la résistance au coup d’Etat.
Nous ne retrouverons pas de tels chiffres dans la seconde région française insurgée en décembre 1851 : le Sud-Ouest. Toutefois, dans deux départements, le Gers et le Lot-et-Garonne, on constate des réactions semblables à celles qui viennent d’être décrites. Ainsi, dans le Gers, tandis que les meneurs républicains bourgeois d’Auch (chef-lieu du département) discutent, les 3 et 4 décembre, de la conduite à tenir (protestation pacifique ou résistance armée), les démocrates les plus résolus, groupés autour de L’Ami du peuple, appellent en renfort les villageois des cantons environnants. Dans la journée du 4, se forme une colonne forte d’au moins trois mille hommes, venant de Vic-Fezensac, Jegun ou Barran. Parvenue dans les faubourgs d’Auch, elle se heurte aux quatre escadrons de hussards qui protègent la ville. Ces derniers dispersent les insurgés ; mais vingt-quatre hussards, dont plusieurs officiers, sont tués ou blessés. La France en état de siège L’armée et le pouvoir bonapartiste n’en restent pas moins maîtres du terrain, ce qui est de mauvais augure pour les mouvements qui, ce même jeudi 4, éclatent à Mirande, Condom, Fleurance, etc. Les républicains de Mirande prennent le contrôle de leur cité et de l’ensemble de cet arrondissement méridional. De Mirande et des cantons environnants, six mille hommes environ marchent, les 5 et 6, sur Auch. Mais devant l’attitude résolue du préfet et des « hommes d’ordre », les républicains renoncent à leur projet et se replient sur Mirande. Le 7, une colonne d’infanterie, artillerie et cavalerie y rétablit, sans résistance, les anciennes autorités et opère de nombreuses arrestations. Neuf cent trente-sept Gersois seront poursuivis devant la commission mixte départementale.
Presque autant d’arrestations sont recensées dans le département voisin, le Lot-et-Garonne. Des cantons entiers s’y insurgent. La première cible des républicains est le chef-lieu du département, Agen, aussi mal défendu que Digne. Mais l’organisation républicaine se révèle peu cohérente : alors que ses chefs avaient prévu le renfort de deux colonnes d’insurgés venues de l’arrondissement de Nérac, au Sud-Ouest, et de celui de Villeneuve-sur-Lot au Nord-Est, ils ne voient arriver, dans la matinée du jeudi 4, que près de deux mille villageois du Sud-Ouest. Pas de trace de la colonne de Villeneuve, où les républicains avaient pourtant chassé le sous-préfet et nommé une commission révolutionnaire. Or, on ignore pourquoi, elle se contenta d’attendre, durant cinq jours, d’être dissoute par les forces de répression. 
Plus original encore est le comportement des républicains majoritaires dans la troisième sous-préfecture du département, Marmande. Maîtres du conseil municipal, les modérés (bourgeois) légalistes font voter une résolution qui, en vertu du fameux article 68 de la Constitution, déclare le président de la République déchu de ses fonctions et lui refuse obéissance. Le lendemain, le sous-préfet quitte la ville, avec les gendarmes, et rejoint Bordeaux. D’abord hostile à toute action armée contre Agen, voire Bordeaux, la commission provisoire républicaine renvoie dans leurs villages, le samedi 6, les nombreux paysans venus de tous les points de l’arrondissement pour prêter main forte. Ce n’est que le lundi 8 – trop tard ! – que, sous la pression populaire, un millier de républicains sortent de Marmande et prennent la route de Bordeaux. Ils n’iront pas loin. A quelques kilomètres de la ville, ils se heurtent aux forces de l’ordre ; après un bref mais sanglant échange de coups de feu, la colonne insurgée se disperse. Sachant que le coup d’Etat a réussi ailleurs, les chefs républicains évitent une nouvelle effusion de sang.
Des ébauches de résistance, voire l’installation de comités républicains, eurent lieu dans le Lot (Figeac, Gramat), la Dordogne (Bergerac) ou l’Aveyron (Rodez). Mais pour retrouver des mouvements aussi importants que ceux du Sud-Est, il faut se tourner vers le Centre et, plus précisément, vers le département de la Nièvre.
A la surprise générale, le Nivernais avait voté « rouge » en mai 1849. Et il n’avait cessé depuis de manifester son hostilité à la majorité conservatrice de l’Assemblée, présidée par le député inamovible de Clamecy, André Dupin, dit Dupin aîné, cible préférée des républicains locaux, lecteurs passionnés des pamphlets de Claude Tillier. Le message contestataire et populiste diffusé dans ses articles de L’Indépendant, journal d’opposition paru à Clamecy sous la monarchie de Juillet, et repris sous une forme romancée dans le célèbre Mon oncle Benjamin (publié en 1841), semble avoir beaucoup inspiré les meneurs de l’insurrection qui éclate le vendredi 5 décembre. Faute d’instructions parisiennes, les républicains de la Nièvre attendent cependant le mot d’ordre de ceux du chef-lieu, Nevers. Mais ces derniers ont été décimés par les arrestations opérées, deux mois plus tôt, dans le cadre des poursuites engagées contre les sociétés secrètes du Nivernais et du Berry.
Rassurer les « bien-pensants » Trop éloignés des centres de décision, les républicains de Clamecy et des communes situées aux confins de la Nièvre et de l’Yonne ont, en revanche, presque tous été épargnés par la répression de 1849-1851. Tout débute donc à Clamecy, modeste sous-préfecture (environ six mille habitants), dans la soirée du 5. Très vite, une famille bourgeoise, les Millelot – le père, imprimeur et juge au tribunal de commerce, et ses deux fils, Numa et Eugène (ce dernier se révélant bientôt l’âme du mouvement républicain, ce qui lui vaudra de terminer sa vie à Cayenne) -, joue dans l’insurrection un rôle capital. En quelques heures, le « petit peuple » artisan et commerçant du centre ville, renforcé par les flotteurs de bois (sur l’Yonne) du faubourg de Bethléem, se rend pratiquement maître de la cité.
On libère d’abord quelques militants républicains détenus dans la prison jouxtant la mairie, à commencer par le négociant Jean-Baptiste Guerbet, qui approuve la prise d’armes (il mourra, lui aussi, en Guyanne). Une patrouille de six gendarmes envoyés par le sous-préfet pour appuyer la centaine d’hommes qui tentent d’empêcher les insurgés de prendre la mairie, doit se replier, non sans avoir laissé deux morts et deux blessés sur le terrain. Sans coup férir, les républicains s’emparent de l’hôtel de ville, tandis que, dans la nuit du 5 au 6, arrivent deux à trois mille paysans, artisans ou commerçants de la vallée de l’Yonne (Dornecy, Entrains, Corvol, Pousseaux), appelés à la rescousse par Millelot père et ses amis politiques.
C’est ainsi que, trois jours durant, Clamecy est l’une des rares oasis républicaines dans cette France qui, de gré ou de force, a accepté le coup d’Etat. Ici aussi, le comité révolutionnaire social s’efforce de maintenir l’ordre…républicain. Les récits horribles, de pillages, de viols qui furent colportés ensuite témoignent de l’épouvante qu’a suscitée, chez les « bien-pensants », cette très temporaire prise de pouvoir par les gens des bourgs et des campagnes.
Ces affabulations tirent en fait parti du meurtre du gendarme Bidan, « brave homme d’un certain âge » selon Ténot, et qui fut, après la prise de la gendarmerie de Clamecy, le 6 décembre, livré à une foule déchaînée refusant d’écouter les conseils de modération de ses chefs. Consterné par cette de violence, qui vaudra à deux des auteurs présumés du meurtre de périr sur l’échafaud l’année suivante, Eugène Millelot incite cependant citadins et paysans à construire des barricades aux portes de la ville. Mais celles-ci sont abandonnées au fur et à mesure que les nouvelles arrivent de Paris et d’ailleurs. Si bien que c’est dans un Clamecy « déserté par la majeure partie de la population valide », toujours selon Ténot, que pénètre, le lundi 8 au matin, le préfet de la Nièvre, à la tête d’un important appareil répressif.
Cette insurrection républicaine de certaines provinces permet en effet aux auteurs du coup d’Etat de mettre en état de siège trente-deux départements français – c’est-à-dire d’y donner tous pouvoirs aux autorités militaires. Outre les départements déjà évoqués, mentionnons l’Allier (où il y eut au Donjon et à La Palisse, du 3 au 5 décembre, un mouvement insurrectionnel, de moindre ampleur et rapidement brisé), le Loiret (Orléans, Montargis, Bonny-sur-Loire), la Saône-et-Loire (Cluny), le Jura (Poligny), et enfin la Sarthe, seul département de l’Ouest et du Nord à avoir connu une résistance armée, mais dans une petite commune manufacturière uniquement : La Suze.
Donc, le coup d’Etat a fini par triompher. Mais à quel prix ! Contrairement à ce qui a été longtemps affirmé dans les manuels qui minimisent l’importance de la réaction armée au coup d’Etat du 2 décembre, la résistance provinciale et la répression antirépublicaine ont bien été deux faits marquants de ces journées. Selon l’historien américain Ted W. Marga-dant, « le soulèvement provincial le plus sérieux du XIXème siècle français » a « engendré la répression policière la plus importante qui ait existé, en dehors de Paris, entre la terreur et la Terreur Blanche des années 1790, et la Résistance de la Seconde Guerre mondiale« .
Certes, cette résistance a, par contre-coup, profité aux partisans de Louis-Napoléon Bonaparte. Non seulement la parti républicain a été décapité pour des années mais le rôle essentiel joué par le « peuple » des campagnes a permis aux responsables du coup d’Etat – à commencer par Morny – de tirer tout le profit nécessaire des exactions perpétrées contre les gendarmes à Clamecy ou à Bédarieux. Prolongeant et amplifiant démesurément la dénonciation du « spectre rouge » qui alimente la propagande antirépublicaine depuis deux ans, ils présentent dès lors la résistance provinciale comme une jacquerie qui aurait éclaté, de toute façon, au moment des élections de 1852, si l’initiative du Prince-président n’éatit venue sauver la société française. Le grand remord de Napoléon III Dès le 10 décembre, Morny adresse une circulaire en ce sens à ses préfets : « Vous venez de traverser quelques jours d’épreuve ; vous venez de soutenir en 1851 la guerre sociale qui devait éclater en 1852. Vous avez dû la reconnaître à son caractère d’incendie et d’assassinat. Si vous avez triomphé des ennemis de la société, c’est qu’ils ont été pris à l’improviste et que vous avez été secondés par les honnêtes gens. » Cette étonnante justification du coup de force bonapartiste a été payante, notamment auprès des notables qui, dans un premier temps, n’avaient pas apprécié la dissolution de l’Assemblée. A la veille du plébiscite des 21 et 22 décembre 1851, qui sera un triomphe pour le Prince-président (surtout dans les régions naguère insurgées et maintenant terrorisées), l’orléaniste Barante résume l’évolution de leur comportement : « La répression de la jacquerie a changé l’état de la question. »
Cependant, Louis-Napoléon Bonaparte ne semble pas avoir souhaité que le second Empire, proclamé l’année suivante, prenne une tonalité autoritaire, antirépublicaine et conservatrice. Cela explique la progressive libéralisation d’un régime dont le maître a « la pensée obsédée » par le souvenir « du serment violé, des morts de décembre, des brutalités de la répression. […] Un jour que l’impératrice Eugénie, le voyant abîmé dans une sombre rêverie et en devinant le motif, s’exclame : « Tu portes le 2 décembre comme une tunique de Nessus », il reconnaît : « J’y pense constamment« , écrit Adrien Dansette.
Quant aux républicains, qui considèrent maintenant le bonapartisme comme leur principal adversaire, ils ont leurs martyrs, auxquels ils édifieront des monuments dès leur installation au pouvoir, dans les années 1880. En outre, ils engageront, dès 1880-1881, une procédure d’indemnisation en faveur des « martyrs du droit et en mémoire de la résistance légale au coup d’Etat du 2 décembre 1851« . Cette inscription figure sur le monument de Clamecy, mais on la retrouve, quasi identique, ailleurs. Désormais, l’interprétation républicaine de la résistance au coup d’Etat s’imposera dans l’historiographie « officielle ». A la thèse de la jacquerie véhiculée par les historiens conservateurs, Tchernoff ou Seignobos opposent celle de la « lutte pour le droit », c’est-à-dire d’une protestation « spontanée » du peuple pour la défense de la répûblique et de la Constitution.
Or la réalité est plus complexe. Nous n’avons pas voulu interpréter ici les faits, mais mieux faire connaître des évènements trop souvent ignorés ou méconnus : le fait que dans tel ou tel département insurgé en décembre 1851 la commémoration ait été quasi confisquée par l’extrême gauche républicaine a sans aucun doute nui à l' »image de marque » laissée par le mouvement. La question fondamentale est (même si elle a été occultée par les fondateurs de la IIIème République, soucieux de pourfendre la thèse de la jacquerie et de désarmer ce que Gambetta appelle « le parti de la peur ») d’apprécier la part respective du politique et du social dans les mouvements protestataires. A priori en effet, on ne comprend pas pourquoi les paysans, les artisans et les bourgeois démocrates se sont soulevés pour défendre la Constitution de novembre 1848, élaborée par une Assemblée qui se préoccupait peu de leurs problèmes…
En revanche, tout s’éclaire – grâce aux nombreuses recherches historiques menées depuis une quarantaine d’années – si l’on fait intervenir le rôle décisif joué par les organisations républicaines locales, les sociétés secrètes à affiliation. Dans les zones insurgées, elles ont « enrégimenté » une bonne partie du peuple des campagnes, dans l’espoir de faire triompher, aux élections de 1852, la république démocratique et sociale, cette république des paysans et des « petits », pour laquelle les adversaires de Louis-Napoléon Bonaparte n’hésitent pas à verser leur sang.
Enfin, ajoutons – en nous plaçant, cette fois, sur un terrain purement politique – que le 2 décembre et ses conséquences ont engendré une longue défiance à l’égard d’un pouvoir exécutif qui tente de se substituer au législatif par la force ou la contrainte morale. Une défiance qui connaît des prolongements jusqu’à notre époque. Il suffit d’évoquer Le Coup d’Etat permanent de François Mitterand (9), jadis député de la Nièvre, département qui a payé l’un des tributs les plus lourds à la « chasse aux républicains ». (1) C’était le montant de l’indemnité parlementaire.
(2) Eugène Ténot, Paris en décembre 1851, Paris, 1868.
(3) Eugène Ténot, op.cit.
(4) Eugène Ténot, La Province en décembre 1851, Paris, 1865.
(5) Actuellement département des Alpes-de-Haute-Provence.
(6) Nous connaissons ce mouvement grâce aux travaux de Maurice Agulhon et à Emile Zola, dont La Fortune des Rougon (1869), premier volume de la série des Rougon-Macquart, situe bien le caractère fondateur des diverses réactions au coup d’Etat du 2 décembre.
(7) Depuis la fin de 1848, le journal marseillais Le Peuple, auquel collaborait Camille Duteil, avait joué un grand rôle dans la diffusion des idées démocratiques.
(8) Sur l’histoire du Gard au XVIIIème siècle, cf. Raymond Huard, La Préhistoire des partis. Le mouvement républicain en Bas-Languedoc, 1848-1881, PFNSP, 1982.
(9) « Entre De Gaulle et les républicains, il y a d’abord, il y aura toujours le coup d’Etat » – moins sanglant, certes, que celui du 2 décembre (dont François Mitterand envisageait de raconter l’histoire), mais tout aussi redoutable, assurait le futur président de la République, car « permanent » (cf. la réédition en 1993, dans la collection 10/18, de l’ouvrage polémique publié chez Plon en 1964). |