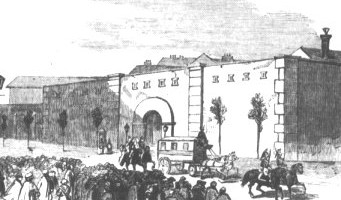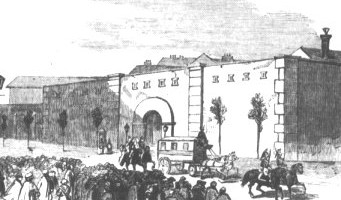HISTOIRE DES CRIMES DU 2 DÉCEMBRE Victor Schoelcher Bruxelles, chez les principaux libraires, édition considérablement augmentée, 1852 tome I Chapitre I : Arrestations préventives § 3. Interrompons le cours des événements, pour dire tout de suite ce que devinrent les seize représentants arrêtés préventivement. 
A Mazas, ils furent tous enfermés dans les cellules de voleurs, et soumis au secret le plus absolu. Leurs gardiens consignés, aussi prisonniers qu’eux-mêmes, ne savaient guère plus qu’eux ce qui se passait. MM. Baze, Leflô, Lamoricière, Changarnier, Bedeau, Thiers, Cavaignac, mis en cellules, comme des malfaiteurs, avec « les chefs les plus dangereux des sociétés secrètes et les hommes les plus célèbres dans le monde de l’émeute », le tout, pour que les héros de Strasbourg et de Boulogne pussent sauver la civilisation sans obstacle ! C’est assurément là un spectacle fait pour inspirer quelques réflexions salutaires aux honnêtes gens qui nous traitent toujours si légèrement d’ennemis de la société. Les amis de l’ordre élyséen délibérèrent même en conseil pour savoir s’il ne fallait pas fusiller tous ces brigands-là. M. Saint-Arnaud, particulièrement, ne pensait pas que l’on pût, à moins, préserver la société de l’hydre de la démagogie ; la majorité du conseil eut peur de l’opinion publique et décida qu’on se contenterait de les enfermer au château de Ham, pour prévenir le danger que courrait la propriété si les socialistes qui organisaient la résistance parvenaient à les arracher de prison. Dans la nuit du mercredi au jeudi, à deux heures, ces dangereux anarchistes furent donc éveillés et prévenus qu’ils allaient pour une destination inconnue. A trois heures, on les fit monter dans deux voitures, ainsi divisés : les généraux Bedeau, Leflô, le colonel Charras et M. Roger (du Nord), avec trois sergents de ville ; M. Baze, les généraux Lamoricière, Changarnier et Cavaignac, également avec trois sergents de ville. Les voitures étaient de celles qui servent au transport des forçats, dites voitures cellulaires ! On n’avait pas même pris le soin de les nettoyer ; elles étaient d’une malpropreté révoltante ; chaque petite cellule où se trouvait enfermé à clef un de ces généraux, fidèles gardiens des traditions de notre gloire, exhalait une odeur infecte. Les nobles vainqueurs que les vainqueurs du 2 décembre ! Comme il est facile de s’expliquer que l’armée française canonne Paris, pour proclamer césar un homme qui traite ses chefs les plus illustres à la façon des galériens ! Les prisonniers partirent au bruit de plusieurs centaines de chevaux qui les escortaient, et ils apprirent, par les sergents de ville, qu’on les menait à Ham. Arrivés au chemin de fer du Nord, ils espéraient être délivrés des voitures de forçats. Il n’en fut rien. On devait leur imposer jusqu’au bout ce qu’on croyait être une grande humiliation, et ce qui n’était, en réalité, qu’une lâche et misérable vexation. A Noyon, les voitures cellulaires furent remises sur leurs roues, et prirent la route de Ham. Elles étaient suivies d’une grande diligence remplie d’estafiers, sous la direction de deux commissaires de police ceints de leurs écharpes. L’armée française, qui a joué un si déplorable rôle dans les journées de décembre, avait un représentant jusque dans cette honorable compagnie. On y voyait figurer, en uniforme, le capitaine d’état-major Boyer, aide de camp du ministre de la guerre ! Ce jeune homme n’osa pas trop se montrer. Se souvenait-il donc d’avoir sollicité et obtenu du général Leflô la faveur de l’accompagner, lorsque celui-ci alla remplir une mission à Saint-Pétersbourg en 1848, ou bien de lui avoir alors emprunté une somme de quatre cents francs, qu’il avait oublié de lui rendre ? N’est-ce pas une chose frappante, significative, que tout ce monde du 2 décembre ait quelque vilaine affaire d’argent dans son dossier ? Le trajet de Noyon au château de Ham ne dura pas moins de onze heures ! Les pestilentielles voitures étaient obligées de mesurer leur pas sur celui d’une compagnie de gendarmes mobiles à pied qu’on avait donnée pour escorte. Il est vrai que les gendarmes avaient le fusil chargé. En condamnant les hommes qu’il redoutait à la voiture des galériens, l’ex-président n’avait pas recherché seulement l’ignoble satisfaction d’humilier des adversaires politiques, il entendait les faire passer pour des assassins. Le bruit était répandu sur toute la route, par des agents bonapartistes, que ces messieurs avaient voulu tuer le prince dans la nuit du 1er au 2 décembre, et qu’ils allaient être jugés ! C’est ainsi qu’au Havre on donna à croire à toute la ville, lorsqu’on embarqua les transportés, que c’étaient des forçats ! Malgré leurs baïonnettes et leurs canons, les conjurés militaires ont toujours tremblé de voir la population se soulever contre leurs forfaits. Au château de Ham, les officiers de la garnison (380 hommes du 48e de ligne), rangés près de la porte d’entrée, saluèrent les prisonniers à mesure qu’ils sortirent un à un des compartiments où ils étaient enserrés depuis Paris. Chacun fut isolément conduit à une chambre par le capitaine Baudot, commandant de place, le chapeau à la main, et par l’officier de garde, accompagnés de cinq soldats, la baïonnette au bout du fusil. Ces deux officiers étaient en proie à une émotion visible. Le capitaine Baudot avait des larmes dans les yeux. Il comprenait évidemment tout l’odieux, toute l’illégalité de sa mission. Comme il exprimait au colonel Charras sa douleur d’avoir à le garder prisonnier, lui surtout qui avait signé sa lettre de commandant de place en 1848, et comme il l’assurait qu’il serait traité avec les plus grands égards, le colonel lui répondit sévèrement : « Tout cela me touche fort peu. Vous ne devez pas oublier que vous vous rendez complice d’un crime ; que vous êtes criminel en vous prêtant à nous retenir prisonniers. » Il ne répliqua rien. Son silence voulait dire : « Oui, c’est un crime ; je le sais bien, mais ma place… » 
Les huit émeutiers parlementaires furent remis au secret le plus absolu jusqu’au 15 décembre, ne pouvant sortir de leur chambre pour quelque raison que ce fût, ni écrire un mot, même décacheté, à leurs parents les plus proches, ni en recevoir une lettre même ouverte. « Il m’est défendu, avait dit le capitaine Baudot, de vous laisser ni encre, ni papier, ni plumes, ni crayons ! » On en usa de même avec les transportés. En vérité, les sauveurs de la famille ont poussé le mépris des plus saintes inquiétudes de la famille jusqu’à ses dernières limites. Mais la nécessité d’État !… Ils accréditaient effectivement, par ces rigueurs, l’opinion qu’ils ne faisaient que se défendre : ils donnaient à croire qu’une vaste instruction se poursuivait, et que les généraux étaient réellement coupables du complot dont on avait eu la déloyauté de faire courir les bruits dans les casernes. Ne serait-ce pas pour le punir de ce complot qu’on plaça M. Lamoricière dans une salle de rez-de-chaussée si humide, que les douleurs rhumatismales aiguës dont il y fut atteint le tenaient encore au lit deux mois après son entrée à Ham ? Le général ne fit entendre aucune plainte, non plus que ses compagnons de captivité. Rien ne put les ébranler, ni les uns ni les autres ; rien ne put leur arracher un mot quelconque adressé aux maîtres de leurs personnes. Pour louer suffisamment l’attitude de tous les vaincus du 2 décembre, il faudrait dire qu’elle fut aussi digne que celle des vainqueurs fut lâchement barbare. Le vieux capitaine Baudot, tout en pleurant, observait sa consigne avec une rigidité faite pour lui mériter la croix de chevalier ou d’officier de la Légion d’honneur. Le beau-frère du colonel Charras, après avoir obtenu l’autorisation de communiquer avec lui, lui écrivit : »J’arrive avec votre sœur ; nous allons assez bien en tant que santé. » Ces douze mots ne furent remis au colonel que le matin du 15 décembre, jour où, le secret étant levé, il put voir sa soeur et son beau-frère ! Les autorisations de communiquer, délivrées par M. Morny étaient fort difficiles à obtenir. Il avait fallu au beau-frère de M. Charras trois jours de démarches, et plusieurs heures d’antichambre chez le secrétaire de M. Morny, pour en obtenir une ! On ne peut imaginer les petites vexations de tout genre que l’on se plaisait à infliger aux victimes et à leurs proches. Le beau-frère et la soeur de M. Charras arrivent à Ham, se croyant suffisamment munis pour le voir tous les jours ; mais le commandant leur déclare tout d’abord que, d’après ses ordres, les permissions ne sont valables que pour une seule visite, si bien que le parent du colonel, homme valétudinaire, est obligé de reprendre la diligence, et d’aller de nouveau faire antichambre chez le jeune M. Lehon, secrétaire de M. Morny, pour lui arracher une permission permanente ! Une circonstance particulière et douloureuse de ces indignités mit en évidence le courage de madame Leflô et l’indomptable énergie de caractère du général. 
Lors de l’arrestation de celui-ci, un aide de camp du ministre de la guerre des insurgés s’était présenté chez madame Leflô pour lui offrir les services de madame Leroy. Il fut éconduit en ces termes : « Sortez, monsieur, sortez tout de suite; vous êtes l’aide de camp d’un misérable ; vous ne pouvez entrer chez moi ; sortez. » Madame Lelô obtint cependant, le 7 décembre, à force d’insistance, ce que dans un pays civilisé, ou ne peut refuser à une femme, la faculté de voir son mari. Enceinte, cruellement éprouvée par les scènes violentes dont elle avait été témoin lors de l’arrestation du général, épuisée à la suite des courses infinies qu’elle avait dû faire, elle oublie toutes ses fatigues et court à Ham. Mais la permission portait Mazas, par erreur, nous voulons bien le croire. Le commandant de place dit que ce n’est pas valable pour Ham, et refuse l’entrée ! Cette inflexibilité de geôlier militaire ne décourage pas madame Leflô. Le soir même, elle retourne à Paris, fait de nouvelles et pénibles démarches, et revient au fort, pourvue d’une permission en règle. Mais tant d’émotions, d’anxiété, de fatigues, dans la situation où elle se trouvait, brisèrent ses forces, l’obligèrent à se coucher en arrivant, et déterminèrent un accident qui coûta la vie à son enfant. Alitée ensuite pendant plusieurs jours, elle ne pouvait voir son mari. A la fin, impatientée, elle demande un brancard à l’hôpital de Ham, se fait mettre dessus, et, portée par quatre hommes, elle se présente à la porte du château, sa permission à la main. Le commandant, fort ému, la laissa entrer, et pensa, cette fois, que la consigne lui permettait d’en référer à ses maîtres. La réponse fut, au bout de quatre ou cinq jours, que M. Leflô pouvait aller voir sa femme en ville, « en restant prisonnier sur parole. » Le capitaine Baudot s’empressa de communiquer cette lettre au général ; mais celui-ci, sans le laisser achever, l’arrêta au mot sur parole. « Capitaine, dit-il, écrivez ce que je vais vous dire, et engagez-vous à le répéter textuellement ; sinon, je me chargerai de ce soin. Je ne donnerai jamais ma parole d’honneur à des gens sans honneur, à des traîtres, à des parjures, à des brigands sans foi ni loi. » Le commandant fit de vains efforts pour obtenir quelque adoucissement à cette réponse, au moins dans la forme ; il fut obligé de la transmettre à son gouvernement. Madame Leflô ne revit son mari que quand elle put marcher. Jusqu’au 8 décembre, les prisonniers furent gardés intérieurement par un poste de soldats. Mais la garnison leur montra assez de sympathie pour devenir suspecte. On leur envoya en conséquence une escouade de gardiens de la prison centrale de Poissy, et c’est en présence d’un de ces hommes qu’ils durent recevoir leurs visites, visites limitées d’ailleurs de midi à quatre heures. Vers le 25, ils virent arriver, pour remplacer les soldats du 48e qui les servaient, trois hommes de la plus mauvaise figure, sentant le crime ou tout au moins la geôle d’une lieue. Chacun des prisonniers eut la même idée sur leur compte. Le général Lamoricière, plus impétueux que les autres, déclara tout net au commandant de place que ces trois hommes étaient des empoisonneurs, et qu’il ne voulait pas qu’ils entrassent chez lui, surtout au moment des repas. Le fait est que c’étaient des condamnés extraits de Poissy. Leur service se borna à espionner. On n’épargna ainsi aux prisonniers de Ham aucun mauvais traitement moral. On s’attacha, on mit un soin tout particulier à ne placer auprès d’eux que des ennemis. Le commissaire de police qui les avait suivis leur était si brutalement hostile, que, dans la salle commune de l’hôtel de ville de la petite ville de Ham, il dit tout haut, à côté de madame Busnel, soeur du général Bedeau : « Ah ! les gredins, nous avons la victoire, ils verront ! » Les conspirateurs ne pouvaient cependant garder indéfiniment ces gredins sous les verrous. M. Roger (du Nord) avait été mis en liberté le 10 décembre, sans que ni lui ni les siens eussent fait aucune démarche. M. Morny s’était à la fin souvenu d’une vieille amitié durant laquelle il avait plus d’une fois puisé dans la bourse de celui qu’il s’était vu forcé d’emprisonner pour sauver la France de l’anarchie parlementaire. Le général Cavaignac avait été élargi le 19. Il fallait ou relâcher les autres ou les faire juger pour crime de conspiration contre le candide président de la République. Le procès parut difficile ; non pas que les conseils de guerre, toujours fidèles à la consigne, n’eussent condamné à-mort tous ces coupables comme tant d’autres, si on le leur avait ordonné ; mais on craignit le scandale. Les Élyséens, jugeant toujours des autres par eux-mêmes, espérèrent pendant quelque temps une lâcheté qui les couvrirait. A tous les parents ou amis des prisonniers qui allaient demander une permission de les voir, on fit entendre uniformément ces paroles : « Si ces messieurs sont encore détenus, c’est qu’ils le veulent bien. Ils n’ont qu’à faire une demande au prince, elle sera favorablement accueillie. » La liberté en échange de déshonneur ! Ce langage n’ayant pas réussi, on en essaya un autre : « Qu’ils demandent seulement à voyager quelques mois, et ils sortiront sur-le-champ. » Quand on reconnut enfin qu’on ne lasserait pas leur constance, on prit le parti de les chasser de France. On ne pouvait moins ; c’était une satisfaction promise aux généraux envieux qui avaient livré l’armée de Paris. Les formes employées dans cette dernière exécution ne furent pas moins blessantes que la captivité n’avait été pénible. Le 8 janvier, sans qu’ils eussent reçu le moindre avis, chacun d’eux entendit verrouiller sa porte à trois heures de la nuit. On les mettait au secret de nouveau. Qu’est-ce encore ? se demandèrent-ils : c’était le secrétaire intime de M. Morny, M. Léopold Lehon, jeune homme de vingt—quatre à vingt-cinq ans, décoré depuis pour cette mission, qui venait les informer individuellement qu’on allait les expédier à l’étranger entre deux agents de police ; celui-ci en Allemagne, celui-là en Angleterre, cet autre en Belgique, etc. M. Léopold se montra embarrassé, contraint, timide, en leur signifiant cet ukase. Le colonel Charras nous peignait ainsi son attitude et sa physionomie : « Ce gaillard-là a toujours regardé ses bottes on me parlant ; je n’ai pas pu voir la couleur de ses yeux ; il ne les a pas même levés lorsque m’ayant dit que son gouvernement se croyait en droit de disposer de moi, je lui répondis : Ce droit-là je le connais, c’est celui de Cartouche et de Mandrin, c’est celui du plus fort. Il ne les leva pas non plus lorsque, après m’avoir offert de me prêter de l’argent de la part de son gouvernement, si je n’en avais pas pour ce voyage subit, je lui répondis que l’argent sorti de pareille source me salirait les mains. » Le lieutenant-colonel Charras a raconté dans la note qu’on va lire comment s’est opéré le dernier acte de violence consommé sur sa personne. Disons d’abord ce qui motiva cette note. Les décembriseurs firent accompagner chacun des prisonniers de Ham par deux agents de police qui avaient ordre de ne pas les quitter jusqu’à leur destination. Ce gouvernement de malappris ne respecte pas même les territoires étrangers. Il prétend donner, hors de France, à ses estafiers, un droit quelconque sur les victimes de ses fureurs. Les ministres belges, MM. Ch. Rogier, Frère et Tesch, durent s’émouvoir en apprenant une telle offense faite aux droits internationaux : ils demandèrent aux bannis s’ils se plaignaient d’avoir été violentés en Belgique par des agents français. La note de notre ami est la réponse à cette demande ; elle explique pourquoi aucun de ces messieurs ne voulut faire une plainte formelle. Il reste à savoir si celui des ministres que la chose concernait plus particulièrement, bien instruit du fait, quoiqu’il n’en fût pas saisi directement par les lésés, ne devait pas à la dignité de la nation belge de demander compte à qui de droit. Note remise le 12 janvier 1852 à M. Verheyen. « Je soussigné, Charras, Jean-Baptiste-Adolphe, lieutenant-colonel de l’armée française, représentant du peuple à l’Assemblée nationale, déclare ce qui suit, sur l’invitation de M. Verheyen, administrateur de la sûreté publique du royaume de Belgique : Le 8 janvier à quatre heures et demie du matin, un individu qui, en réponse à ma demande, se dit être le chef du cabinet du ministre de l’intérieur, entra dans ma chambre au château de Ham, où j’étais retenu prisonnier, et m’annonça que j’allais être extrait de cette prison, et conduit à la frontière de terre ou de mer que je désignerais. Je lui répondis que je n’avais à faire aucune désignation de genre ; qu’enlevé violemment de mon domicile, le 2 décembre au matin, au mépris de la loi, incarcéré dans une prison de Paris, au mépris de la loi, transféré et retenu prisonnier au château de Ham, au mépris de la loi, je ne pouvais accepter du gouvernement de fait qui opprime mon pays qu’une seule chose la liberté sans condition d’aucune sorte ; ce qui serait une faible réparation des crimes commis contre moi par ordre de M. Bonaparte et dans son seul intérêt. Après un échange de paroles inutiles à reproduire ici, cet individu m’ayant assuré que ma mise en liberté sans condition était absolument impossible, que j’étais banni de mon pays par la volonté de M. L. Bonaparte, j’ajoutai : Je persiste dans mon refus de désigner aucune frontière, et je déclare ne vouloir sortir d’ici que sous l’empire de la force. Peu après je fus placé au fond d’une voiture de poste avec un agent de police à ma droite, un agent de police devant moi, et je fus conduit ainsi, rapidement, à Noyon, où l’on me fit entrer dans un waggon du chemin de fer. De Noyon nous allâmes à Creil ; et, dans cette dernière ville, on me fit prendre un convoi qui se dirigeait de Paris sur la Belgique par Valenciennes. A Valenciennes, je fus retenu de deux heures du soir à trois heures du matin par suite d’une méprise des autorités locales. Ce temps d’arrêt fut cause de ma réunion avec le général Changarnier, extrait comme moi, le matin, du château de Ham et conduit par deux agents de police français. « Pendant ce séjour forcé, j’appris des agents qui m’escortaient, et à qui je n’avais pas adressé la parole jusque-là, qu’ils devaient m’accompagner jusqu’à Bruxelles ! Je leur fis observer qu’ils se trompaient, sans doute, qu’ils avaient mal compris leurs ordres, qu’ils ne pouvaient exercer aucune autorité sur le territoire d’une nation indépendante. Mais ils persistèrent dans leurs affirmations. Prenez garde, leur dis-je alors ; si, la frontière une fois passée, je réclame la protection du premier gendarme, du premier bourgmestre venu, vous serez arrêtés et incarcérés comme coupables de violence envers moi et d’une violation de droit international. A cette observation, voici la réponse textuelle qui me fut faite par celui des deux agents qui était officier de paix, c’est à dire le plus élevé en grade : Mon colonel, je suis plein de respect pour vous ; je me ferais tuer à vos pieds plutôt que de vous laisser enlever un cheveu de la tête ; mais si vous faisiez la moindre tentative pour réclamer la protection des autorités belges, j’ai l’ordre de m’y opposer par tous moyens, même en allant aux extrémités de la violence contre vous. Je dois vous conduire jusqu’à la gare du chemin de fer à Bruxelles ; je vous y conduirai quoi qu’il arrive. Le général Changarnier a entendu ces paroles comme moi. Le 9 janvier, à 3 heures du matin, je partis de Valenciennes par le chemin de fer, toujours escorté par les mêmes agents de police. A la station de Quiévrain, je retrouvai le général Changarnier escorté aussi de ses deux agents, et je rencontrai M. Baze sous pareille escorte. Ce dernier, parti de Ham douze heures après moi, me dit qu’il était conduit à Aix-la-Chapelle. Il y avait là un officier de gendarmerie belge. Je n’aurai eu qu’un mot à dire, je n’en ai jamais douté, pour me trouver débarrassé de mon odieuse escorte, mais là, non plus qu’à aucune autre station, je n’ai voulu réclamer le secours des autorités belges contre la violence dont j’ai été l’objet et je ne l’ai pas voulu par cet unique motif : j’étais proscrit, j’étais forcé de venir demander un asile à la générosité de la nation belge, il ne me convenait pas de faire une démarche qui pouvait devenir l’origine d’un différend entre le gouvernement français et le gouvernement belge. Aujourd’hui encore, je persiste dans cette résolution. Arrivé à la gare de Bruxelles, mes deux agents me saluèrent et me laissèrent libre. Fait à Bruxelles, le 11 février 1852. Signé : CHARRAS. « P. S. : J’oubliais de dire que l’un des agents était porteur d’un passe-port qui me désignait sons le nom de Vincent, et qui était signé par le ministre des affaires étrangères de M. Bonaparte ! » Nous avons su qu’il en fut de même pour M. Baze. « A la frontière, disait-il devant M. Madier-Montjau, je prévins mes surveillants de l’intention où j’étais d’en appeler, dès que je serais sur le territoire belge, à l’autorité du pays pour me délivrer d’eux ; ils me firent entendre que j’aurais à le regretter ; qu’ils avaient ordre de ne me laisser qu’à Aix-la-Chapelle et qu’ils suivraient leur consigne. Après y avoir réfléchi, je ne voulus pas être la cause d’un conflit entre le gouvernement belge et le gouvernement français ; je craignais aussi de nuire, par là, aux réfugiés français en Belgique. A Aix-la-Chapelle, la police fit des difficultés. Elle ne voulait rien décider sans avoir consulté son gouvernement par le télégraphe. J’appris, an milieu de ce débat., que Fouquier, l’un de mes surveillants, avait un passe-port au nom de Lasalle, sur lequel ma famille et moi étions inscrits comme faisant partie de sa suite ! Je demandai à être ramené à Louvain, mais Fouquier me répondit avec impatience : « Ma foi ! ma mission est terminée, arrangez-vous comme vous voudrez. » Les décembriseurs ont certainement le vertige. Ils poussent la folie de l’arbitraire jusqu’à transporter, dans telle ou telle ville déterminée de la Belgique ou de l’Allemagne, les hommes qu’ils expulsent, comme si ces hommes ne pouvaient pas, une heure après leur délivrance, aller où il leur plait ! Les choses se passèrent à peu prés ainsi pour les généraux Bedeau, Lamoricière, Changarnier et Leflô. On les vit, comme leurs collègues MM. Charras et Baze, menés hors de France sous des noms supposés, entre deux misérables officiers de la rue de Jérusalem, qui ne cachèrent point qu’ils avaient mission d’employer les derniers moyens de la force s’ils trouvaient la moindre résistance ! Malgré de pareilles façons d’agir, M. Léopold, affectant une certaine déférence pour ces illustrations militaires, leur avait dit « que le gouvernement voulait avoir pour eux tous les égards dus à leur caractère. » « Oh! vos égards, je les connais, répondit le général Bedeau dédaigneusement; vous avez mis la main de vos agents de police sur ma personne pour m’arracher de chez moi comme conspirateur, tandis que vous seuls étiez les conspirateurs. » Le brave général aurait pu ajouter : « Vous, les amis de la religion, vous m’avez ensuite ridiculisé dans vos journaux ; parce que j’ai des sentiments religieux, vous m’avez fait passer pour un moine en prière du matin au soir. » Quel triste retour ne durent pas faire sur eux-mêmes les généraux et M. Baze en se rappelant, au milieu de celle longue suite d’odieuses persécutions terminées par l’exil, qu’ils avaient, eux aussi, après juin 1848, emprisonné et transporté sans jugement des milliers de leurs concitoyens ! Ceux des représentants arrêtés préventivement, que l’on ne conduisit pas à la forteresse de Ham, restèrent à Mazas pendant dix-sept jours, au secret le plus rigoureux, sans la moindre nouvelle de ce qui se passait, de ce qu’étaient devenus leurs amis, la république, tout ce qui les intéressait. « Je ne crois pas, nous a raconté notre honorable collègue M. Nadaud, qu’il y ait de plus vives tortures que celles que je subis pendant les six premiers jours de ma détention au secret. En approchant me table au-dessous de la petite croisée de ma cellule, et en plaçant ma chaise dessus, je pouvais apercevoir par côté plusieurs maisons. Elles étaient habitées par des ouvriers. Je les reconnus à leurs blouses. Toute la journée du mercredi 3 et toute celle du jeudi 4, ils restèrent tranquillement accoudés sur leurs balcons à regarder dans la rue et à causer avec leurs femmes. Cette tranquillité me désolait. Ils ne comprennent donc pas, me disais-je, car ils ne sont pas des lâches ! Le soir du 4, je tombai dans un abattement profond, et la fièvre ne me quitta pas de quarante-huit heures. » |