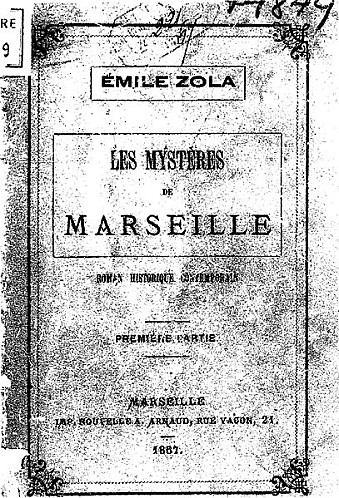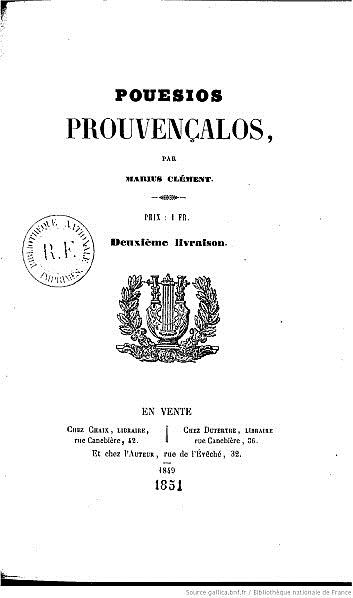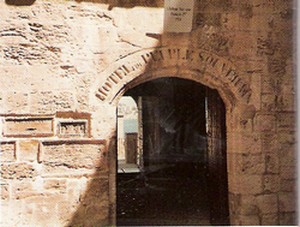Marseille Juin 1848 par René Merle, janvier 2012 
Alors qu’en Juin 1848, Paris était secoué par une formidable insurrection populaire, Marseille fut la seule ville française qui connut des journées vraiment insurrectionnelles, sans pour autant être dans le sillage de la capitale : l’insurrection marseillaise précède d’un jour celle de Paris.
Un parallèle formel entre les deux insurrections serait bien vain tant leur réalité est différente : Paris dépasse les 1.250.000 habitants, les combattants s’y comptèrent par dizaines de milliers, les victimes par milliers. Marseille frôlait les 200.000 habitants, les combattants s’y comptèrent par centaines, et les victimes par dizaines. Paris de la Monarchie de Juillet avait une longue tradition d’émeutes et d’insurrections. Marseille n’avait pas connu de tels combats depuis la période révolutionnaire. À Paris, la répression fut sauvage, les insurgés prisonniers furent fusillés par centaines, alors que les insurgés marseillais capturés furent emprisonnés sans règlements de comptes a posteriori. Enfin, et surtout, ce fut l’ensemble de l’Est parisien populaire qui se souleva, (et les femmes n’y furent pas les dernières), alors que l’insurrection marseillaise fut seulement le fait de quelques centaines de combattants (aucune mention de participation féminine), sans que Marseille populaire les suive vraiment.
Pour aider les non-Marseillais à localiser les rues et places dont il va être question, signalons qu’au lendemain des événements fut dressé par Jean-Baptiste Fortuné Lavastre un plan en relief des lieux touchés par l’insurrection. Le plan a aujourd’hui disparu [une lectrice nous signale en mars 2017 qu’il est actuellement exposé au Musée d’Histoire de Marseille], mais il a donné matière à un film d’Alain Dufau et Marie-Christine Bouillé, superbe évocation en images de ce Marseille d’antan : Le cœur éclaté, 33′, 1990 : http://www.carnetdeville.org/les-fiches-films/le-c-ur-eclate.php
On pourra suivre le déroulement de l’insurrection en consultant par exemple le plan de Marseille en 1840.
On y verra que la Canebière est beaucoup plus courte qu’aujourd’hui : du port à la hauteur de Noailles. L’étroite rue de Noailles la séparait de la promenade des Allées de Meilhan, aujourd’hui incluse dans le haut de la grande artère est-ouest du centre-ville.
Mais venons-en aux faits.
Cette insurrection marseillaise de juin 1848 a été souvent présentée, notamment, cinquante ans après, par le très conservateur Pierre de la Gorce, Histoire de la Seconde République française, T.I, Paris, Plon, 1898, et, plus près de nous, par l’Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, Tome V, Vie politique et administrative, Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1929.
À la différence des événements de Rouen et de la région lyonnaise, elle a été à peine abordée lors du cent-cinquantenaire de 1848 (cf. 1848, Actes du colloque international du cent cinquantenaire (1998), Société d’histoire de la Révolution de 1848, Paris, CREAPHIS, 2002). C’est peut-être dire que pour les historiens, la recherche semble épuisée (si tant est qu’elle le soit jamais). Il serait prétentieux ici de prétendre l’approfondir. On trouvera seulement dans cette série d’articles des documents, et des réflexions, sur le déroulement des journées marseillaises et sur ce que nous pouvons savoir des insurgés : mon propos est de fournir aux amis de l’Association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines, et plus largement aux démocrates méridionaux, matière à réflexion sur notre passé.
Les textes que l’on va lire ont été rédigés entre 1848 et 1851, à l’exception du texte de Zola, postérieur de dix-neuf années. Leur entrecroisement institue un « réel » qui n’a peut-être pas vraiment été tout à fait celui de l’événement, mais qui témoigne de la réalité d’une réception, énoncée dans la condamnation haineuse, dans la surprise distanciée, voire dans l’affleurement de l’excuse, jamais vraiment dans l’approbation. Les Marseillais peuvent le compléter par un regard sur la presse locale du temps, (Bibliothèque municipale), qui donna chronique détaillée.
L’opinion nationale a pu prendre connaissance, « à chaud », de l’insurrection marseillaise, par ces feuilles présentant depuis la capitale, au jour le jour, les nouvelles de l’insurrection parisienne, feuilles reprises par de nombreuses imprimeries de province. Certaines traitent de Marseille. Ainsi cette courte brochure, Extrait des journaux de Paris. Récits des événements arrivés à Paris et à Marseille. Mézières, Defarge, 27 juin 1848 :
» Troubles à Marseille. À peu près en même temps que des barricades s’élevaient à Paris, de semblables tentatives avaient lieu à Marseille. Le jeudi 22 [un jour donc avant Paris] , à 9 heures, des colonnes d’ouvriers qui avaient abandonné les ateliers nationaux [créés par la municipalité, ces ateliers employaient une dizaine de milliers de travailleurs à la construction de la corniche à partir du Prado, et sur d’autres chantiers communaux], descendirent vers la préfecture [« descendirent » est justifié, car la colonne, initialement formée d’ouvriers travaillant au canal qui devait amener l’eau de la Durance à Marseille, descendit des hauteurs de Saint-Charles vers la Préfecture] ; d’autres se dirigèrent vers quelques ateliers particuliers [notamment l’usine de mécanique Taylor] et au chemin de fer, [La gare Saint-Charles est embryonnaire : c’est en 1848 qu’est achevée la ligne Avignon-Marseille, que l’on prolonge aussitôt vers Toulon] et entraînèrent, bon gré mal gré, tout ce qui s’y trouvait. À la place Saint-Ferréol [devant la Préfecture, au proche sud de la Canebière], ils furent repoussés par la garde nationale et la troupe de ligne. La place aux Œufs et une partie des vieux quartiers se couvrirent de barricades [La place aux Œufs, (place Janguin ou Jean Guin) était au cœur du vieux quartier, plus tard démoli, situé derrière la Bourse, au nord immédiat de la Canebière. Aujourd’hui centre commercial et musée des vestiges]. Vers cinq heures, les barricades de la place aux Œufs furent enlevées par l’artillerie. Il a fallu non seulement emporter les barricades, mais faire le siège des maisons d’où pleuvaient toutes sortes de projectiles, et dont les fenêtres étaient autant de meurtrières. Les sapeurs, dit un journal de la localité, furent appelés pour enfoncer les portes des maisons, au milieu d’une grêle de tuiles et de briques qui tombaient de toute part. Chaque maison a donné lieu à une espèce de siège. Les insurgés se sont réfugiés dans les caves, dans les cheminées et jusque dans les puits. C’est dans ce moment que la troupe de ligne a eu à déplorer la mort du brave capitaine Devillier, d’un commandant, d’un sergent et d’un fourrier du 20e de ligne. Parmi ces victimes se trouve une jeune personne qui, par une imprudente curiosité, ayant entr’ouvert une fenêtre d’où venaient de partir quelques coups de feu, a été tuée sur le coup. Plus de 50 prisonniers ont été faits à la suite du siège des maisons dont nous venons de parler ; un assez grand nombre d’insurgés tués pendant la fusillade, y ont été trouvés. En peu d’instants, les barricades ont été enlevées ; de forts piquets de garde nationale et de ligne ont occupé la place ; les perquisitions ont continué jusqu’à la nuit dans les maisons voisines et ont amené la découverte d’un certain nombre d’insurgés qui n’avaient point été trouvés à la première visite. Vers le soir, de fortes barricades existaient encore à la place Castellane et au bout de la rue Paradis [au sud immédiat de la préfecture] ; les insurgés paraissent avoir concentré sur ce point toutes leurs forces ; ils ont fait de la barricade Castellane une espèce de camp retranché, où ils ont, dit-on, l’intention de se défendre aujourd’hui. En ce moment l’artillerie se rend sur les lieux avec du canon, pour en finir, si les insurgés ne comprennent pas l’inutilité de leur tentative.
Le « Courrier de Marseille » ajoute : P.S. – 10 heures. – Les barricades élevées à la place Castellane viennent d’être enlevées ; un assez grand nombre d’émeutiers ont été arrêtés. On nous annonce à l’instant que de nouvelles barricades s’élèvent à l’extrémité des Allées de Meilhan. [fausse nouvelle] Les bataillons de la ligne attendus sont arrivés et ont été salués par les acclamations de toute notre population. M. Bourrillon, commissaire de police, a reçu à la place aux Œufs, en faisant des sommations, une blessure qui a nécessité l’amputation du bras. Le général Ménard-Saint-Martin, commandant la garde nationale, a reçu trois blessures ; il a une joue sillonnée par deux chevrotines ; ses blessures n’offrent aucun danger. Trois proclamations de M. Emile Olivier [sic, pour « Ollivier »], préfet des Bouches-du-Rhône, [le tout jeune avocat parisien Émile Ollivier (né en 1825), fils du républicain marseillais « de la veille » et représentant du peuple Démosthène Ollivier, avait été nommé par le ministre de l’intérieur Ledru-Rollin] n’ont pu arrêter les insurgés. Des troupes sont dirigées en toute hâte sur Marseille. «
On le voit, ce rapide récit factuel pointe la nature jugée exclusivement ouvrière de l’insurrection, sans en donner les raisons. Ce texte est également silencieux sur les dissensions au sein de la garde nationale, qui joueront un grand rôle dans le basculement de la manifestation à l’insurrection. Nous y reviendrons. Mais, en bonne logique chronologique, commençons par présenter les raisons et le déroulement de la manifestation ouvrière qui descendit de Saint Charles vers la préfecture, au matin du 22 juin. La manifestation du 22 La manifestation du 22 juin au matin n’eut rien d’une levée en masse spontanée. Elle était proposée depuis plusieurs jours par les plus combatifs des ouvriers mécontents. Mais son principe avait été écarté, grâce aux efforts conjugués du jeune préfet Émile Ollivier et des délégués des corporations concernées. On mesure, à la lecture de l’instruction du procès, combien étaient étroits les contacts, voire les liens, entre le préfet démocrate œcuménique et les délégués ouvriers, républicains modérés, et, partant, la rapide coupure avec une base ouvrière impatiente.
Voici ce que l’on peut en lire dans Cour d’Assises de la Drôme. Procès des accusés de juin de Marseille, Marseille, imprimerie nationale – association d’ouvriers, 1849 (ouvrage publié d’abord en fascicules pendant le déroulement du procès, dans l’été 1849, puis en livre) :
» – Bertrand, président de la corporation des maçons : [il s’agit des nombreux maçons employés sur le chantier qui devait amener à Marseille les eaux de la Durance. Initié en 1838, le projet aboutira en novembre 1849 à l’arrivée des eaux près de la gare, au plateau Longchamp, qu’il faudra ensuite aménager] A la suite du décret de l’Assemblée nationale, sur les heures de travail, [En mars 1848, le gouvernement avait fixé la longueur de la journée du travail à 10 h à Paris, et à 11 h en province. Sous la pression ouvrière, le préfet Ollivier avait décidé que la journée serait de 10 h à Marseille. Appliquée dans les ateliers nationaux (municipaux), cette disposition était ignorée par de nombreux patrons privés. Puis en juin, l’assemblée décide de maintenir impérativement les 11 h de travail pour tous, en dépit de l’arrêté du préfet] cette question agita de nouveau les ouvriers. Dans une réunion à la préfecture, où des explications très vives furent échangées, il fut convenu que les délégués viendraient prendre communication de la réponse du ministre à la demande que devait lui adresser à ce sujet M. Emile Ollivier. Un citoyen que je ne connaissais pas, demanda ce qu’il faudrait faire, si la réponse du ministre était négative, – pétitionner, répondit M. E.Ollivier. – Et si les pétitions sont repoussées ? – Alors il serait toujours temps de faire une manifestation. On attendit quelque temps, et cette réponse n’ayant pas été satisfaisante, il fut décidé qu’on ferait une pétition ; à cet effet on obtint de M. le maire Baux une salle communale, pour s’y réunir dans les deux soirées des 20 et 22 juin ; je ne me trouvai pas à la réunion du 20, mais la corporation y était représentée par Audibert, et par un autre délégué. Audibert me rapporta que, sur les paroles de M.Masnou, [ou Masnoux, secrétaire du préfet] l’assemblée, à une forte majorité, avait renoncé, quant au présent, au projet de manifestation, elle s’ajourna au jeudi 22, pour s’occuper de la pétition.
Le lendemain, ayant appris de divers côtés que la manifestation avait été résolue [mais par qui ? quelle est l’origine exacte de ce débordement des délégués ? Le délégué se garde d’y répondre. Nous y reviendrons. Le but en tout cas demeure le même que celui de la pétition : faire pression pour assurer le maintien et l’exécution complète de la décision d’Ollivier], je cherchai à m’enquérir de ce qui avait pu se passer, et l’on me dit que le secrétaire Masnou avait dit à Audibert, délégué, qui avait été le trouver à cet effet : « tâchez d’empêcher, à tout prix, la manifestation, et si vous ne pouvez pas, faites qu’elle soit calme et digne. » (« Cour d’Assises », op.cit)
« – Audibert, délégué des maçons [du même chantier du canal] :
Un arrêté de M. le préfet E.Ollivier fixa la journée des ouvriers à dix heures de travail, et cela à la demande et au grand contentement de leurs délégués, dont je fesais (sic) partie. Plus tard, les patrons refusèrent de l’exécuter, en s’appuyant sur le nouveau décret de l’Assemblée nationale. Cette résistance produisit une grande agitation parmi les ouvriers.
Le 11 juin eut lieu une assemblée des délégués qui se rendirent en cortège à la préfecture, et y demandèrent avec quelque vivacité, à M. le Préfet, d’écrire au ministre de l’Intérieur, pour en obtenir l’assimilation des ouvriers de Marseille à ceux de Paris. Pendant la semaine suivante la fermentation s’accrut, et les ouvriers commencèrent à perdre leur confiance, et dans M.E.Ollivier et dans leurs propres délégués. Cependant M. le préfet avait écrit au ministre, et avait promis de faire dresser des procès-verbaux contre les patrons.
Le 18, nous nous rassemblâmes pour aller recevoir la réponse que M. le préfet devait avoir reçue du ministre, et lui faire part des soupçons dont nous étions tous les objets. Il nous communiqua alors la réponse négative du ministre, dont il nous confia l’original, en nous priant de ne la communiquer qu’aux délégués pour que les patrons n’en fissent pas une nouvelle arme.
Le 20, avec l’autorisation du maire, nous nous réunîmes à la salle des Prêcheurs, pour y lire la lettre du ministre et délibérer sur la question de savoir si nous ferions une pétition ou une manifestation. M. Masnou [secrétaire du préfet], invité à y venir, s’y présenta, il y parla avec chaleur contre la manifestation. D’autres la combattirent aussi. Elle fut rejetée à une grande majorité. On se sépara alors pour se réunir, le 22 au soir, au même lieu, avec l’autorisation du maire, à l’effet de signer la pétition.
Le 21, l’agitation et les soupçons des ouvriers augmentèrent, et d’autant plus qu’ils étaient entretenus et fomentés par des inconnus, se disant ouvriers, et que nous n’avons plus revu après le désordre. [toujours cette interrogation sur l’identité des « meneurs »] Le soir, nous apprîmes que les ouvriers étaient convoqués [par qui ?] pour prendre part, le lendemain, à la manifestation. Je fus envoyé à la préfecture pour en prévenir M. E.Ollivier et prendre ses conseils. Il était huit heures et demie du soir. Je ne trouvai que M. Masnou, qui répondit qu’il fallait l’empêcher à tout prix, mais que si force restait aux ouvriers, nous devions nous placer à la tête pour la disperser, ou éviter tout désordre.
A dix heures et demie nous transmîmes cette réponse aux délégués, réunis à la place Montyon, et il fut convenu que nous ne céderions qu’à la force. On se sépara. » (« Cour d’Assises », op.cit). Question évidente donc, qui convoque à cette manifestation dont ne veulent ni le préfet ni les délégués ouvriers ? Qui peut organiser et stimuler l’évidente exaspération d’une partie des travailleurs marseillais ?
Dans la presse marseillaise du temps, et dans toutes les présentations qui suivirent des journées du 22 et du 23 juin, revient le leitmotiv du rôle des « agitateurs » politiques, qui utilisèrent les revendications strictement professionnelles des ouvriers. Ainsi de ce texte du très conservateur publiciste marseillais Théophile Bosq, pâle littérateur qui se voulait poète :
Notice sur le plan en relief exécuté par M.Lavastre suivie d’un précis des événements des 22 et 23 juin 1848 par T.B, Marseille, Clappier, 1850.
» Pour l’intelligence complète du plan dressé par M.Lavastre, nous allons rapidement esquisser l’histoire de ces jours à jamais célèbres et déplorables des 22 et 23 juin, où des barricades se dressèrent pour la première fois sur le pavé de notre cité. Journées sanglantes, pendant lesquelles la fusillade éclatait et de généreux citoyens payaient de leur vie ou de leur sang leur beau dévoûment (sic) à la cause de l’ordre, de la civilisation et de la liberté.
On se souviendra longtemps du lugubre aspect de Marseille pendant ces scènes désastreuses. Au mouvement de nos rues, au concours des citoyens, à l’éclat de nos opulents magasins avaient succédé la solitude et le deuil. Toutes les maisons demeurent fermées, quelques rares passants circulent sur la voie publique gardée, sur plusieurs points, par les troupes de ligne et la garde nationale. Tout annonce que notre ville est sous le poids d’une de ces grandes calamités qui font époque dans les fastes d’une population.
Comment ce malheur vint-il s’abattre sur la ville ? Comment, au milieu de cette population laborieuse, active, souffrant du contre-coup des événements de Février, mais attendant avec résignation un temps meilleur ; comment, par quelles causes la révolte a-t-elle éclaté ? La cause première se rattache à la grande insurrection qui éclatait le même jour à Paris et dans quelques villes des départements. [Bosq, on le voit, prend ses aises avec la chronologie] Nul doute que de mystérieux agitateurs ne se fussent glissés au milieu des ouvriers ; mais ils eurent le soin de cacher leur but sous un prétexte spécieux et capable de séduire les brigades de travailleurs enrôlées pour les travaux du canal. »
Sans tomber dans cette dichotomie facile et dans la théorie du complot, on doit constater que le rôle de certains clubistes (qui pouvaient en même temps être des ouvriers directement concernés) paraît évident. – Déclaration de Caire, commissaire de police. Il rappelle d’abord l’agitation causée par l’arrivée des jeunes volontaires parisiens de la Légion italienne [Arrivés le 12 juin ; le consulat sarde leur refuse le passeport. Ils sont à la charge de la municipalité qui les nourrit et les loge ; le 18, accompagnés de 500 ouvriers, ils envahissent la préfecture pour demander assistance ; ils sont aussi répandus dans les clubs où ils développent les thèses de Barbès]. « Les clubs devinrent plus ardents. On y faisait l’apologie de Barbès, de Raspail, etc. etc. Le 21 au soir, à l’issue du Club, [il ne dit pas lequel] une promenade populaire eut lieu ; à 11 heures du soir, 1500 personnes étaient réunies, on chanta la Marseillaise et on força tout le monde à s’agenouiller. Il était facile de comprendre que le lendemain était un jour marqué pour une démonstration sérieuse. Les rapports de police le confirmaient. » (« Cour d’Assises », op.cit). Autre déclaration intéressante, celle d’une figure marquante dans la nébuleuse des clubs démocrates marseillais :
» M. Caillat, Stanislas, avoué à Marseille, rue Venture, 12, dépose à peu près en ces termes :
J’étais président du club de la Fraternité [club démocrate avancé… mais modérément. C’était le club de Victor Gelu] ; je devins ensuite président du club de la Démocratie, dans lequel s’était fondu le premier. Nous voulions éclairer le peuple et lui donner l’instruction qui pouvait lui manquer. On avait organisé plusieurs cours : cours d’histoire, de musique, de principes républicains ou de République. J’étais chargé de ce dernier cours.
Le 21 juin, vers les 10 heures, je fus au club ; la séance était commencée. Pons la présidait. Je vis plusieurs personnes étrangères à la réunion. On me dit que c’étaient des volontaires parisiens engagés pour la cause italienne. L’un d’eux monta à la tribune, parla de Barbès, de l’impôt progressif, etc. Ses paroles furent applaudies.
Un Marseillais proposa d’accompagner les volontaires parisiens qui devaient partir.
Une autre personne monta à la tribune et dit que M. le préfet Ollivier voulait bien que les ouvriers n’eussent que 10 heures de travail par jour, comme il l’avait déjà lui-même réglé, qu’il ferait tous ses efforts pour faire maintenir cette mesure, mais qu’il conviendrait de faire dans ce sens une manifestation imposante par le nombre.
M. le président au témoin : Savez-vous quelle était la personne qui parlait ainsi ?
Le témoin : je l’ignore. [même prudence que les délégués ouvriers devant le tribunal ; on ne sait pas, ou on ne veut pas dénoncer…] M. le procureur-général : il est bien étrange que son nom n’ait pas été inscrit sur le procès-verbal de la séance.
Le témoin : nous étions alors 2.500 dans le club. Il était impossible de retenir le nom de tous ceux qui s’élançaient à la tribune ou prenaient la parole. Si MM. de la cour ont assisté à quelque séance de club (M.le président fait un signe de dénégation [le signe vaut son pesant de moutarde !]), ils sauraient que cela est impossible.
M. Caillat continue ainsi :
On prit deux délibérations : la première, portant que le lendemain à 11 h. on accompagnerait les volontaires parisiens ; la seconde qu’à 8 heures ½ on ferait une manifestation se rendant à la préfecture. » (« Cour d’Assises », op.cit) Si Caillat n’avait pas pu tenir ses troupes dans cette soirée, on imagine quelle pouvait être l’atmosphère dans les clubs clairement d’extrême gauche, où se recrutaient les hommes des quatre compagnies de la garde nationale un peu vite baptisées « compagnie des Tirailleurs ». (On verra quel sera leur rôle le 22 au matin, sur la Canebière). Au lendemain des événements, les chefs de ces clubs les plus « rouges », notamment celui des Amis du Peuple et surtout celui des Montagnards (que le préfet s’empressera de dissoudre le 23 juin), seront accusés de s’être réunis le 21 au soir, rue d’Aubagne, pour appeler à la manifestation du lendemain matin.
Les délégués ouvriers n’ignorent donc plus maintenant que les partisans de la manifestation se sont donnés rendez-vous au petit matin, sur un chantier du boulevard Chave (au sud-est immédiat du haut de l’actuelle Canebière : ce secteur était depuis 1830 en voie d’urbanisation par le promoteur Chave). La police ne l’ignore pas non plus. – déposition de Caire, commissaire de police : « Le 22 au point du jour, on prit quelques dispositions militaires, d’abord sur la place Saint-Ferréol. On sut ensuite qu’une réunion tumultueuse se formait au boulevard Chave. Un commissaire de police vint calmer les ouvriers qui refusèrent de l’entendre. » Le commissaire insiste sur le fait que la réunion était strictement revendicative : les ouvriers exigent l’application du décret Ollivier sur les 10 h de travail. (« Cour d’Assises », op.cit) – « Jules Chazal, délégué des selliers, dépose : Le soir il y eut réunion sur la place Monthyon, il y fut convenu que si on ne parvenait pas à empêcher la manifestation, nous serions en tête pour la diriger. Le 22, à cinq heures du matin, j’étais au boulevard Chave, lorsqu’arrivèrent, entr’autres délégués, les accusés Bellet et Prevost [Bellet est délégué de l’usine métallurgique Taylor, Prévost est délégué des menuisiers travaillant sur le chantier communal de la corniche, au Prado], pour nous annoncer que les ouvriers de l’usine Taylor ne donneraient pas et qu’ils travailleraient ; dans ce moment survint un individu qui annonça aux ouvriers de ce chantier que cinq cents de leurs camarades les attendaient à la gare.
Pour nous assurer de la vérité du fait, les délégués mécaniciens se rendirent à la gare ; mais avant qu’ils fussent de retour, les ouvriers se mirent en marche. » (« Cour d’Assises », op.cit)
– Audibert, délégué des maçons du chantier du canal : « Le 22 au matin, après avoir parcouru les chantiers communaux, quatre à cinq cents individus débouchèrent à la gare et sommèrent les ouvriers de se joindre à eux, et notamment les délégués, qu’ils voulaient porter, s’ils ne marchaient pas. Nous cédâmes à cette violence et nous acheminâmes, drapeau [tricolore] en tête. Il était neuf heures. » (« Cour d’Assises », op.cit)
« – Jules Chazal, délégué des selliers :
A neuf heures, un rassemblement tumultueux arrivait à la gare ; nous protestâmes, il nous fut répondu que si nous ne marchions pas vifs on nous y porterait morts.
La colonne s’ébranla, arrivée au bas de la rue Noailles, M. Picard, [secrétaire de la préfecture] qui était venu à notre rencontre, nous dit : vous n’avez donc pas pu l’empêcher ; il nous déclara que la rue Saint-Ferréol était barrée par la troupe, et que nous ne pourrions pas passer. » (« Cour d’Assises », op.cit)
« – Me Thourel [le principal avocat des accusés. Avocat à Aix, ce démocrate socialiste sera emprisonné en 1850 pour sa participation supposée au « complot de Lyon »] raconte les efforts incroyables tentés, dès le matin du 22, par les délégués, Prévost, Bellet, Remy, Tresseau, Chazal, Audibert, pour s’opposer à la manifestation, trois fois désorganisée, enfin victorieuse de leur résistance. Fidèles aux engagements pris, ces braves délégués font ranger la colonne, forte seulement de quelques centaines d’hommes, dans l’ordre le plus parfait, ils se placent à sa tête et elle s’avance avec un calme et une dignité qui semblaient lui présager une réception plus fraternelle. A l’appui de son récit, Me Thourel cite les paroles suivantes du témoin Pourcal : « je vis, vers neuf heures et demie, un attroupement d’ouvriers, d’environ 1000 à 1200, portant un drapeau [tricolore] venant de la rue de Noailles, et après avoir pris la Canebière, entrer dans la rue St-Ferréol, ils étaient sans armes et marchaient en silence, sans cris ni chants aucun. » (« Cour d’Assises », op.cit)
Sans pour autant gagner la totalité des travailleurs du chantier du canal, les partisans de la manifestation en ont cependant rallié une bonne partie, et le trouble est semé parmi les autres, dont beaucoup « descendront » ensuite aussi en ville.
– Bertrand, président de la corporation des maçons : « Dans la matinée du 22, sur une invitation écrite de M.l’ingénieur Montricher [initiateur et responsable des travaux du canal de la Durance], je dus me rendre à l’atelier où je dirigeais quatre cents ouvriers, auprès desquels, je fis tous mes efforts pour les empêcher de se joindre à la manifestation, malgré les diverses provocations dont ils furent l’objet. Je n’y réussis qu’en partie ; tout le reste de la journée, je l’employai à calmer les ouvriers et à empêcher les collisions. » (« Cour d’Assises », op.cit) La manifestation vue par Zola 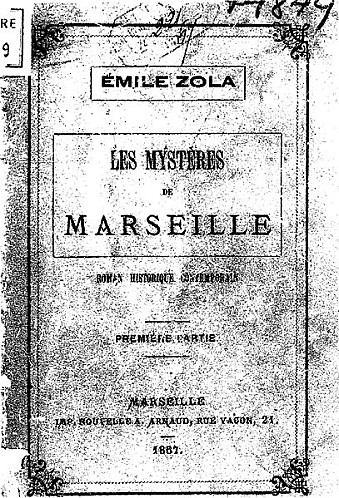
En 1867, le jeune Zola donne en feuilleton dans Le Messager de Provence un ouvrage alimentaire, mais solidement documenté, aussitôt publié en livre : Émile Zola, Les mystères de Marseille, roman historique contemporain, Marseille, Arnaud, 1867, ouvrage bientôt porté au théâtre. Ce mélodrame a pour arrière-plan le Marseille de 1848 et les journées insurrectionnelles de juin en sont un moment-clef.
Voici donc la description de la manifestation du 22 juin (chapitre 14), où l’on rencontre déjà le souffle puissant qui animera l’évocation de la colonne insurgée de 1851 dans La fortune des Rougon, puis de la manifestation de Germinal…
« Pendant que Mathéus suivait Fine et allait prévenir M. de Cazalis, la colonne des ouvriers descendait vers la Cannebière (sic). Cette colonne, partie de la gare du chemin de fer, n’était alors composée que de quelques centaines de travailleurs ; mais, à mesure qu’elle s’avançait, elle recrutait tout le peuple qui se trouvait sur son passage. Des hommes et des femmes, la population flottante des rues était entraînée par ce torrent de foule qui se précipitait des hauteurs de Marseille. Lorsque la manifestation déboucha de la rue Noailles, elle s’étendit au bas du Cours comme un flot formidable. Il y avait là des milliers de têtes qui s’agitaient avec un large balancement, pareilles aux vagues d’un océan humain. Un bruit sourd, confus, semblable à la voix rude de la mer, courait dans les rangs de cette foule. D’ailleurs, elle avait un calme effrayant. Elle avançait, sans pousser un cri, sans commettre aucun dégât, sombre et muette. Elle tombait, elle roulait sur Marseille, elle semblait ne pas avoir conscience de ses actes et obéir à des lois physiques de chute et d’emportement. Une roche énorme, lancée de la plaine, eût ainsi roulé jusqu’au port. Les blouses blanches et bleues dominaient dans les rangs. Il y avait quelques jupes éclatantes de femme. On apercevait de loin en loin les taches noires des paletots, des vêtements sombres que portaient des hommes auxquels le peuple semblait obéir. Et la foule descendait la Cannebière (sic), coulant entre les maisons comme une eau vivante, pleine de reflets bariolés, avec un grondement menaçant. Au premier rang, au milieu d’un groupe d’ouvriers, marchait Philippe, la tête haute, le front dur et résolu [Philippe Cayol, jeune républicain]. Il portait une redingote noire qu’il avait boutonnée entièrement et qui lui serrait la taille ainsi qu’une tunique militaire. On sentait qu’il était prêt pour la lutte, qu’il l’attendait et la désirait. Les yeux clairs, les lèvres pincées, il ne prononçait pas un mot. Autour de lui, les ouvriers, pâles et silencieux, le regardaient par instants et semblaient attendre ses ordres. Comme la colonne entrait dans la rue Saint-Ferréol [au sud de la Canebière, sur le chemin de la préfecture], il y eut un léger tumulte, elle fit halte pendant une ou deux minutes, puis elle se remit en marche. La rue, jusqu’à la place qui la termine, était vide, quelques boutiquiers avaient fermé leurs magasins : du monde regardait par les fenêtres ; un silence de mort régnait, coupé seulement par le bruit profond des pas de la foule. Au milieu de la rue vide, au coin d’une ruelle latérale, les ouvriers du premier rang aperçurent un homme, petit et d’allure chétive, qui attendait la colonne. Lorsque Philippe fut près de cet homme, il reconnut son frère. Marius, sans prononcer une parole, vint se placer à côté de lui et marcha tranquillement au milieu des émeutiers. Les deux frères échangèrent un simple regard. On dut croire qu’ils étaient étrangers l’un à l’autre. Et le flot humain continua à rouler ainsi jusqu’à la place Saint-Ferréol [devant la préfecture]. Là, à quelques mètres de la place, un cordon de troupes fermait la rue. La foule était sans armes, et les baïonnettes des soldats luisaient au soleil. Des murmures de colère et de surprise coururent dans les premiers rangs et s’étendirent avec rapidité d’un bout à l’autre de la colonne, dont la queue se trouvait encore sur la Cannebière (sic). Les ouvriers disaient d’une voix basse et grondante qu’on voulait les égorger, qu’ils devaient être entourés de troupes, et qu’on n’avait autorisé la manifestation que pour les massacrer à l’aise. Pendant que ces murmures grandissaient, quatre délégués sortirent des rangs et demandèrent à être introduits auprès du commissaire du gouvernement, ainsi que cela avait été convenu la veille. Ils venaient à peine de disparaître derrière la ligne des soldats, qu’un fait irréparable se produisit, fait dont les conséquences furent sanglantes. La queue de la colonne, en entendant parler de troupe armée, de baïonnettes et de massacre, crut sans doute que les ouvriers du premier rang étaient égorgés. Elle se mit à pousser furieusement. Obéissant au mouvement irrésistible de cette masse d’hommes, le groupe qui entourait Philippe dut avancer de quelques pas. Les bras croisés sur la poitrine, pour montrer qu’ils n’avaient aucune pensée d’attaque et qu’ils obéissaient à une simple pression, les ouvriers arrivèrent ainsi devant les soldats. En les voyant approcher, un officier, perdant la tête, ordonna brusquement de croiser les baïonnettes. Et les baïonnettes, blanches et aiguës, s’abaissèrent, se tournèrent vers le peuple. Il y eut une tentative désespérée de recul. Philippe et les siens se jetèrent en arrière, voulant arrêter la foule énorme et écrasante qui les poussait à la mort. Mais ce mur vivant était impénétrable et s’avançait, pareil à un mur de pierre. Forcément, fatalement, les ouvriers arrivèrent sur les pointes des baïonnettes que les soldats tenaient en arrêt. Ils virent ces pointes devant leur poitrine, ils les sentirent qui entraient peu à peu dans leur chair. Pendant que le général qui commandait les troupes faisait un geste de désespoir et ordonnait de relever les baïonnettes, on raconte qu’une voix claire criait de la place Saint-Ferréol : « Piquez, mais piquez donc ces canailles ! » Et, aux fenêtres d’un cercle aristocratique voisin, des messieurs bien mis applaudissaient, en voyant couler le sang du peuple, comme s’ils eussent été dans une loge, égayés par les farces d’un acteur. Aux premiers coups de baïonnettes qui furent portés, les ouvriers eurent des cris de rage et de terreur. Cette foule qui était restée silencieuse devint folle en se voyant attaquée, sans avoir été avertie par aucune sommation légale. Elle n’avait que ses poings pour se protéger contre les fusils qui la menaçaient. » Fin sanglante de la manifestation 
place aux Oeufs C’est donc à partir du barrage de la rue Saint-Ferréol que la situation bascule. La manifestation pacifique va connaître un dénouement sanglant.
– Audibert, délégué des maçons (suite) :
« Au milieu de la Noailles, M. Picard [secrétaire de préfecture] vint à nous et nous dit : « Vous n’avez donc pas pu l’empêcher ? Espérez-vous que la manifestation sera calme ? » Nous répondîmes : « Oui, jusqu’à présent ». Arrivés à la rue St Ferréol, nous la trouvâmes barrée par la ligne et la garde nationale, et en tête, M. Marquois, et M. le général Ménard Saint-Martin. [commandant de la garde nationale] On nous demanda où étaient les délégués, nous répondîmes et nous nous présentâmes au nombre de cinq. Nous voulûmes arrêter la colonne ; mais poussés, nous nous trouvâmes à un mètre de la troupe, à laquelle son capitaine fit croiser la baïonnette. A cet instant, un cri fut poussé parmi les ouvriers, on disait que nous allions être retenus prisonniers ; au milieu de ce conflit je fus pris au cou par le capitaine, et je dus, pour traverser les trois compagnies, qui marchaient la baïonnette en avant, me jeter à quatre pattes. Je parvins à rejoindre mon co-délégué Chazal, et rencontrant M. Masnou, nous allâmes à la préfecture.
M. le préfet nous reçut avec une certaine impatience, et nous dit : Que voulez-vous ? – Justice d’abord, de ce qui vient de se passer. – M. Ollivier nous le promit. M. Masnou partit avec nous pour aller parler aux ouvriers. On nous barra le passage, et M. Baquière nous fit perdre un temps précieux. La police nous fit passer. M. Masnou parla sans succès à la foule. On nous annonça que des barricades étaient construites du côté de la rue de la Palud. [voisine de la rue Saint-Ferréol] J’y courus avec Chazal [délégué des selliers], qui grimpa sur une croisée, et, répétant aux ouvriers la réponse de M. E.Ollivier, leur promit d’aller chercher par écrit le maintien de son arrêté sur les dix heures du travail. Un individu le fit dégringoler de la croisée, en disant : « c’est un mangeur de la préfecture… » et nous retournâmes à la préfecture. Il y avait d’honnêtes ouvriers derrière la barricade, si on peut appeler ainsi quatre morceaux de bois en travers. A peine étions-nous de retour à la préfecture que nous entendîmes les coups de fusil de la rue de la Palud.
La lettre nous fut remise, et, suivi de Chazal, d’un commissaire de police et de Rivière, qui se joignit volontairement à nous, je me rendis sur les lieux, je parcourus les groupes afin de calmer l’irritation, mais nous ne pûmes y réussir et vingt fois nous faillîmes être victimes de notre zèle. A la place Castellanne (sic), [au sud immédiat de la préfecture] on me fit passer entre les rayons d’une charrette et l’essieu. Enfin, je rentrai chez moi harassé.
J’avais oublié de dire que Prévost et Bellet [délégués de l’usine métallurgique Taylor et des chantiers du Prado] étaient venus, le matin, déclarer à la gare qu’il ne fallait pas compter sur les ateliers pour la manifestation. » (« Cour d’Assises », op.cit.)
Qui a ouvert le feu ? Le conservateur Théophile Bosq est catégorique : le premier sang versé est de la responsabilité des manifestants.. Voici comment l’enchaînement des faits est présenté dans la Notice sur le plan en relief exécuté par M.Lavastre suivie d’un précis des événements des 22 et 23 juin 1848 par T.B, Marseille, Clappier, 1850 :
» Jusqu’au jeudi 22 juin, la ville avait joui de sa tranquillité accoutumée. Une manifestation de volontaires parisiens, appuyée par le club des Montagnards, avait seule, dans la soirée du dimanche précédent, troublé un instant l’ordre public ; mais, après quelques arrestations, tout paraissait avoir cessé. [cf. supra, déclaration du commissaire de police Caire] Cependant, le jeudi, dans la matinée, les diverses sections des ouvriers employés aux tranchées du canal, quittent leurs chantiers et se mettent en marche sous la conduite de quelques agitateurs. Le prétexte de ce mouvement était d’obtenir de M. E.Ollivier la réduction de la journée des ouvriers à 10 heures de travail. Cette réduction avait déjà été accordée et le préfet n’eut qu’à répéter à la députation envoyée par ce tumultueux rassemblement, la promesse de maintenir les dix heures accordées. Tout eût été fini là, si le but des meneurs n’eût pas été tout autre que ce motif apparent.
La manifestation prit tout-à-coup, sous l’inspiration des chefs, un caractère hostile. Les quelques gardes nationaux et la troupe de ligne, qui se trouvaient aux abords de la préfecture, sont assaillis à coups de pierres. Les émeutiers, repoussés, se dispersent dans la rue St-Ferréol et de là, en criant : Aux armes ! ils vont se réfugier dans la rue de la Palud [voisine de la rue Saint-Ferréol], où ils construisent une barricade à l’angle de la rue 2e calade.
Cette première barricade, construite à la hâte avec quelques pavés et des planches prises dans une maison en construction, ou détachées des soubassements de quelques autres maisons voisines, n’avait pas beaucoup d’importance et ne pouvait résister longtemps.
La garde nationale se porta immédiatement sur ce point, ayant en tête un commissaire de police. Les insurgés ripostèrent par des coups de pierres et des coups de fusil aux sommations faites. Plusieurs gardes nationaux furent blessés.
Ayant épuisé tous les moyens de conciliation, la milice citoyenne fit une décharge et enleva la barricade en quelques instants. Trois émeutiers furent tués ou blessés ; un jeune homme, tout-à-fait étranger à l’affaire, eut la cuisse fracassée par une balle. Après la débâcle de la barricade, les insurgés cherchèrent à se procurer des armes ou allèrent prendre celles qu’ils avaient en réserve.« En endormant ainsi l’opinion conservatrice de Marseille, Bosq est parfaitement de mauvaise foi. Il publie en 1850, et il ne peut donc pas ignorer le compte-rendu du procès publié et diffusé en 1849.
Caire, commissaire de police, y déclare à propos de l’affrontement rue de la Palud :
« Aux premiers pas, des pierres furent lancées : le colonel d’état-major fut atteint ; je le fus aussi. Ce fut la main sur la barricade que je fis la dernière sommation. Les insurgés se dispersèrent. Un coup de feu fut tiré. Il m’est impossible de dire de quel côté ce coup était parti. Les ouvriers accusaient la garde nationale d’avoir fait feu. Le nombre des blessés à la rue de la Palud dépasse 20. Je ne pense pas que le coup de feu soit parti du côté des insurgés. Plus tard, deux insurgés ont été atteints par des coups de feu. Gorju a été blessé derrière la barricade. Les ouvriers employés au Prado réclamaient contre la modicité du prix des journées. L’opinion personnelle du témoin est que les volontaires parisiens étaient restés pour aider la manifestation du 22. » (« Cour d’Assises…« , op.cit)
Passons maintenant au regard d’un témoin oculaire que nous connaissons bien, Victor Gelu.
Sur Victor Gelu, cf. entre autres articles de mon blog : René Merle – Le Paradoxe de Victor Gelu, poète « national » de Marseille et auteur méconnu…
J’ai devant moi l’écriture serrée de Gelu, sur ces pages de souvenirs toujours émouvantes, pleines de ratures, d’annotations de marge, de reprises sur papiers ajoutés et collés (archives communales de Marseille). Il en a été publié une partie : Victor Gelu, Marseille au XIXe siècle. Introduction de P. Guiral, texte établi et annoté par J. Reboul et L. Gaillard, Paris, Plon, Coll. « Civilisation et mentalités », 1971.
Gelu, sans engagement politique particulier, mais radicalement hostile aux « Blancs, fut, même si ses chansons provençales ont pu le faire considérer comme un « Rouge », un des « Bleus » qui trouvèrent leur compte dans la bourgeoise monarchie de juillet. Survint la République. Ironique sur l’enthousiasme exagéré, et quelque peu ridicule, de bien des « républicains du lendemain », Gelu fut néanmoins embarqué dans un club, [celui de Caillat] jusqu’à tenter (sans aucun succès) une candidature de député. Mais venons en au 22 juin.
Page 439, Gelu relate une « partie de plaisir » à Cassis, à la veille des événements. « J’y exhibai ma chanson du Tramblamen dont le terrible refrain fit rugir tout le bachique auditoire (de plaisir et de fureur). Nul n’y entendit malice. [On mesure la distorsion entre l’appel à la révolte populacière de la chanson de 1841, et le la benoite tranquillité petite-bourgeoise de son auteur et de ses amis. Sur cette chanson, cf. Gelu, Lou tramblamen (Le tremblement). tentative d’insurrection marseillaise de 1841 ]
Bientôt arrivèrent les déplorables journées de juin. Le vingt-deux je sortis vers les neuf heures du matin. [Depuis le début 1848, Gelu et sa jeune épouse habitent un appartement au 3ème étage, rue Basse Peirier, n°20, près du Cours Lieutaud. Il est donc voisin de la rue Saint Ferréol et de la rue de la Palud où, après les premières violences des « forces de l’ordre », la manifestation tourne à l’insurrection] Je me trouvai dans la rue de la Palud au moment où le relieur [tonnelier] du domaine Ventre [il s’agit de l’ouvrier Gorjux] fut tué par la Garde nationale, près de l’église de la Trinité, pendant qu’il excitait ses camarades aux bras nus par ses discours et par son exemple à établir une barricade au devant sa boutique [deux autres ouvriers furent blessés, et moururent peu après]. Je vis arriver sur la place de la porte de Rome les ouvriers de l’usine Taylor [le Britannique Philippe Taylor avait créé en 1835 à Menpenti une usine de construction de machines à vapeur et de moteurs de navire : une date majeure pour l’entrée de Marseille dans la modernité industrielle] , au nombre de cent-cinquante environ, sous la conduite d’un hercule à barbe-rousse, aux bras musculeux, à la face blême, à l’œil ardent, à la voix tonnante. La frénésie de l’insurrection endiablait tous ces hommes qui couraient vers la Préfecture en criant : « aux armes ! vengeance ! ». A l’instant même où, porté par la foule tant des insurgés que des curieux, je parvins à déboucher sur la place St-Ferréol, la ligne, la cavalerie et la garde nationale s’y rangeaient en bataille afin de donner à notre jeune préfet [Émile Ollivier, sur la rhétorique creuse duquel Gelu n’a pas été tendre depuis sa nomination fin février] un appui plus efficace que celui de sa faconde oratoire. Bientôt on nous fit évacuer non seulement la place ; mais encore toutes les rues y aboutissant. Je descendis alors vers le Cours ; et comme je voyais sur mon passage les dispositions réciproques de la foule et des défenseurs de l’ordre public s’exaspérer rapidement, je rentrai par un grand détour à la maison, où je me tins coi. » [On remarquera que Gelu, membre de la garde nationale de son quartier, mais faisant partie de la réserve non opérationnelle (il est né en 1806), s’est bien gardé de répondre à l’appel du tambour de la générale]. Ce premier sang versé va entraîner deux sortes de réactions.
Voici d’abord celles dont l’attitude de l’avoué Caillat est emblématique : nous avons rencontré Caillat la veille au soir devant les démocrates de son club, (chauffés notamment par la cinquantaine de jeunes Parisiens qui sont restés à Marseille), et se ralliant finalement à la manifestation. Il y participe effectivement : « Le lendemain en débouchant vers la rue Saint-Ferréol, je vis deux charrettes placées en travers pour former une barricade. En descendant de la rue du Musée, j’entendis un coup de feu et j’eus la douleur de voir le nommé Gorjux tomber près de moi. Aussitôt on cria : « Vengeance ! on assassine nos frères ». je vis alors un Parisien qui s’écriait : « vous voyez ce que c’est que votre gouvernement ! » Je vis là une compagnie de gardes nationaux l’arme au pied. Je me plaignis à eux de ce qu’ils laissaient faire les barricades ; ils me répondirent qu’ils n’avaient pas d’ordre. J’appris plus tard qu’elle avait été facilement enlevée.« Démocrate, mais hostile aux désordres, Caillat court endosser son uniforme de garde national et se met à la disposition des autorités pour enrayer l’émeute naissante.
Tout autre est la réaction de prolétaires qui le matin même étaient hostiles à la manifestation ou s’y ralliaient sans enthousiasme.
Les délégués de l’usine Taylor de Menpenti ont été entraînés par le débrayage massif des ouvriers et à leur course vers les lieux du combat. Prévost, délégué des ouvriers du Prado, est même retourné sur le chantier pour y recruter des manifestants. Le patron de la fonderie Armand et Soudry (à la Capelette) avait envoyé le délégué ouvrier, Bayeux, voir ce qui se passait en ville. Il comptait sur cet « ouvrier sérieux » pour calmer ses salariés. Bayeux revient en effet avec des nouvelles… mais c’est pour entraîner les travailleurs de l’usine vers les lieux de l’affrontement. (« Cour d’Assises…« , op.cit)
Ainsi, pendant que Gelu rentre prudemment chez lui, la protestation populaire s’amplifie, dans l’indécision d’abord. Zola montre bien comment elle se trouva un instant suspendue, après le drame de la rue de la Palud (Les mystères de Marseille, Marseille, Arnaud, 1867) :
« Les délégués, qui étaient parvenus à pénétrer jusqu’au commissaire du gouvernement, n’avaient pu obtenir de lui qu’une lettre dans laquelle il donnait satisfaction au désir des ouvriers de ne travailler que dix heures par jour. Mais cette lettre arrivait trop tard. Les délégués eurent beau la montrer aux groupes qu’ils rencontrèrent, le mot de vengeance était dans toutes les bouches, le peuple déclarait que le sang demandait du sang.
D’ailleurs, comme il arrive d’ordinaire, les causes de la lutte qui se préparait échappaient au plus grand nombre. La majorité de la population ignorait le but de l’émeute ; il y avait de la rage et de la terreur dans l’air, et c’était tout. Tandis que le rappel battait funèbrement dans les rues, et que les gardes nationaux se rendaient en hâte à leur poste, chacun s’interrogeait, ne sachant quel était l’ennemi contre lequel on s’armait. Une compagnie, composée de portefaix, refusa de marcher, ayant entendu dire que cet ennemi était le peuple ; malgré les espérances qu’on avait peut-être conçues, ces ouvriers ne voulaient pas tirer sur des ouvriers.
Le peuple se révoltait, telle était la seule certitude qui courait dans la foule. Pourquoi se révoltait-il, que voulait-il ? Personne n’aurait pu répondre. Les ouvriers eux-mêmes n’obéissaient plus aux motifs qui les avaient amenés devant la Préfecture ; ils se laissaient uniquement emporter par la colère. La lutte était devenue personnelle, sans aucune arrière-pensée d’insurrection politique. Si quelques meneurs intéressés n’avaient pas poussé le peuple à la violence, il est à croire que tout se serait terminé par des cris et des menaces. »
La vue d’une victime transportée sur un brancard électrise encore plus la foule.
Voici ce qu’en dit l’acte d’accusation (Cour d’Assises de la Drôme. Procès des accusés de juin de Marseille, Marseille, imprimerie nationale – association d’ouvriers, 1849) dans une intéressante présentation des deux composantes de l’émeute :
« Il était dix heures environ. Les émeutiers un moment indécis se divisèrent : les uns se portèrent vers la place Castellane, et les autres, beaucoup plus nombreux, vers la Place de la République. La première fraction, au sein de laquelle dominait l’élément ouvrier, se rendit dans divers ateliers et notamment dans ceux des sieurs Hessé et Taylor au quartier du Rouet, pour y recruter les nombreux ouvriers qui s’y trouvaient, et les décider « à venir (disaient-ils) venger le sang de leurs frères. Nous raconterons plus tard les faits qui se réalisèrent à la place Castellane.
Nous allons suivre la colonne au sein de laquelle dominait l’élément anarchique et qui se porta vers la place de la République en poussant des cris de vengeance et de mort.« Les barricades 
place Catellane Après la fusillade de la rue de la Palud, les manifestants, explique donc l’acte d’accusation, se divisent en deux colonnes : la colonne « ouvrière », revendicative, qui va vers la place Castellane, et la colonne « anarchique », c’est-à-dire politiquement marquée à l’extrême-gauche, qui va vers la Canebière.
« Nous allons suivre la colonne au sein de laquelle dominait l’élément anarchique et qui se porta vers la place de la République en poussant des cris de vengeance et de mort. » (« Cour d’Assises« , op.cit)
L’acte d’accusation explique que sur son chemin cette colonne désarme nombre de gardes nationaux, qui sortaient de chez eux en entendant sonner le rappel. Les manifestants, jusqu’à présent sans armes, ont désormais, pour certains en tout cas, des fusils. D’autres, s’ils n’habitent pas loin, courent chez eux chercher leur arme de garde national.
Refluant donc de la rue Saint-Ferréol vers la Canebière, les manifestants arrivent sur la place de la République (face à la Bourse, située de l’autre côté de la Canebière). Sur la place commencent à se ranger quatre compagnies de la garde nationale, les compagnies Richaud, Estienne, Ménier et Ricard.
Or le recrutement de ces compagnies, un peu vite désignées sous le nom de Légion des Tirailleurs, était vilipendé par la presse modérée ou conservatrice de l’époque : mélange de déclassés, sous-prolétaires du port et du Cours, voire mendiants, étrangers, organisés par des « démagogues » rouges bien connus…
Rappelons que, depuis le 8 mars 1848, tout citoyen de 21 à 55 ans, ni privé ni suspendu de ses droits civiques, était de droit garde national et avait droit au fusil. Il faut dire que la composition de la nouvelle garde nationale, ouverte désormais à tous les citoyens, avait donné bien du tracas au maire et à Émile Ollivier. Aux anciennes unités clairement bourgeoises étaient venues s’ajouter des compagnies organisées sur la base du quartier, de la corporation, voire, comme dans le cas des quatre susnommées, sur la base d’une affinité politique.
C’est l’attitude de deux de ces quatre compagnies qui va faire basculer la manifestation vers l’insurrection, au moment où des manifestants tentent de s’emparer des armes d’une compagnie bourgeoise de la garde nationale rangée au bas de la rue de Noailles.
Voici ce qu’écrit en 1850 la conservateur Bosq (op.cit) : « Une collision eut lieu entre une partie des insurgés et la compagnie Salles réunie sur la place St-Louis, devant le café Puget. Les émeutiers cherchent à désarmer cette compagnie qui résiste quelque temps ; deux autres compagnies se présentent au moment de la lutte, la compagnie Ricard et la compagnie Estienne ; mais loin de secourir leurs frères d’armes, elles pactisent avec l’émeute, et les gardes nationaux que commande M. le capitaine Salles sont désarmés. En même temps, deux nombreuses compagnies se formaient sur la place de la République. M.le général Ménard St-Martin les harangua, puis elles prirent position sur la Canebière, devant l’hôtel des Empereurs, là se trouvait déjà la compagnie Ricard. Le général Ménard St-Martin, dont la conduite a été si belle pendant ces journées, et qui par sa fermeté, son courage et son dévoûment (sic) s’est acquis, en ces jours, de nouveaux titres à l’estime et à la reconnaissance de notre ville, le général St-Martin, accompagné d’un chasseur de la ligne et d’un maréchal-des-logis de la garde nationale, vint passer devant ces différentes compagnies. A peine était-il arrivé, qu’il reçut, presque à brûle pourpoint, un coup de pistolet, qui fort heureusement ne lui occasionna qu’une blessure peu grave à la joue. Cette réception, l’attitude insubordonnée et menaçante de la plupart des hommes qui faisaient partie des compagnies ou qui étaient venus se mettre dans leurs rangs, obligea le général à s’éloigner ; il se dirigea rapidement vers la place de la République : c’est au moment qu’il tournait bride, que la compagnie Ricard fit feu sur lui : son cheval reçut cinq balles ; celui du chasseur de la ligne tomba mort un peu au-dessous de la rue St-Ferréol. Cette même décharge eut un effet plus malheureux, c’est par elle que le capitaine Robuste fut tué sur la Canebière, un peu avant la place de la République. Immédiatement après, les agresseurs fuient, comme s’ils étaient poursuivis, et gagnent les vieux quartiers ». [Le cœur en est la place aux Œufs] Qui a entraîné les manifestants vers la place aux Œufs toute proche ? Mouvement spontané ? L’avocat Thourel mettra ici en cause l’attitude provocatrice d’un ex « Vorace » lyonnais, révolutionnaire exalté, signalé dans les clubs, et en fait manipulé par la police. [Les Voraces, milice prolétarienne « rouge » qui contrôla la ville de Lyon au lendemain de la proclamation de la République] Zola, partisan lui aussi de la responsabilité d’un agent provocateur, désignera le cynique « rouge » Mathéus, qui pousse à l’émeute tant pour des raisons politiques que pour des raisons personnelles qui sont un des ressorts du mélo.
Bosc (op.cit) :
» Pendant ce temps-là, au lieu de donner des ordres pour agir énergiquement contre les insurgés, le préfet perdait du temps à écrire et faire imprimer des proclamations absurdes aux révoltés. [Cette accusation de faiblesse, voire de compromission avec l’émeute, a été inlassablement répétée par la droite marseillaise. On ne s’étonnera pas que Cavaignac, une fois l’insurrection parisienne écrasée, s’empressera de démettre Ollivier et de l’envoyer en Haute-Marne] Ceux-ci avaient mis ce temps à profit et s’étaient organisés au nombre de 7 à 800. La place aux Œufs était devenue leur quartier général. Toutes les issues avaient été fermées par les barricades ; des sentinelles veillaient aux abords de toutes les rues prêtes à donner l’alarme ; les maisons avaient été envahies, les tuiles enlevées pour les faire pleuvoir sur la troupe. »
La reconstitution de Zola (op.cit., ch 16) : » Cependant, les insurgés s’étaient remis aux barricades. Peu à peu, ils avaient amassé sur la place une quantité de matériaux assez considérable. Il y avait là un pêle-mêle, un entassement d’objets sans nom, qu’ils répartissaient le mieux possible entre les six barricades qui étaient en voie de construction. Ils faisaient la chaîne, se passant des planches, des pavés, tout ce qui leur tombait sous la main. Chacun courait de son côté et revenait jeter au tas ce qu’il avait trouvé. C’était un va-et-vient fiévreux, une sorte de vaste atelier de la révolte, où chaque ouvrier se hâtait, ardent et sombre, la menace à la bouche et la vengeance au cœur. Tandis que la plupart apportaient des matériaux, d’autres, sans doute des charrons et des menuisiers, s’étaient chargés de consolider les barricades. N’ayant ni clous ni marteaux, ils se contentaient d’emboîter les objets les uns dans les autres. Les deux barricades principales furent élevées à l’entrée de la Grand-Rue du côté du Cours, et à l’entrée de la rue Requis-Novis. Ces barricades, malgré les efforts des insurgés, n’étaient à la vérité que des amas d’objets peu résistants, ne pouvant offrir aucun obstacle sérieux. Quatre barricades, plus maigres encore, furent construites au travers des rues de la Vieille-Cuiraterie, de la Lune-Blanche, de la Vieille-Monnaie et de la Lune-d’Or. Une seule rue resta libre, la rue des Marquises, qui ménageait aux insurgés un passage nécessaire pour communiquer avec la rue Belzunce, la place des Prêcheurs et toutes les ruelles étroites et tortueuses des vieux quartiers, dans lesquels ils espéraient s’enfuir et se perdre, en cas de défaite. Ainsi barricadée, la place aux Œufs eût été une sorte de forteresse inexpugnable, si les barricades avaient eu plus de solidité. »
Qui sont ces insurgés ? La liste des inculpés pour les événements de la Canebière et de la place aux Œufs, (cf. le dernier article de cette étude), peut en donner une idée : ce sont très majoritairement des hommes jeunes, voire très jeunes (beaucoup ne sont pas majeurs), et clairement prolétaires salariés : représentants des métiers traditionnels de l’atelier (cordonniers, tailleurs, dont la tradition démocratique est bien attestée, ainsi que celle des ouvriers boulangers), menuisiers, chaudronniers, maçons et tailleurs de pierres si nombreux dans cette ville en plein essor, journaliers, manœuvres. Les métiers du port sont pratiquement absents. Nombre d’entre eux n’avaient pas d’armes, ce qui explique le pillage des boutiques de fripiers où les jeunes insurgés, dont beaucoup n’ont pas encore l’âge du droit au fusil de garde national, récupèrent sabres et autres armes blanches… Mais pourquoi l’acte d’accusation a-t-il qualifié cette colonne de « colonne anarchique » ? Sans doute à cause de l’existence d’un noyau d’insurgés plus âgés, et clairement politisés. La plupart des 46 principaux inculpés eux sont signalés comme adhérents d’associations républicaines avancées sous la Monarchie de Juillet, notamment la Société des Droits de l’Homme, et se retrouvent dès les premiers jours de la République au Club des Montagnards, qui tenta alors de s’emparer du pouvoir municipal. Ils ne reflètent pas bien sûr la réalité politique d’une ville où la droite est majoritaire électoralement, et où la gauche est profondément divisée entre modérés et radicaux de toutes nuances. Mais ils attestent d’un enracinement déjà ancien de l’extrême gauche révolutionnaire. On trouve même parmi eux un inculpé du complot dit de la Villette (1841), Joseph dit Lerouge, dit Faissine, 50 ans. Vrai personnage à la Gelu, il est marchand de fagots ! (sur cette insurrection carbonariste manquée, cf. : L’insurrection manquée de Marseille, 1841 ). Autre vétéran : Antoine Guigue, 68 ans, a été condamnée à trois reprises dans les années 1830 pour fabrication et détention d’armes de guerre. Son fils est commandant en second d’une compagnie montagnarde. Le chaudronnier Barrère, secrétaire du club des Montagnards, et militant démocrate depuis 15 ans déjà, est dit en contact avec les « anarchistes » de Lyon, et il le paiera lourdement. Le négociant Ménié, chef d’une compagnie montagnarde, membre du club de la Liberté, et désigné comme le premier responsable de « l’attentat », avait organisé depuis mars des . décuries ouvrières de combat, évidemment clandestines… À noter, parmi ces « rouges » de la veille, la belle et originale figure du pacifique ouvrier cordonnier Louis Eugène Couturat, 35 ans, venu de Lyon et devenu commis en librairie à Marseille où il diffuse la littérature socialiste. En 1844, il présidait le cercle marseillais de l’Union ouvrière, qui reçut Flora Tristan (mais Flora le tint à distance car il n’était plus un manuel !). L’accusation s’ingéniera à en faire un responsable, mais ne pourra que constater que, s’il avait suivi ses camarades, il fut d’une extrême modération. Notons encore parmi les insurgés la présence d’anciens militaires : ainsi l’aubergiste Perrin, 34 ans, chef d’une compagnie montagnarde de la garde nationale qui joua un rôle décisif dans le basculement vers l’insurrection, avait servi 14 ans dans l’armée, dont 11 ans en Afrique ! Il recrutait de préférence d’anciens militaires dans sa compagnie, comme Aldebert et Soulier.
Bosq (op.cit) : » Vers deux heures, la garde nationale et la ligne reçurent l’ordre d’aller débusquer les insurgés. Cette entreprise était pleine de périls : le haut des maisons, les fenêtres, les rues, la place, tout était occupé par les révoltés. Néanmoins, la garde nationale et la troupe de ligne s’enfoncèrent résolument dans ces rues étroites qui du Port, de la Canebière et du Cours vont aboutir à la place des Œufs. Les artilleurs de la garde nationale, avec lesquels se trouvaient aussi quelques détachements de la troupe de ligne arrivèrent, par la Grand’Rue, en face de la première barricade. Voici quelles étaient les dispositions prises par les insurgés pour résister à l’attaque : Cinq barricades avaient été construites par eux. La première s’élevait sur la place aux Œufs, au coin de la Grand’Rue (Est) ; elle était construite avec une charrette, des pavés entassés et de vieux meubles ; La seconde, formée avec des caisses et des planches, s’élevait au commencement de la rue de la Lune-d’Or sur la place aux Œufs ; Une troisième était à l’entrée de la rue Vieille-Monnaie ; des planches, des chaises, des meubles, des pavés la composaient. La quatrième barricade s’étendait de la maison Billon, bijoutier, à l’autre angle de la Grand’Rue ; elle était comme les précédentes, formée de caisses, planches, meubles et pavés ; Toujours en ligne de la place aux Œufs, rue Requis-Novis, s’élevait la cinquième barricade dans laquelle entraient les mêmes éléments de construction que dans les précédentes. Quand la troupe de ligne et les artilleurs furent arrivés devant la première barricade, une terrible fusillade éclata et répandit la consternation dans toute la ville. Un instant après le capitaine Devilliers tomba, mortellement blessé, sur l’escalier de la maison Guigou de Feraud ; il fut transporté par des soldats dans une maison de la place des Hommes. Nos troupes, engagées dans ces rues étroites où elles se trouvaient resserrées et dominées par les rebelles, eurent beaucoup à souffrir. Des barricades, des fenêtres, du haut des toits, le plomb, les tuiles, les pavés pleuvaient sur nos braves et faisaient des victimes. Dans la Grand’Rue, au coin de celle de Sion, l’artilleur Laplace fut tué par les tuiles que l’on lançait du haut des maisons. On le transporta au corps-de-garde du Cours. L’artillerie de la garde nationale, qui était en tête de l’attaque, fut plus maltraitée que le reste de nos défenseurs. On sait sa belle conduite ; nos éloges n’ajouteraient rien à l’admiration qui lui est acquise à jamais. L’artillerie se composait de deux batteries ; c’est le premier rang qui fit feu, de concert avec la troupe de ligne. L’un et l’autre de ces corps se prolongeaient jusqu’au Cours. Une partie s’était répandue dans les rues voisines. Au commencement de l’action, un jeune insurgé voulut poser un drapeau [tricolore] sur la barricade, et il fut tué immédiatement. Après les premières décharges, un artilleur s’étant réfugié sous la barricade, un insurgé allait le traverser d’un coup de baïonnette, lorsque le capitaine Mamiot, plus prompt que lui, le prévint et sauva le garde national en étendant mort l’insurgés d’un coup de pistolet. Le lieutenant Mitre fut blessé dans la rue Requis-Novis, par une décharge partie des fenêtres de la maison Giraud ; il mourut quelques jours après des suites de cette blessure. Enfin, la compagnie de Marine vint renforcer les assiégeants et leur fut d’un précieux secours. Les barricades furent enlevées, et les maisons dans lesquelles une partie des insurgés s’étaient barricadés furent entièrement évacuées à 4 heures et demie. Outre les morts que nous avons déjà signalés, nous devons encore citer un sergent-fourrier du 20e et trois soldats. M.Bourrillon, commissaire de police, fut un des premiers blessés dans cette affaire. Comme il s’était avancé à la tête de quelques troupes de la rue vers la place aux Œufs, au moment où il allait faire les sommations et engager les insurgés à la retraite, une décharge partit de derrière les barricades, et une balle lui traversa le bras, dont il dut subir l’amputation. A côté de lui, fut également frappé le commandant Parron. Il y eut encore plusieurs autres blessés. Un grand nombre d’insurgés furent faits prisonniers dans les maisons mêmes où ils s’étaient réfugiés, et où ils cherchaient à se cacher. On les conduisit au fort Saint-Jean. Il y eut, de leur côté, dit-on, neuf morts et quinze blessés. » Bosq, (op.cit) » Pendant qu’on en finissait avec l’insurrection à la place aux Œufs, elle se relevait sur un autre point. Les insurgés, chassés de leur position, s’étaient rendus sur la place Castellanne (sic), [au sud immédiat de la préfecture] où ils avaient encore élevé une suite de barricades. Ces préparatifs annonçaient que l’emeute était repoussée et non vaincue. La nuit survint sur ces entrefaites, et laissa la population dans une horrible attente des événements dont nous menaçait le lendemain. » Bosq décrit ainsi les barricades de Castellane : « Là s’élevaient encore cinq barricades, la plupart solidement construites. L’une partait de l’angle de la rue Sainte-Victoire, et s’avançait dans la largeur du grand chemin de Rome. Elle était régulièrement construite, toute en pavés. La seconde, également fort solide, était formée de deux charrettes renversées et de plusieurs tombereaux remplis de pavés ; les insurgés avaient pris ces charrettes et ces tombereaux à des charretiers qui passaient en ce moment. Cette barricade coupait encore le grand chemin de Rome, en partant de l’angle de la maison où se trouve le bureau de vérification de l’octroi. La troisième s’étendait de la maison occupée par la recette de l’octroi sur toute la largeur du grand chemin de Toulon. Elle était construite avec des charrettes, planches et pavés. Au débouché de la rue de la Nouvelle-Pyramide, s’élevait une quatrième barricade, composée de planches, poutres, pavés, etc. Enfin, sur toute la longueur de la place Castellanne (sic), à l’entrée du Prado, régnait une longue barricade peu solide. C’était une espèce de barrière formée de planches, derrière lesquelles se trouvait quantité de poutres. » Ces barricades avaient été construites avec la participation active de l’entrepreneur en maçonnerie démocrate Balajat, qui les avait fournies en matériaux. Qui les tenait ? On a vu qu’après la fusillade de rue de la Palud, une colonne à composition essentiellement ouvrière était partie vers Castellane, au sud immédiat de la préfecture. Ce choix est parfaitement compréhensible : l’usine métallurgique Taylor, la fonderie Armand et Soudry, et d’autres établissements industriels avaient poussé sur les friches de la Capelette et de Menpenti, à un ou deux kilomètres au sud de la place. Les barricadiers de Castellane se veulent à proximité de leurs entreprises. Lautier, serrurier chez Taylor et ancien militaire, est désigné par l’accusation comme « chef de barricade ». La liste des condamnations précise la présence et le rôle de ces métallurgistes, ainsi que celui des ouvriers des chantiers du Prado (maçons, menuisiers), dont les chantiers étaient situés également à peu de distance au sud de la place. (On y retrouve Prévost, déjà rencontré !). Plusieurs de ces travailleurs de ces nouveaux métiers du fer étaient des néo-marseillais : Le négociant Lombard, commandant l’artillerie de la garde nationale, qui participa à la négociation avec les barricadiers, répond ainsi au président : « Auriez vous connu quelqu’un des insurgés aux barricades ? – je ne puis donner aucune indication précise à cet égard. Ce que j’ai remarqué et ce que j’ai entendu de leur langage, me porte à croire que la plupart des insurgés appartenaient au nord de la France » (« Cour d’Assises.. », op.cit). Tous les témoignages concordent : en début d’après-midi, la place était occupée par quelques centaines de personnes, dont beaucoup de curieux : les barricadiers armés étaient entre cinquante et cent. Voici à nouveau le témoignage de Victor Gelu : Gelu (op.cit) : « Dans le courant de l’après-dîné (sic) lorsque le feu eut complètement cessé à la place aux Œufs et que le calme parut rétabli au centre de la ville absolument comme si elles eussent été en rase campagne, Clarisse et moi nous fîmes comme tant d’autres, nous allâmes nous promener en curieux aux barricades du Grand Chemin de Rome, si singulièrement établies par de naïfs descaladaïre [littéralement « dépaveurs de rue ». Le pluriel n’est jamais marqué en provençal par Gelu] entre la rue Dragon et la place Castellanne (sic). Nous fûmes témoins oculaires et auriculaires des étranges pourparlers de capitulation qui eurent lieu jusques (sic) fort avant dans la nuit entre les soi-disant envoyés de la Préfecture d’une part, et les insurgés très peu sérieux de l’autre. Enfin, tous les moyens de conciliation étant épuisés, on résolut tacitement de part et d’autre de donner suite au duel, mais de s’en tenir au premier sang. Dans la nuit, les barricades dérisoires du Grand chemin de Rome furent prudemment évacuées par leurs quelques rares défenseurs. » [Dans l’après-midi, les barricades furent d’abord évacuées sans violence par la troupe, après négociation des insurgés avec des envoyés du préfet, dont Agenon, leader démocrate-socialiste marseillais, et Gent, du Vaucluse, représentant du peuple et dirigeant démocrate-socialiste régional. Puis les barricades furent réoccupées, et Agenon et Gent, revenus négocier, furent un moment retenus par les insurgés. Sur ordre d’Ollivier, la troupe se retira alors, mais prépara une attaque massive pour le lendemain. les barricades furent effectivement évacuées dans la nuit] On trouvera sur un insurgé arrêté ce billet du préfet : » Citoyens, je vous prie d’abandonner vos barricades ; la violence n’amènera que de grands malheurs ; comptez sur moi pour reconnaître vos droits légitimes, et soyez convaincus que c’est par la tranquillité que vous obtiendrez ce que vous désirez. D’ailleurs, votre mouvement est sans objet : on vous a déjà accordé de ne travailler que dix heures. Émile Ollivier » (« Cour d’Assises… », op.cit) On comparera les versions de Bosq et de Gelu en ce qui concerne l’assaut donné le 23 au matin : Bosq (op.cit). » Dans la matinée du 23, en effet, le rappel fut battu. Bientôt l’on entendit, du côté de Castellanne (sic), la fusillade et le bruit du canon. Les garnisons voisines avaient été appelées à notre aide. Le bataillon du 6e de ligne, arrivé d’Avignon, ayant en tête son chef, M.Lamoussaye, et deux compagnies de marins, s’avancèrent vers la première barricade sur la place Castellanne (sic), déjà brisée par le canon de notre artillerie, et l’enlevèrent à la baïonnette. Le 6e y perdit deux hommes. On dit qu’à cette barricade, les insurgés éprouvèrent des pertes considérables. Plus de cent d’entre eux furent faits prisonniers. La maison de l’octroi fut criblée de balles, à mesure que l’on tirait sur les insurgés qui se trouvaient sur les toits. Comme à la place Janguin, [place aux Œufs] ceux-ci avaient envahi les maisons, et les mêmes scènes s’y renouvelaient, peut-être plus acharnées, mais elles durèrent moins longtemps. A dix heures, tout était fini. La ville, au bout de quelques jours, avait repris son aspect accoutumé, et cet ouragan, effet déplorable de nos discordes civiles, ne laissait bientôt plus que quelques vestiges sur les maisons des places où la lutte s’était engagée et des regrets profonds pour ceux qui avaient perdu la vie pour la défense de nos foyers, de l’ordre et de la liberté. »
Gelu, op.cit : » Le lendemain matin, pendant que la troupe de ligne enlevait avec sa furia francese traditionnelle cette position déjà abandonnée, depuis plusieurs heures, Clarisse et moi nous nous tenions renfermés dans notre chambre, nous entendions non sans quelque émotion, les coups de canon, le bruit des feux de peloton et des feux de file. Cela dura peu, mais le temps nous sembla furieusement long !.. Singulière victoire où l’un de nos meilleurs régiments de vieux Africains, le 33e je crois, débarqué de la veille, se battit comme le héros de Cervantes, contre des moulins à vent ; singulière bataille où il n’y eut de sang versé que celui d’un pauvre cocher tout à fait inoffensif qui regardait les assaillants au travers de sa jalousie à l’entresol de la maison basse Levenq marchand de ferrements , Grand chemin de Rome côté du levant, vers le milieu de la rue. A en juger par le bruit de l’artillerie et surtout par celui de la mousqueterie beaucoup plus continu, je tremblais de voir le faubourg tout jonché de cadavres. Il n’y eut pourtant que deux victimes dans tout ce fracas, le cocher dont je viens de parler et une espèce de fou, ancien tambour de zouaves, lequel poussa le délire jusqu’à vouloir tenir tête lui tout seul, à un régiment entier de ses ci-devant frères d’armes. Mon ex-tambour était embusqué derrière un tuyau de la cheminée, sur le toit de la maison de l’octroi, à l’angle occidental de la place Castellanne (sic). Avant même d’avoir pu décharger son fusil, il y fut tué dans son coin par un voltigeur du 33e. Mais si ce facile triomphe mit fin aux hostilités armées des mécontents batailleurs, il fut bien loin de faire cesser les inquiétudes de notre population paisible. Nous passâmes encore six jours et plus dans les transes à attendre l’issue de la formidable insurrection parisienne.Dès que les esprits furent un peu rassurés, j’entamai quelques petites affaires. J’achetai de M.Charles Damasle, négociant, une partie de fèves avariées de M.M Reymonet et Giraud, minotiers, soixante balles de farine de qualité tout à fait inférieure. Je pus vendre sur le champ ces marchandises avec un bénéfice que leur prix d’achat rendait énorme. » On appréciera le réalisme commerçant du minotier Gelu… Pour autant, que l’on n’imagine pas un Gelu seulement ironique devant la protestation ouvrière. Je donnerai ultérieurement son point de vue sur l’insurrection parisienne. Gelu minimise cependant la violence de ce matin du 23. Lorsque le canon tonna à six heures du matin, des coups de feu lui répondirent, tirés d’une maison, 61 Grand Chemin de Rome. Le menuisier démocrate Rue, travaillant aux chantiers du Prado, y louait des chambres, notamment à des ouvriers de l’usine Taylor. On y retrouve aussi Prévost, déjà plusieurs fois rencontré. Un soldat fut tué, d’autres blessés. Marius Trotebas, 25 ans, aide forgeron chez Taylor, fut accusé, d’autant qu’il avait déclaré la veille sur la barricade : « c’est aujourd’hui que nous devons fusiller ces brigands et faire reconnaître les droits de l’ouvrier ». (« Cour d’Assises« , op.cit) Dès le lendemain de ces deux foyers de barricades, la presse modérée ou conservatrice cria au complot, organisé par les agitateurs « rouges ». La thèse de l’accusation, lors du procès des insurgés, sera bien différente : – Acte d’accusation : » Telles sont les principales charges qui résultent de l’instruction contre chacun des accusés. Elles prouvent que, si tous sont coupables, tous ne le sont pas au même degré. A côté des chefs de l’insurrection, des instigateurs de la guerre civile, il y a eu des hommes égarés, trompés même, que les anarchistes ont poussé à la révolte et au combat« . (« Cour d’Assises« , op.cit) Le rôle des « anarchistes » donc… mais un rôle prémédité ou un rôle spontané ? – Réquisitoire du procureur de la République : « Et maintenant quand nous promenons les yeux sur ces bancs et que nous voyons des hommes de tous les âges, de toutes les professions, nous sommes à nous demander comment il se fait que tous soient liés par la même accusation. Y a-t-il là une question politique ? non, Messieurs. Y a-t-il eu là une question de travail ? Les 10 heures de travail n’étaient qu’un prétexte. Nous n’y trouvons, nous, que des hommes ardens (graphie de l’époque), s’excitant à l’émeute ; nous voyons une réunion d’individus ayant presque tous de mauvais antécédens (id ), [l’accusation ne manque pas de rappeler les condamnations antérieures pour vol ou coups et blessures de quelques inculpés] demandant tout à la société, et ne voulant rien lui donner ; cette écume que l’on retrouve dans toutes les insurrections. Il y a peut-être aussi quelques hommes égarés ; vous saurez les reconnaître ; vous saurez faire la part à chacun ; et, dans l’épreuve qu’ils subissent, ils auront reçu une sévère leçon ; quant aux fauteurs, aux instigateurs, vous les frapperez avec rigueur, vous les punirez d’une manière exemplaire, car cet exemple est nécessaire. Votre verdict ne sera pas seulement un acte de justice, mais un haut et salutaire enseignement. » (« Cour d’Assises« , op.cit) – Acte d’accusation : » En voyant ces graves collisions de Marseille coïncider avec les sanglantes journées de juin à Paris, on pouvait se demander s’il n’y avait pas eu une résolution d’agir arrêtée et concertée d’avance avec les fauteurs de ces deux mouvements. On pouvait se demander encore si, à Marseille même, ce concert criminel n’avait pas existé entre les insurgés. L’information a révélé plusieurs circonstances qui devaient naturellement faire supposer un complot. L’arrivée à Marseille des Lyonnais et des Parisiens enrôlés dans la Légion italienne, l’apologie du 15 mai et de Barbès prononcée par leurs délégués dans les clubs, la présence d’un grand nombre d’entre eux dans des manifestations tumultueuses, notamment dans celle du 18 juin à la préfecture, enfin, la participation de quelques-uns à l’insurrection même, autorisaient déjà de graves soupçons. D’autres faits pouvaient paraître plus significatifs encore. Une lettre, venant de Paris, est lue le 18 juin, dans une réunion de plusieurs individus, chez le restaurateur Courty, au Prado. Elle contenait en substance : « Bien que la banquet à 25 centimes ait été indéfiniment ajourné, les événements doivent avoir lieu à Paris pour la Saint-Jean. Souvenez-vous que la Saint-Jean est le 24. Tenez-vous prêts. » Le 21 juin, plusieurs jeunes gens portant sur leur casquette ces mots : Légion italienne, se trouvent sur le bateau à vapeur qui descendait de Lyon à Avignon. Ils disent : qu’ils faisaient partie de l’expédition de Chambéry ; que si, dans cette expédition, ils n’ont pas réussi, il pourra en être autrement à Marseille, et qu’il y fera chaud demain et après demain (le 22 et 23 juin). » Des propos annonçant aussi l’approche de quelque événement sinistre sont proférés dans les manufactures de tabacs, à Marseille, par des ouvriers appartenant aux clubs les plus exaltés. Enfin, des rapports plus fréquents s’établissent entre les anarchistes de Marseille et ceux de Lyon et de Paris. Toutefois, malgré ces indices, la justice n’avait pas vu de complot là où le concert criminel n’apparaissait pas avec une complète évidence. Dans l’explosion soudaine de la guerre civile à Marseille, elle n’a vu qu’un attentat imputable seulement aux chefs des rebelles et à quelques-uns de ces tirailleurs organisés par eux pour entrer en lutte au premier signal. Citoyens d’autant plus coupables que, sous la République et avec le suffrage universel, l’insurrection est un non-sens, un outrage à la souveraineté du Peuple, en un mot, un crime de lèse-nation. Quant aux hommes égarés que les chefs et les meneurs ont poussés à la révolte, la justice s’est montrée indulgente à leur égard. Elle a fait la part de l’entraînement politique. Elle a songé à la misère si facile à tromper, et cherchant un remède dans un bouleversement social, qui ne pouvait que l’accroître en tarissant les sources de toute amélioration, c’est-à-dire, l’ordre et le travail.« La révolte aurait donc été, à chaud, le fruit d’une exaspération populaire manipulée par des chefs « anarchistes » voyant là occasion d’en découdre. Demeure l’énigme posée par cette volonté d’en découdre, beaucoup moins évidente d’ailleurs du côté des métallurgistes de Castellane que du côté des insurgés de la place aux Œufs. En fait, l’insurrection apparaît sans chefs véritables, et sans buts immédiats clairement exprimés. Une fois brisée par l’armée sur la place, elle semble relever d’un mouvement brownien improvisé : les groupes d’insurgés se dispersent, se retrouvent, parcourent à quelques-uns les rues du vieux quartier ou du Cours, avant de rentrer tout bonnement chez eux ou de dresser bilan dans un café. Avait-on voulu la Révolution ? Aucun insurgé n’arbore un drapeau rouge. Il s’agit d’une explosion subite, et sans lendemain, de haine sociale et politique dirigée contre les modérés de la municipalité, contre les Gros, contre le pouvoir… Marius Clément : « Barricados » 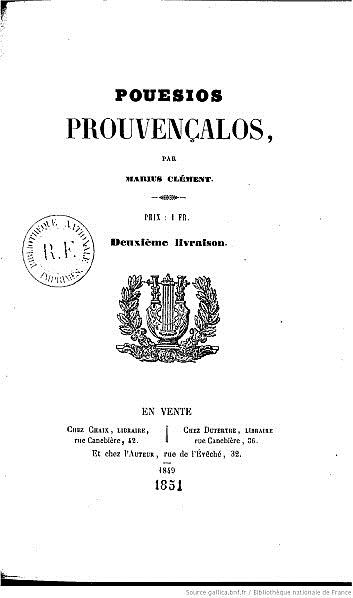
Voici, dû à la plume du polygraphe Marius Clément, coutumier des rimes provençales d’actualité, un témoignage (?) donné à chaud après la première journée de barricades. Pouesios prouvençalos par Marius Clément. Marseille, Imprimerie nationale – Association d’ouvriers, quai du canal, 9. 1848. En vente chez l’auteur, rue de l’Évéché, n°32. (Clément n’a donc qu’à descendre de son quartier du Panier pour se retrouver immédiatement sur le Cours ou à la place des Œufs). Le texte est entièrement en provençal. Les pratiquants de la graphie occitane ou de la graphie mistralienne ne s’offusqueront pas de la graphie « sauvage » de l’auteur, qui, et pour cause, ne pouvait pas plus employer l’une que l’autre (elles n’existaient pas). Clément ne traduit pas. Il n’en était guère besoin pour son public populaire. Le texte, qui n’a vraiment rien de littéraire, est cependant marqué au sceau d’une vérité de langage : l’artisan prétentieux utilise fort justement le provençal populaire que j’ai entendu enfant et que je parle… Autant dire que la traduction littérale que j’en donne traduction ne vise pas à en rendre « l’authenticité ». Mais à tout le moins elle en donne le sens, marqué au sceau du conformisme (Clément a salué et saluera tous les régimes et il finira par encenser le coup d’État…) et de la médiocrité ambiante. Commencé sur le registre de la commisération à l’égard des ouvriers, il se termine par la dénonciation du communisme partageux… Rien de bien original donc, sinon qu’il pose clairement la distance prise par ces habitants du vieux Marseille avec ces nouveaux venus sur la scène de la cité : « les ouvriers » ! Il exprime aussi, et surtout, l’horreur de la guerre civile qui est venue bouleverser la tranquillité de ce petit monde.
« Leis Barricados – Lou 22 de Juun 1848. Fait historique.
Lou vinto-dous de juun, un dijoou oou matin, Le 22 juin, un jeudi matin Eri enca coucha ; entendi un vesin, J’étais encore couché ; j’entends un voisin, Bramavo coumo un ai ; disie : « Ferma leis pouartos ! » Il bramait comme un âne, il disait : « fermez les portes ! » Leis frumos doou quartie èroun la mita mouartos. Les femmes du quartier en étaient à moitié mortes. Entendi lou rappel. Saouti vite doou lie ; J’entends (sonner) le rappel (de la garde nationale). Je saute vite du lit ; M’habihèri subran senso ceremounie ; Je m’habillai aussitôt sans cérémonie ; Descendi su lou coou. Quand sieou à la carrièro, Je descends sur le coup. Quand je suis dans la rue, Vieou un mouloun de frumos. Clairo la peissounièro Je vois un tas de femmes. Claire la poissonnière Ero qui à flot que fasie soun journaou ; Était là importante qui « faisait son journal » (donnait les nouvelles ; Disie : « Es leis ouvries ; vieou qu’aco parte maou : Elle disait : « C’est les ouvriers ; je vois que cela part mal : [la manifestation est donc clairement définie comme ouvrière. « les » ouvriers et non « des » ouvriers : la classe ouvrière est un corps à part, greffé récemment sur le vieux Marseille négociant et commerçant, ou celui des anciennes corporations] Es de republicains que voueloun lou piagi ; Ce sont des républicains qui veulent le pillage ; [le thème récurrent de la peur des pauvres avides du bien des plus aisés] Ce que vous dieou aqui es pas un bavardagi ; Ce que je vous dis là n’est pas un bavardage ; Ai vis ade matin la manifestatien : Je viens de voir ce matin la manifestation : Es que de pès-descaous ; mi fasien coumpassien. » Ce ne sont que des va-nu-pieds ; ils me faisaient compassion ». L’aoutro li respoundè : « Alor es de mandians ; L’autre lui répondait : « Alors ce sont des mendiants ; Et que voues que reclame : sera leis negoucians ? Et qui veux-tu qui réclame (revendique) : ce sera les négociants ? Aqueou qu’a fouesso escus, que souven soun pas sieou, Celui qui a beaucoup d’écus, qui souvent ne sont pas siens Si va pas faire tua per un coou de fusieou ; Ne va pas se faire tuer par un coup de fusil ; Es que lou malhuroux que reclame soun dre C’est seulement le malheureux qui revendique son droit Faouto de nourrituro si poou plus teni dre. Faute de nourriture il ne peut plus se tenir droit. Et seis pooureis enfans que an ren per mangea, Et ses pauvres enfants qui n’ont rien à manger, Ti parte coumo un lien et semblo enragea. (Aussi) il te part comme un lion et semble enragé. Veiras jamai aqueou que a de capitaoux, Tu ne verras jamais celui qui a des capitaux, Eis manifestatiens vies que de pès d’esquaoux. « Aux manifestations, tu ne vois que des va-nu-pieds » De touteis seis discours n’avieou la testo lourdo, De tous leurs discours, j’avais la tête lourde, Pooureis Françès, toujours, buouren à la cougourdo. Pauvres Français, toujours nous boirons à la courge [gourde] [la cougourdo, emblème de la démocratie provençale depuis 1830 > boire à la cougourde = partager les idées démocratiques > et pour les ennemis de ses idées, se laisser endoctriner, mystifier] M’enfili su lou coou, laissi ma babilhardo, Je m’enfile (m’avance) sur le coup, je laisse ma babillarde, Quand sieou dessu lou cous, prochi lou cor de gardo, Quand je suis sur le Cours, près du corps de garde, Vieou de rassemblamens, enfin, de tout cousta ; Je vois des rassemblements, enfin, de tout côté ; Un de meis grans amis mi venguè acousta : Un de mes grands amis vint m’accoster : Mi diguè : « Se sabiès ce que l’a din la villo, Il me dit : « Si tu savais ce qu’il y a dans la ville, Despui d’estou matin sian en guerro civilo. Depuis ce matin, nous sommes en guerre civile. Moun cher, vai, crei ti vo, sieou puleou mouar que vieou, Mon cher, va, crois le bien, je suis plus mort que vif, De tout cousta si tiro que de coous de fusieou. « De tous côtés on ne tire que des coups de fusil. » A la place deis uous fasien la barricado, À la place des Œufs, ils faisaient la barricade, [située derrière la Bourse, dans le quartier détruit depuis, et occupé par le centre commercial] Su lou meme moumen oousen la fusiado ; Au même moment, nous entendons la fusillade : Lou mounde si soouvavoou ; vian un joine brutaou, Les gens se sauvaient ; nous voyons un jeune brutal, Li dian : « Mounte an fa fue ? – Dessu lou generaou, » Nous lui disons : « Où ont-ils fait feu ? – Sur le général, » Nous responde, subran, eme un ton de malici, Nous répond-il aussitôt sur un ton de malice, Si penserian de suito qu’ero un deis coumplici. Nous pensâmes de suite qu’il était un des complices. Parte mai en courent, leis huis fouero la testo, Il part à nouveau en courant, les yeux hors de la tête, Ni quan voou, ni quan couesto, demande pas soun resto, Et sur le coup (ex abrupto), il ne demande pas son reste, Anavi m’approucha, veire la barricado, J’allais m’approcher, voir la barricade, Mi dien : parmi Françès la guerro es desclarado ; On me dit : parmi les Français la guerre est déclarée ; Leis ballo que siblavoun, enfin, din la carriero, Les balles qui sifflaient, enfin, dans la rue, Urousamen que sian oou siecle de lumiero. Heureusement que nous sommes au siècle des lumières. O ! Siecle renouma, coumo esclares ben : O siècle renommé, comme tu éclaires bien : Leis homes, ooujourd’hui, soun rempli de talen. Les hommes aujourd’hui sont remplis de désirs, « capacité ». Doou ten de l’Emperour nouestreis braveis guerriers Du temps de l’Empereur nos braves guerriers Si batien soulamen qu’eme leis estrangiers ; Ne se battaient qu’avec les étrangers ; Alor, din d’aquoou ten, leis armos de la Franço Alors, dans ce temps-là, les armes de la France Pourtavoun la terrour ches leis aoutreis Puissanços. Portaient la terreur chez les autres puissances. Sigue din l’Angloterro, lou Russou, l’Alleman, Que ce soit dans l’Angleterre, chez le Russe, l’Allemand, Nouestreis braveis sordas s’envenien trioumphans. Nos braves soldats s’en venaient triomphants. Aqui l’avie d’orguui eme fouesso genio, Là il y avait de l’orgueil et beaucoup de génie, Aquelli meritavoun tre ben de la patrio ; Ceux-ci méritaient très bien de la patrie ; Leis loouries que cuyen, leis poudian respeta; Les lauriers qu’ils cueillaient pouvaient être respectés ; E sa gloiro es anado a la pousterita. Et leur gloire est allée à la postérité. Mai oou siecle de vui, que lou renoumoum tan, Mais au siècle d’aujourd’hui, que nous célébrons tant, L’enfan fa fue oou pèro, lou pèro a l’enfan. Le fils fait feu sur le père, le père sur le fils. O per ma fe de Dieou, li coumpreni plu ren O par ma foi de Dieu, je n’y comprends plus rien Explicami en poou, enfin, coumo viven : Expliquez moi un peu, enfin, comment nous vivons : De si dire Françès aro foou ave crento, De se dire Français maintenant il faut avoir crainte (honte), Sian ben mai arriera qu’en milo huich cen trento. Nous sommes bien plus arriérés qu’en mile huit cent trente. Paoure pople françès, coumo ti vieou pecaire, Pauvre peuple français, comment je te vois, hélas, Daquelleis entriguants n’en souarte de tout caire. De ces intrigants il en sort de tous les côtés. Per aganta de plaços, fan agi lou mesquin, Pour attraper des places, ils font agir le pauvre diable (le misérable), Prenoun toujour l’ouvrier per un vrai manequin. Ils prennent toujours l’ouvrier pour un vrai mannequin. O ! paoureis malhuroux, sias de beis darnaguas, O ! pauvres malheureux, vous êtes de vrais nigauds, Et li viaas, ben segur, pas pu lun que lou nas. Et vous n’y voyez, c’est bien sûr, pas plus loin que le nez. Aro dedin la Franço, se li fen attentien, Aujourd’hui dans la France, si nous y faisons attention, Touteis leis jours ressouarte de nouvellos oopinien. Tous les jours apparaissent de nouvelles opinions. La un jambaraya, enfin, dins chasque villo : Il y a un mêli-mêlo, enfin, dans chaque ville : Un demando Henri cin, l’aoutre voudrie Joinvillo. L’un demande Henri Cinq, l’autre voudrait Joinville, [Henri V, prétendant légitimiste – Joinville, fils de Louis Philippe] La leis Buenapartistos et lou Juste Mitan, Il y a les Bonapartistes et les « Juste Milieu » Que souven la regenço vou metoun en avant ; Qui souvent vous mettent la régence (orléaniste) en avant ; Ave un gran parti ooussi de soucialistos, Vous avez un grand parti aussi de socialistes, Et pui senso counta touteis leis coumunistos, Et puis sans compter tous les communistes, Aqui uno oopinien que coumpreni pas ben, Voilà une opinion que je ne comprends pas bien, Eme aquelleis Messiès foou partagea lou ben. Avec ces Messieurs, il faut partager la propriété. Eben aven fouesso home que millo fran per jour, Et bien vous avez beaucoup d’hommes qui avec mille francs par jour, E quan seriè doueis millo serien encaro cour ; Et quand ce seraient deux mille (francs) seraient encore à court ; Pouria ben li douna touto vouestro fortuno, Vous pourriez bien leur donner toute votre fortune, Et pui lou revengu enca d’uno coumuno Et puis encore le revenu d’une commune Que n’en veirien la fin, et serie leou mangea, Qu’ils en verraient la fin, et cela serait vite mangé, Et vous vendrien leou dire que foou mai partagea. Et ils viendraient vite vous dire qu’il faut à nouveau partager. O ! lache de Françès, l’argen ti fa tout faire. O ! lâche Français, l’argent te fait tout faire. Fouesso que per sieis francs tamben vendrien soun paire. Beaucoup pour six francs vendraient aussi leur père. Fan fue oou generaou, tiroun su leis chassurs ; Ils font feu sur le général, ils tirent sur les chasseurs ; [le général Ménard, blessé sur la Canebière] Alor sian plus Françès, digami que sian Turc, Alors nous ne sommes plus français, dites-moi que nous sommes Turcs, Per fa de cavo ensin foou estre de manans ; Pour faire des choses pareilles il faut être des rustres ; Sun chin negre vous mouarde, va fe pagua oou blan, Si un chien noir vous mord, vous le faites payer au blanc, Vengea vous su d’aqueleis que vous an fa de maou, Vengez-vous sur ceux qui vous ont fait du mal, Ane pas insulta lou brave generaou ; N’allez pas insulter le brave général ; Es l’ami deis ouvriers, car touteis va saben, Il est l’ami des ouvriers, car tous le savent bien, Lou generaou Menard si coumpouarto très ben. Le général Ménard se comporte très bien. [rappelons-le, il commandait la garde nationale] Se la lou mendre bru, se li pouarto de suito, S’il y a le moindre tumulte, il s’y porte aussitôt, Duven lou respecta din sa noblo counduito. Nous devons le respecter dans sa noble conduite. Voulian la Republico, et ben aro l’aven, Nous voulions la République, et bien maintenant nous l’avons, Na fouesso que voudrien un aoutre changeamen ; Il y en a beaucoup qui voudraient un autre changement ; Na que voueloun Cabet per faire lou partagi, Il y en a qui veulent Cabet pour faire le partage, La de faribustiers que voudrien lou piagi. Il y a des flibustiers qui voudraient le pillage. Voulen estre tranquile eme la Republico. Nous voulons être tranquilles avec la République. Aqueou que si voou batre s’envague en Afriquo ; Celui qui veut se battre, qu’il s’en aille en Afrique ; Aqui sera segu de leou faire bendeou, Là il sera vite certain de pouvoir cogner, A la risquo bessai de li leissa la peou. Au risque peut-être d’y laisser la peau. Car parmi patriotos si desclaro la guerro Car si entre patriotes se déclare la guerre Aco farie trembla lou ciel eme la terro. Cela ferait trembler le ciel et la terre. Jamai ses vis coumettre uno talo infamio, Il ne s’est jamais vu commettre une telle infamie, Es la premiero fes qu’arribo din Marsiho. C’est la première fois que cela arrive dans Marseille. Leis insurgeas avien lou drapeou tres coulour, Les insurgés avaient le drapeau trois couleurs, [aucun drapeau rouge signalé chez les insurgés] La gardo natiounalo lou drapeou tres coulour, La garde nationale le drapeau trois couleurs, Leis insurgeas creidavoun : Vivo la Republico ! Les insurgés criaient : Vive la République ! Et leis aoutreis disien : Vivo la Republico ! Et les autres disaient : Vive la République ! Enfin, touteis ensemble eroun doou meme dieou, Enfin tous ensemble étaient du même dieu, Et soun resounamen ero a coou di fusieou. Et leur raisonnement (discussion) était (se faisait) à coup de fusils. Aro digue mi un paou, se me un taou discours Maintenant dites-moi un peu, si avec un tel discours De se dire Françès es pas un desounour. De se dire Français n’est pas un déshonneur. Puesque dedin la Franço aven tan d’intriguan Puisque dans la France nous avons tant d’intrigants Renegui ma patrio, e mi faou Musulman. Je renie ma patrie et me fais musulman. Qui sont les insurgés ? 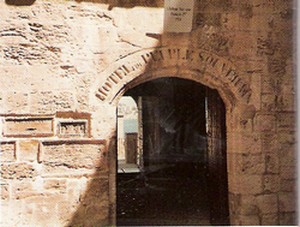
Hôtel du Peuple souverain », inscription laissée par les insurgés prisonniers au Château d’If en juin 1848 Lors de la répression directe de l’insurrection, et dans les jours qui suivirent, sur dénonciations de voisinage, plusieurs centaines d’insurgés ou présumés tels furent arrêtés. Le 22 juin, les premiers prisonniers furent enfermés dans les deux forts de l’entrée du port, puis nombre d’entre eux furent entassés au Château d’If. Même usée par le temps, on peut encore lire sur les murs du Château d’If la trace de leurs graffiti. L’arc d’une porte voûtée porte, profondément gravée, l’ironique inscription : « hôtel du peuple souverain« … À la différence de Paris, où les jugements suivirent immédiatement l’insurrection et furent très durs, ici, on attend une année, et surtout on ne juge pas à Marseille : c’est Valence qui accueillera le procès. Dans le climat tendu et répressif de l’année 1849, l’accusation et les peines apparaissent relativement « clémentes ». Le procureur déclare : » La fermété et l’indulgence continueront à inspirer le ministère public dans sa conduite aux débats. D’une justice ferme contre ceux qui ont arboré le drapeau sanglant de la guerre civile et de l’anarchie, il sera d’une justice indulgente pour ceux qui n’ont été que les instrument passionnés ou aveugles de chefs séditieux. Le magistrat républicain sait ce qu’il doit de respect à la liberté des opinions. Il a une entière sympathie pour toutes les souffrances ; mais il déteste et flétrit toute attaque violente contre l’ordre social. Protecteur de la paix publique, de la propriété, de la famille, il connaît ses devoirs, et il saura élever son inébranlable dévoûment à la hauteur des grands intérêts de la société représentés par un jury probe, libre et national. » (« Cour d’Assises… », op.cit) Il suffit de comparer les peines décidées par le tribunal de Valence avec la cruelle brutalité des peines décidées par la commission mixte des Bouches-du-Rhône, après le coup d’État de 1851. Marseille ne connut pas d’insurrection en décembre 1851, mais pourtant bien des militants (préalablement libérés, légèrement condamnée, ou acquittés en 1849), furent envoyés à Cayenne : ainsi le propagandiste socialiste Couturat, qui, condamné à un an de prison en 1849, sera condamné à 20 ans de bagne à Cayenne en 1852. Ainsi le tourneur en chaises Cadenel, acquitté en 1849, et condamné à 20 ans de bagne de Cayenne en 1852. (le leader démocrate-socialiste Agénon, que nous avons vu négocier avec les barricadiers de Castellane, mourra à Cayenne peu après son arrivée…) Le 25 juin 1849, un an après les événements, 153 insurgés étaient donc jugés par la Cour d’assises de Valence, dans une ville en état de siège, qu’ils traversèrent dans leurs fourgons pénitentiaires en saluant la foule au cri de « Vive la République !« . La plupart, emprisonnés depuis un an déjà, n’avaient, mais, on le voit, rien perdu de leurs convictions et de leur combativité. Un tri important avait déjà été fait parmi les 419 insurgés initialement inculpés. « La justice a rendu à la liberté, pour absence ou insuffisance de charges, 261 inculpés. Elle en a traduit cinq en police correctionnelle. Sur les 153 accusés qu’elle a renvoyés devant le jury, 46 seulement sont présentés comme coupables d’attentat, elle n’impute à presque tous les autres qu’une part plus ou moins active dans l’insurrection. » (Cour d’Assises de la Drôme. Procès des accusés de juin de Marseille, Marseille, imprimerie nationale – association d’ouvriers)… autres. Parmi ces 261 inculpés dispensés de procès, on trouve des militants démocrates socialistes actifs (le journaliste Honoré Bondilh, par exemple, connut le château d’If). On y trouve aussi une « piétaille » qui, pour avoir été mêlée aux événements, ne semble pas y avoir pris une part importante. Restent 153 hommes qui vont être jugés. C’est dire que le procès ne peut nous offrir qu’une vision très partielle de la composition sociologique et des origines géographiques de la totalité des manifestants, (plusieurs milliers) et des insurgés (plusieurs centaines).
Accusés et témoins s’expriment tous en français, à une seule exception : » La femme Héraut, née Henry, tenant un magasin de coiffeur à Marseille, dépose. La déposition de ce témoin est faite en patois provençal. » (« Cour d’Assises… », op.cit). Tout en demeurant fortement provençalophone, Marseille a déjà été gagné au français. D’autant que l’immigration intérieure française y a été très forte sous la Monarchie de Juillet. Pour autant, la différence d’accent est constamment soulignée dans l’identification des inculpés : Marseillais, Français du Nord… Par exemple, Lombard, négociant, commandant de l’artillerie de la garde nationale, qui avait été au contact des barricades de la Grand Rue, puis de la place Castellane, et avait négocié avec les insurgés, répond ainsi à une question du président : « Auriez vous connu quelqu’un des insurgés aux barricades ? – Je ne puis donner aucune indication précise à cet égard. Ce que j’ai remarqué et ce que j’ai entendu de leur langage, me porte à croire que la plupart des insurgés appartenaient au nord de la France » (« Cour d’Assises… », op.cit). La présence de quelques uns des 50 jeunes Parisiens de la Légion italienne, qui devaient quitter Marseille le 22, est ainsi attestée dans la manifestation du matin. Pour autant, aucune mention n’est faite dans l’accusation de leur participation à l’insurrection armée. Ces « Français du Nord » barricadiers sont bien des ouvriers travaillant à Marseille, sans être pour autant tous marseillais d’origine. Beaucoup sont venus de Paris, du Sud-Ouest, de l’Alsace et bien entendu de tout le Sud-Est. Certains, les plus âgés (trente ans et plus) sont profondément impliqués dans la vie politique de la cité, et depuis longtemps. Les autres, très jeunes, sont ainsi présentés après le passage en revue des 46 inculpés estimés responsables de « l’attentat » : « L’audience continue par l’interrogatoire et l’audition des témoins concernant ceux des accusés qui ont été vus porteurs d’armes apparentes dans le mouvement insurrectionnel, construisant des barricades, envahissant le domicile des citoyens dans les quartiers environnant la place aux œufs et la place Castellane. Cette catégorie d’accusés est la plus nombreuse. Elle forme le principal contingent des insurgés qui ont à répondre devant la justice des événements du 22 et 23 juin. Ce sont pour la plupart des ouvriers qu’on est allé soulever dans leurs chantiers. Il y en a fort peu qui soient habitants de Marseille. Un grand nombre même ne sont pas français. » (« Cour d’Assises », op.cit). Déclaration curieuse en ce qui concerne l’habitat (même depuis peu, même si leur gîte est provisoire, les inculpés sont domiciliés à Marseille) et en ce qui concerne la nationalité (en fait on relève un Bavarois, et deux Piémontais…). Mais restent cette dimension de l’effet d’entraînement à partir des lieux de travail. « Chantiers » ne peut pas s’appliquer au monde de l’atelier dont nous avons dans l’article « Barricades » qu’il a fourni son bon contingent, mais convient parfaitement aux ateliers nationaux (municipaux). Or, la liste des accusés mentionne très peu de travailleurs enrôlés dans ces chantiers municipaux. On peut penser, comme beaucoup de commentateurs l’ont avancé, que ces ateliers ont en fait peu donné à l’insurrection. On peut aussi penser que les inculpés ont donné leur profession initiale, qui ne correspondait pas forcément au travail qu’on leur proposait dans les dits ateliers… Voyons maintenant qui étaient ces inculpés, d’abord le groupe des responsables de l’attentat, puis le groupe des « entraînés ». Je les ai classés par ordre alphabétique, en indiquant les lieux où ils ont participé à l’insurrection, et, éventuellement, leur condamnation. [J’indique en bleu ceux qui dans l’instruction sont désignés comme ayant appartenu au Club des Montagnards, et/ou ayant fait partie des quatre populaires compagnies montagnardes de la garde nationale, regroupées sous le nom de « compagnie des Tirailleurs » (présentes sur la Canebière puis engagées place aux Œufs).] [J’indique en rouge les inculpés n’ayant pas atteint la majorité de 21 ans] Sont classés en « première catégorie – principaux fauteurs de l’attentat ». 1 – Ménier Paul, négociant, 35 ans, chef de compagnie [Canebière, place aux Œufs] [15 ans de détention] 2 – Ricard Dominique, fabricant de malles, 30 ans, chef de compagnie [Canebière] [15 ans de détention] 3 – Perrin, Joseph Alexandre, aubergiste, 34 ans, chef de compagnie [Canebière, place aux Œufs] [10 ans de détention] 4 – Carbasse, Sébastien, officier de santé, 32 ans, accusé d’avoir tiré sur le général [Canebière, place aux Œufs] [déportation] 5 – Bellissen Joseph, tapissier, 32 ans, lieutenant de compagnie, accusé d’avoir ordonné le feu contre le général [Canebière, place aux Œufs] » Ces cinq accusés peuvent être considérés comme les principaux fauteurs de l’attentat, et l’on a vu, dans l’exposé des faits, la part décisive qu’ils y ont prise le 22 juin, principalement à la Canebière » (« Cour d’Assises », op.cit) Suivent 43 autres inculpés pour participation directe à l’attentat. – Albot, cordonnier 25 ans [place aux Œufs] – Aldebert, Jean Joseph, tailleur d’habits 42 ans, [Canebière] [4 ans de prison] – Arnaud Jean Jacques, fabricant de malles, 41 ans, [place aux Œufs] [10 ans de détention] – Arbid Joseph, lithographe et interprète, commissionnaire de maison de tolérance, 17 ans, [place aux Œufs] [trois ans de prison] – Aymon Antoine, voilier, 39 ans, [place aux Œufs] [5 ans de détention ou 4 ans de prison] – Aymon Basile, ouvrier menuisier, 43 ans, [place aux Œufs] [5 ans de détention ou 4 ans de prison] – Bailleux Julien, 25 ans, tourneur mécanicien chez Armand et Soudry à la Capelette, délégué des ouvriers de cette usine [Castellane] [1 an de prison] – Barelle Jean Antoine, élève en pharmacie, employé au chantier communal de la Plaine, 23 ans, [place aux Œufs] – Barrère Jean Baptiste, chaudronnier, 30 ans [place aux Œufs] [déportation] – Blanc Jean, plâtrier 24 ans [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Blanc Nicolas, maçon, 24 ans, [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Bonnaud Honoré, boulanger, 38 ans, [Canebière] [2 ans de prison] – Borciat, François, ouvrier menuisier, 19 ans, [place aux Œufs] – Boucheraux Michel, marchand de meubles [accusé de connivences avec les insurgés] – Bujersdorfer Georges Michel, tailleur de pierres, 37 ans, [place aux Œufs] [8 ans de détention] (Bavarois) – Casadidio Louis, domestique, 23 ans, [Canebière] (Sarde) – Couturat Louis Eugène, ouvrier cordonnier devenu commis en librairie, 35 ans [place aux Œufs] [1 an de prison] – Cros Jean, coiffeur, 34 ans, [place aux Œufs] [8 ans de détention] – Dalmas Étienne Jean Baptiste, ouvrier boulanger, 33 ans, [place aux Œufs] – Derossi Darius, menuisier, 28 ans, [place aux Œufs] – Dutto Pierre cordonnier, 40 ans [place aux Œufs] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Fauroux Joseph, fabricant de malles, [place aux Œufs] – Girard Vincent, tonnelier, 36 ans [place aux Œufs] [15 ans de détention] – Girard Alexandre, tailleur de pierres, 30 ans, [place aux Œufs] [1 an de prison] – Guigue Antoine Joseph, peintre sculpteur, 32 ans, [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Honoré Joseph dit Lerouge, dit Faissine, marchand de fagots, 50 ans, [place aux Œufs] [8 ans de détention] – Lautier Théodore, ancien militaire, serrurier mécanicien à l’usine Taylor, [chef de barricade à Castellane] [5 ans de détention] – Laugier Alexandre, commis négociant, 28 ans, [chef de barricade à Castellane] – Merle, Joseph Pierre, tailleur d’habits, 47 ans, [place aux Œufs] [10 ans de détention] – Moreau Rodolphe, serrurier et agent de remplacements militaires à Avignon, 37 ans, [Canebière] – Mellino Jean Baptiste, Sarde, [place aux Œufs] – Nada Pierre, scieur de long, 35 ans, [Canebière] – Paysan Jean Baptiste, marchand colporteur, 24 ans, [Canebière] – Prévost Louis Marie, ouvrier menuisier ébéniste, 30 ans, a entraîné des ouvriers du chantier du Prado [Castellane] – Rue Fortuné, menuisier et logeur, 33 ans, ouvrier chantier du Prado [Castellane] – Ronjeon François, portier au théâtre du Gymnase, 48 ans, [place aux Œufs] – Soulier François, , tailleur d’habits, 23 ans, [Canebière] – Trotebas Marius, aide forgeron à l’usine Taylor, 25 ans, accusé d’avoir tué un soldat [Castellane] [déportation] – Trotebas Séraphin, ouvrier serrurier, 29 ans, [Castellane] – Udron Jean Constantin, ouvrier forgeron, 25 ans, taylor [Castellane] – Vayri Jean, ouvrier cordonnier, 28 ans, [place aux Œufs] Il est facile de voir que dans cette première catégorie, la très grande majorité des inculpés, ont participé aux événements de la Canebière et de la place aux Œufs. À côté de quelques artisans et commençants, on trouve représenté tout le petit peuple de l’atelier traditionnel et du bâtiment. Il a combattu dans le vieux Marseille qu’il connaît et où il habite. Au contraire, les quelques inculpés pour participation aux barricades de la place Castellane sont très majoritairement des ouvriers de la nouvelle métallurgie du sud-est de la ville. Ceux qui furent lourdement condamnés restèrent fidèles à leurs convictions. Si un Carbasse qui devint délateur à Belle-Île, les autres demeurèrent fermes Montagnards. – Deuxième catégorie. Classons la en trois catégories, suivant les lieux de l’insurrection
1 – Rue Saint Ferréol : deux inculpés seulement. – Delon Marc, tailleur de pierres, 35 ans, chantier de la gare du ch de fer [rue St-Ferréol] [3 ans de prison] – Vandelli Jean ébéniste, 26 ans, [rue St.Ferréol] 2 – Canebière et proximité, place aux Œufs. – Allègre Alexandre, boulanger, 21 ans [place aux Œufs] – Aubert Théophile, ébéniste, 20 ans, [place aux Œufs] – Aubin dit le Maconais, fugitif, [place aux Œufs] – Barthélémy Félix, manœuvre, 30 ans, [place aux Œufs] – Bellemain Jacques, tailleur de pierres, 26 ans, [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Bertaud Joannis, garçon cafetier, 18 ans, [place aux Œufs] – Blanc Gustave, tanneur, 39 ans, [place aux Œufs] – Blanchet Pascal Étienne, marin, 42 ans, [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Bonhomme Joseph, marchand colporteur, 32 ans, [Canebière] – Bonnet Adolphe, boulanger, 19 ans, [place aux Œufs] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Boutonnet Auguste, ouvrier gantier, 20 ans, (en route vers sa famille à Philippeville) [Canebière] – Bussy Ferdinand, peintre en bâtiments, 22 ans, [place aux Œufs] – Chollet Jean Baptiste, cordonnier, 58 ans, [place aux Œufs] [3 ans de prison] – Chuit Alexis, peintre en bâtiment, 43 ans, [place aux Œufs] – Curnier Etienne, marchand colporteur, 28 ans, fugitif, [place aux Œufs] – Delaporte Auguste, ancien militaire, 31 ans [place aux Œufs] [8 ans de détention] – Emperaire Alphonse dit Martin, garçon coiffeur, [place aux Œufs] – Fabre Lazare, cultivateur au quartier Saint Loup, 52 ans, [place aux Œufs] [18 mois de prison] – Frégy Antoine, manœuvre, 19 ans, [place aux Œufs] – Funel Funel Dominique Antoine, scieur de long, 20 ans, chantier communal de la colline Bonaparte [condamnation correctionnelle, ss précision] – Gardenti Marius Pierre, maçon, 20 ans [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Girard François corroyeur 47 ans, [place aux Œufs] – Giraud Jean Pierre, chaudronnier, 27 ans, [place aux Œufs] [8 ans de détention] – Giraud Higonel ferblantier 22 ans, [place aux Œufs] – Gouje Louis tuilier 24 ans, [place aux Œufs] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Granger Louis, pêcheur, fugitif, [place aux Œufs] – Guigue Antoine, vendeur de comestibles, 68 ans, [Canebière] – Henri ouvrier en chaises, fugitif, [place aux Œufs] – Job Désiré, cuisinier marin, 20 ans [Cours] [six mois de prison] – Jouve Louis, cuisinier, 18 ans, [place aux Œufs] – Juge Louis, cordonnier 22 ans [place aux Œufs] – Lagraffe Henri, commis marchand, 20 ans, [Cours] – Latour Sylvestre, tailleur de pierres, 27 ans, [place aux Œufs] – Laudière Jean Léon, serrurier, 26 ans, [place aux Œufs] – Laurent Pierre, ouvrier mineur, 37 ans, [place aux Œufs] – Lavigne Antoine, ouvrier boulanger, 28 ans, [place aux Œufs] – Lécuirot Alphonse, peintre en bâtiment, 47 ans, [place aux Œufs] – Léon Eugène, ouvrier boulanger, 19 ans [place aux Œufs] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Lévy Lazare, marchand de sucreries, 44 ans, Parisien de passage [place aux Œufs] – Maillet Théophile, ouvrier peintre en décors, 22 ans, [place aux Œufs] – Marc, terrassier, 18 ans, [place aux Œufs] – Marmet Jean Baptiste, serrurier forgeron, 51 ans [Canebière] [1 an de prison] – Martignan Antoine, boulanger, 26 ans, [place aux Œufs] – Martin Henri, cartonnier, 27 ans, [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Martin Joseph dit Maridje, commissionnaire, 32 ans, [place aux Œufs] – Masson Alexandre, peintre en bâtiments, 18 ans [place aux Œufs] – Meille Jean Pierre, décrotteur, ancien garçon de café, 18 ans, [place aux Œufs] – Mérentié Marius, ouvrier cordonnier, 35 ans, [Place aux Œufs] – Miffret Joseph, journalier, 27 ans, [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Milani Pierre, journalier, 19 ans, [place aux Œufs] – Molinard Alexandre, ouvrier cordonnier, 28 ans, [place aux Œufs] – Noyer Joseph, jardinier, 21 ans, [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Ordant Michel, garçon de billard, 18 ans, [place aux Œufs] – Parat, Jacques Antoine, serrurier mécanicien, 23 ans, [place aux Œufs] – Péget Nicolas, ouvrier tailleur de pierres, 24 ans, [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Peille François dit casseur de pierres, saltimbanque, 22 ans, [place aux Œufs] – Pépiton Edouard, garçon de salle, 20 ans, [place aux Œufs] [5 ans de prison] – Petit, Jean Louis, forgeron, 56 ans, [place aux Œufs] – Philippeau Pierre, cordonnier, 22 ans, [place aux Œufs] – Pipet Célestin Julien, ouvrier peintre, 28 ans [place aux Œufs] [3 ans de prison] – Poisson Louis, tisserand et marchand colporteur, 31 ans, [place aux Œufs] [6 ans de détention] – Pomme Joseph, ancien postillon, 33 ans, [place aux Œufs] – Pradeau Jean Baptiste, menuisier, 17 ans, [place aux Œufs] – Ravel Joseph, journalier scieur de bois, 52 ans, [place aux Œufs] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Rochetin Laurent, tailleur de pierres, 23 ans, [3 ans de prison] [Castellane] – Rossi Charles François, boulanger, 30 ans, [place aux Œufs] [3 ans de prison] – Saintupayri Jean, tourneur, 26 ans, [place aux Œufs] – Sauvaire Antoine, ouvrier boulanger, 28 ans, [place aux Œufs] [5 ans de détention] – Schaffausen Joseph, journalier, 28 ans, [place aux Œufs] – Sébastien Joseph, terrassier, 24 ans, [place aux Œufs] – Sévin, Eugène, ouvrier ferblantier, 23 ans, [place aux Œufs] [1 an de prison] – Simian Romain, boulanger, 26 ans, [place aux Œufs] – Sorro Jacques Victor, ouvrier tanneur, 20 ans, [place aux Œufs] – Surreau Émile, sellier 20 ans, [place aux Œufs] – Teste Louis, ouvrier mineur, 17 ans, [place aux Œufs] – Tirel Claude, raffineur de sucre, 23 ans, [place aux Œufs] – Turcan François, mesureur public, 32 ans, [place aux Œufs] – Vivien François, journalier, 32 ans, [place aux Œufs] – Viton Hypolite portefaix 19 ans, [place aux Œufs] Comme je l’indiquais dans l’article « Barricades », ce sont très majoritairement des hommes jeunes, voire très jeunes (beaucoup ne sont pas majeurs), et clairement prolétaires salariés : représentants des métiers traditionnels de l’atelier (cordonniers, tailleurs, dont la tradition démocratique est bien attestée, ainsi que celle des ouvriers boulangers), menuisiers, chaudronniers, maçons et tailleurs de pierres si nombreux dans cette ville en plein essor, journaliers, manœuvres. Les métiers du port sont pratiquement absents.
3 – place Castellane : – Aeschlimann Auguste Guillaume, tourneur 27 ans, [Castellane] – Balajat Michel, charretier, entrepreneur travaux publics, 43 ans, [Castellane] [3 ans de prison] – Bayard Henri, peintre en tableaux, 46 ans, [Castellane] – Bellet Adolphe, ouvrier mécanicien Taylor [Castellane] – Berthet André ouvrier serrurier, 20 ans, [Castellane] – Bontemps Jean Guillaume, frappeur atelier taylor, 35 ans, [Castellane] [1 an de prison] – Cadenel Louis, formier tourneur en chaises, 22 ans. [Castellane] – Caron Jacques Louis, carrossier 31 ans, [Castellane] – Deleyderier Alphonse, tourneur sur métaux chez Taylor 22 ans, [Castellane] – Escalup Pierre, ouvrier forgeron, 21 ans, [Castellane] – Estermann François, ébéniste 42 ans, [Castellane] – Expily Jean, tailleur de pierres, [Castellane] – Girardet Nicolas, ouvrier mineur, 43 ans [Castellane] – Isoard Alexandre, ébéniste, 30 ans, [Castellane] – Lange Bruno, charretier, 25 ans, [Castellane] [8 ans de détention] – Laurent Pierre dit Champagne, forgeron, 39 ans, [Castellane] – Macario Jean Baptiste, menuisier modeleur, 35 ans, [Castellane] – Maury Eugène, ouvrier cordonnier, 27 ans, [Castellane] – Maury Léon, id 25 ans, [Castellane] – Mazet Dominique, journalier, 69 ans, [Castellane] – Monachon Léopold, ouvrier mécanicien, 22 ans, [Castellane] – Riffel dit le Suisse, ouvrier tourneur taylor, fugitif, [Castellane] – Ruffel Adrien id 18 ans, [Castellane] – Thibert Paul, tailleur de pierres, 24 ans, [Castellane] – Touchet Armand, ouvrier mécanicien, 28 ans, [Castellane] [condamnation correctionnelle, ss précision] – Verlin Jean, tailleur de limes 22 ans, [Castellane] [5 ans de prison] Les ouvriers de la métallurgie implantée au sud immédiat de la place, et ceux des chantiers communaux du Prado, au sud également, ont donc fourni le gros de la troupe. Le trauma de l’insurrection des 22 et 23 juin eut pour conséquence, dans un premier temps, la distance accrue entre les plus revendicatifs ou les plus politisés des ouvriers, et les démocrates socialistes « respectables », ennemis du désordre. Mais, à terme, il inscrivait la combativité ouvrière dans un radicalisme qui ne cessera de se manifester à Marseille, qui mûrira sous l’Empire et dont la force se manifestera avec évidence en 1869-1870. Nous aurons l’occasion d’y revenir. René Merle, janvier 2012 |