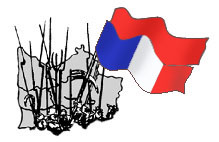Suzanne Jarreau
mise en ligne le 7 août 2025
Ces femmes qu’on envoie aux lointaines bastilles,
Peuple, ce sont tes sœurs, tes mères, tes filles !
Hugo : Les martyrs – Les châtiments juillet 1852.
L’insurrection de 1851 à Bonny/Loire
Suzanne JARREAU, citoyenne de Batilly (Loiret)
Une femme, son histoire
par Hugues CATTIN
Lorsqu’éclatèrent les événements de décembre 1851 à Bonny-sur-Loire (Loiret), Suzanne Jarreau, née Grémon[1], exploitait avec son mari Pierre Jarreau, à Batilly en Puisaye (Loiret), la ferme d’un magistrat de l’Avallonnais, Bethery de la Brosse[2]. Pour défendre la République qui venait d’être renversée par le futur Napoléon III, les époux Jarreau entrèrent en rébellion et leur engagement fut durement réprimé. Une justice aveugle et intolérante va reprocher à Suzanne Jarreau d’avoir pris une part active à l’insurrection de Bonny aux côtés de son époux. Arrêtée, elle est conduite dans la prison de Gien avant d’être incarcérée dans celle d’Orléans et enfin à Paris, à Saint Lazare, avec trois autres femmes du Loiret : Victorine JARDINEAU, une couturière de Bonny, Françoise Rosalie VIOLET, épicière, épouse de Louis Jardineau, aubergiste à Bonny, et Victoire SEAUJOT.
Dans la prison parisienne, elle fait connaissance de Madame Pauline ROLAND[3], institutrice, amie de George Sand, socialiste, féministe qui s’est impliquée très activement dans la résistance parisienne au coup d’État de 1851. Pauline Roland écrit dans une de ses lettres datée du 15 avril 1852 au sujet des détenues de Bonny : « Au moment où je venais de clore cette lettre, il nous est arrivé quatre nouvelles compagnes du Loiret : trois mères de famille, une jeune fille de 21 ans. Que de victimes ! Que Dieu ait enfin pitié… »
Le sort de Suzanne Jarreau ne laisse pas indifférents les citoyens épris de justice et de liberté. Victor Schœlcher, qui fit abolir le 27 avril 1848 l’esclavage dans les colonies françaises, écrit suite aux événements de 1851: « Parmi les femmes socialistes que les vainqueurs torturent, il faut encore citer Madame Jarreau. »[4]
Un autre historien du coup d’État de 1851, Pascal Duprat, fait l’éloge de Suzanne Jarreau, dans un ouvrage publié en 1852[5]. Il note : « Il serait difficile de trouver un plus beau caractère. Les coups qui la frappaient la trouvaient insensible, mais fière et indomptable. Sa noble sérénité semblait dominer les événements. Les haines et les violences qui grondaient autour d’elle, glissaient sur son âme sans y laisser la moindre trace. Elle reçoit la visite de son frère, au moment où elle apprend son sort. « On m’envoie à Cayenne, lui dit-elle, au milieu des soldats et des agents qui l’environnaient ; mais je compte bien revenir pour assister au triomphe de la République. »
Alors qu’elle se trouve à la prison Saint Lazare, rien n’entame les convictions de Suzanne Jarreau. Durant sa détention, elle les exprime dans une correspondance qu’elle adresse à un républicain de l’Yonne, qui vient d’être emprisonné au fort de Bicêtre :
Mon cher Monsieur,
Peut-être serez-vous surpris de recevoir une lettre d’une personne qui vous est à peine connue. Je n’hésite pas à vous écrire toutefois. Je pense qu’il y a entre nous assez de sympathies et de pensées communes, pour expliquer, pour excuser, s’il en était besoin, la liberté que je prends.
J’ai appris hier votre arrivée au fort de Bicêtre avec un convoi de détenus de l’Yonne ; mais on n’a pu me dire la peine à laquelle vous êtes condamné. Tout ce que j’ai su, c’est que vous êtes arrivé au nombre de 200. Veuillez me dire si vous savez quelle est votre destination.
Mon mari est parti pour Cayenne le 25 avril sur la frégate La Forte[6]. Je suis comme lui condamnée à la déportation à la Guyane Française et j’attends, non sans impatience, le moment de le rejoindre.
Nous sommes ici 24 femmes : presque toutes sont condamnées à la déportation ; quelques-unes ignorent leur sort.
Adieu Monsieur, quelles que soient les souffrances que l’on nous impose, nous les supporteront avec courage car nous saurons que nous les subissons parce que nous avons aimé et voulu, avant toute chose, la justice et la liberté.
Pauline Roland, toujours détenue à Saint Lazare avec Suzanne Jarreau, écrit dans une autre lettre datée cette fois du 13 mai 1852 : « …Nous sommes aujourd’hui 24, dix-sept doivent aller en Algérie, six sont retenues administrativement ainsi que Madame Jarreau. Nous sommes cinq qui nous sommes absolument refusées à rien demander : Augustine Péan, Claudine, Madame Huet, Madame Jarreau (prévue pour Cayenne) et moi-même. »
Contrairement à ce qui était envisagé, Suzanne JARREAU va échapper à la déportation en Guyane.
Graciée, elle peut revenir à Batilly où elle fait l’objet d’une constante surveillance qui, dit-elle, « …la retient prisonnière chez elle et devient une charge si lourde que la ruine de sa maison, seule ressource de sa famille, devient imminente… »[7] Tout en poursuivant l’exploitation du domaine avec ses enfants, elle demeure fidèle à ses convictions. Selon les autorités sa demeure devient « …le lieu de réunion des socialistes du pays et des individus mal famés des environs… ».
On ne cessera de la soupçonner de recevoir chez elle les démagogues de Bonny et de l’arrondissement de Gien ainsi que ceux du Département de l’Yonne…
Suzanne JARREAU, qui reste seule pour gérer une vaste exploitation (celle de Laborde près de Batilly), multiplie demandes et démarches pour obtenir le retour de son mari. Justice et administration préfectorale sont inflexibles car elles considèrent que chez Pierre Jarreau « il n’y a ni repentir, ni regret, ni soumission réelle. » Jarreau fait partie de ces hommes victimes de leurs convictions républicaines. Cependant, après plusieurs années, malade, il peut enfin revenir à Batilly où, chez les Jarreau, une vie de labeur reprend et où les certitudes demeurent. C’est le calme avant une tempête que personne ne voit venir. En 1858, les événements réduisent à néant une fragile sérénité, le bras répressif du régime bonapartiste est brandi et, de nouveau, frappe aveuglement et injustement les Jarreau qui tentent de se reconstruire.
À la suite de l’attentat du 14 janvier 1858 contre Napoléon III et l’impératrice sur le trajet les conduisant à l’Opéra, de nouvelles mesures répressives sont prises. Le 1er février 1858, le corps législatif décide que certaines personnes peuvent, par mesure de sureté générale, être internées dans un des départements de l’Empire ou en Algérie. C’est ainsi que d’anciens condamnés ou internés à la suite des événements de décembre 1851 vont être à nouveau les victimes d’une répression arbitraire et injuste.
En 1858, depuis son retour, Jarreau est malade et alité. Comme la Justice n’a que faire d’un grabataire et qu’il lui faut se repaître, fut-ce d’innocents, elle décide de lui substituer sa femme qui est en bonne santé. Quel nouveau crime pouvait-on lui reprocher ? Aucun ! Ceux qui la connaissent cherchent sans pouvoir en découvrir un seul.
A nouveau arrêtée en février 1858, Suzanne Jarreau est transportée en voiture cellulaire à Marseille. La justice peut se réjouir, cette fois elle n’échappe pas à la déportation en Algérie. Internée à Djidjelly on la retrouve employée chez un sieur Martin, comptable de l’armée.[8]
Durant cette nouvelle et terrible épreuve elle va montrer un grand courage et contribuer par ses actions et son exemple à relever le moral abattu de ses compagnons de malheur.
 Pauline ROLAND |
Pauline Roland [9] née à Falaise le 18 prairial an XIII (1805) décédée à Lyon, féministe socialiste reçu une instruction à l’insistance de sa mère. Initiée par un de ses professeurs aux idées du socialisme français, elle devient une adepte enthousiaste de sa philosophie. Suivant son arrivée à Paris en 1832, elle commence à écrire pour les premiers journaux féministes et compile une remarquable série d’histoires de France (1835), d’Angleterre (1838), d’Écosse et d’Irlande (1844).
Proche associée de George Sand et de Pierre Leroux, elle travaille comme institutrice et écrit pour l’Eclaireur. Elle vit pendant douze ans en union libre jusqu’en 1845 avec Jean-François Aicard, en insistant pour que leurs deux enfants, et un fils dont le père était Adolphe Guéroult, portent son nom et soient élevés par elle : « Je ne consentirai jamais à épouser aucun homme dans une société où je ne pourrais pas faire reconnaître mon égalité parfaite avec celui auquel je m’unirais… »
En 1848, elle prend la direction du Club républicain des femmes. Avec Jeanne Deroin et Gustave Lefrançais, elle fonde, en 1849, l’Association des instituteurs, institutrices et professeurs socialistes. Elle écrit dans les journaux de Proudhon le Peuple puis la Voix du Peuple.
En octobre 1849, les délégués de plus de 100 professions élisent Pauline Roland au comité central. Cette tentative de rétablissement du mouvement coopératif en 1848 est supprimée et Pauline Roland est au nombre des cinquante personnes arrêtées. Accusée de socialisme, féminisme et « débauche », elle est emprisonnée sept mois jusqu’à juillet 1851. Ceci ne l’empêche aucunement de s’impliquer très activement dans la résistance parisienne au coup d’État du 2 décembre 1851. Elle est à nouveau condamnée à dix ans de déportation en Algérie. Elle ne doit sa libération anticipée qu’à l’intervention de George Sand et de Pierre-Jean de Béranger.
Victor Hugo lui a consacré dans les Châtiments, un poème qui débute ainsi :
Elle ne connaissait ni l’orgueil ni la haine ;
Elle aimait ; elle était pauvre, simple et sereine…
[1] Née le 10 juillet 1814 à Arquian (Nièvre) elle avait épousé le 8 novembre 1831 à Batilly en Puisaye (Loiret) Pierre Jarreau né le 27 janvier 1808 à Cosne sur Loire (Nièvre)
[2] Théodore Jean Mélanie Bethery de la Brosse né et décédé à Avallon (1795-1889), président au tribunal civil d’Avallon – Yonne – certifie que les époux Jarreau sont locataires de son bien depuis six ans et qu’il a toujours eu à se louer de l’exactitude et du zèle de ses fermiers. (AN 30/470)
[3] Voir texte in fine.
[4] Histoire des crimes du 2 décembre 1851 par V. Schoelcher – Vol. 3 – page 404 édition de 1853.
[5] Pascal Duprat (1815-1885) – p. 172 – Les tables de proscription de Louis Bonaparte et de ses complices édité à Liège en 1852. 2 vol. in-8 -Bibliothèque Nationale 8-LB55-3040
[6] La frégate « La Forte » conduira de Brest à Cayenne 389 déportés : 366 forçats et 23 condamnés politiques.
[7] AN BB/30/470
[8] Les suspects de 1858 par E. Ténot édition 1869.
[9] Sources : Dictionnaire Le Maitron, mouvement ouvrier et social.