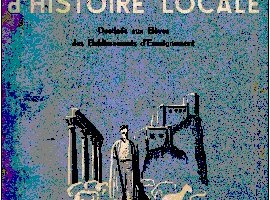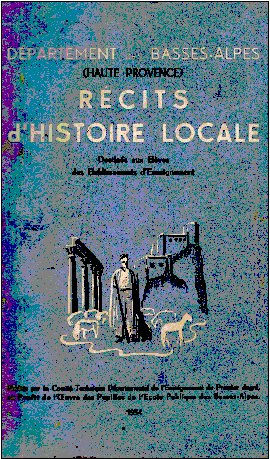Les insurgés bas-alpins de 1851
Quand “Education nationale” était encore synonyme d’ “Instruction publique”… texte transcrit par Bernard ROGER
1°) l’INTRODUCTION par M. M. E. NAEGELEN, ancien Ministre de l’Education Nationale, Député des Basses-Alpes. Les départements de France ont été découpés assez arbitrairement. Historiens, géographes, économistes ont maintes fois démontré que des « pays » assez différents l’un de l’autre avaient été réunis dans l’une de ces circonscriptions, que d’autres avaient été coupés en deux ou plusieurs morceaux par cette organisation révolutionnaire et centralisatrice du territoire national, que le chef-lieu de la nouvelle unité administrative avait été souvent mal choisi, sans respect des lois naturelles et des commodités des habitants. Et pourtant les départements vivent depuis un siècle et demi. Ils sont, si j’ose dire, passés dans les mœurs. Ils ont acquis vie et force. Et on ne peut, même légèrement, modifier leurs limites sans heurter des habitudes solidement ancrées’ et sans provoquer des résistances obstinées. Comme toutes les familles, les départements ont maintenant leurs traditions et sont curieux de leur histoire. Ils désirent connaître leur passé, leurs deuils et leurs titres de gloire. C’est pourquoi les Basses-Alpes se réjouiront d’avoir enfin le livre où sont consignés, sous une forme toujours simple, parfois pittoresque, très souvent émouvante, les événements les plus marquants qui ont agité, ensanglanté, fécondé, uni les divers territoires qui composent ce département. Certes, entre les régions ensoleillées de Forcalquier et de Manosque et les vallées ombreuses, enneigées durant des mois, de la montagne, entre les plateaux et les rives fertiles des grandes rivières, il y a des oppositions qui sautent aux yeux. Mais cela n’empêche pas les Basses-Alpes d’exister, d’exister fortement, indestructiblement. Le terme « Bas-Alpin » est passé dans le langage et est porté orgueilleusement par ceux-là mêmes qui se sont exilés du pays natal pour aller gagner leur vie à Marseille, à Nice, à Paris et jusque dans l’Algérie où ils sont nombreux et où ils ont pris une large part à la création de cette jeune province de France. J’ai lu avec un intérêt passionné les récits qui forment ce livre. Ils sont l’œuvre de professeurs, d’instituteurs qui aiment le département parce qu’ils y ont œuvré et s’y sont dévoués. L’érudition y est consciencieuse mais ne gâte à aucun moment le charme ou la beauté ou la grandeur de l’histoire. Dans beaucoup, sous l’apparent détachement du style, sous la sérénité qu’impose le souci de la vérité, on sent courir un frémissement. C’est que l’auteur a vibré en racontant les faits ardents et douloureux qui se sont déroulés dans des paysages qui lui sont familiers et dont les pères de ceux qui continuent à y vivre sont les héros. On me croira facilement si je dis que j’ai été bouleversé par deux de ces récits : celui où nous est conté, avec quelle précision de détail, la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851 et celui où nous est relaté ce que fut dans les Basses-Alpes la « Résistance » à l’occupant, de 1940 à 1944. Deux fois, à moins d’un siècle de distance, revient ainsi, pour désigner tant d’actions obscures et héroïques, le mot désormais sacré de « Résistance ». Résistance à l’oppression! Amour de la Liberté, de la République, de la Patrie, voilà ce qu’enferme ce mot que certains déjà essayent ou de galvauder ou de ternir. Oui les paysans les ouvriers, les employés, les enseignants des Basses-Alpes ont su, aux heures noires prouver leur amour de » la Liberté, de la République, de la Patrie et maintenir dans les ténèbres la flamme qui finit bien par allumer les incendies où sombrent les faux dieux de l’imposture et de la tyrannie. Ah! enfants des Basses-Alpes, apprenez à connaître les noms de Aillaud, de Volx, le Garde Général des Eaux et Forêts qui fut l’âme de la Résistance à celui que Victor Hugo a baptisé : « Napoléon le Petit » de Martin Bret qui fut chef de la Résistance à l’ennemi et à ses valets de 1940-44, celui du Martiniquais Gérard-Pierre Rose dont le sang mouilla la terre bas-alpine à la barre d’Aurent, ceux des martyrs du charnier de Signes. Qu’on les répète à la veillée avec celui du courageux évêque de Senez, avec celui du prieur de Ganagobie et de Revest-des-Brousses, Jacques Gaffarel, qui fut un célèbre orientaliste avec ceux plus doux des quatre sœurs de Saint-Maime qui devaient toutes quatre devenir reines. Ainsi, les Basses-Alpes honoreront tous ceux dont elles peuvent être fières : les morts pour la Liberté et pour la Patrie, les grands orateurs, car les Bas-Alpins aiment l’éloquence sincère et chaleureuse les penseurs et les savants, et les belles filles douces et bonnes qui sont devenues leurs mères, ou sont leurs sœurs ou leurs fiancées. M.-E. NAEGELEN. [Ce texte est révélateur des contradictions douloureuses de pas mal de militants socialistes d’alors en ce qui concerne la résistance à l’oppression : Naegelen exalte la Résistance républicaine, il sait de quoi il parle : grand résistant lui même, et épurateur judiciaire à la Libération. Mais il vient aussi, alors que ce texte est publié, de quitter son poste de gouverneur général de l’Algérie, où, tout en s’affirmant bien sûr partisan de l’Algérie française (il le sera encore pendant la guerre), il tente un dialogue avec l’opposition bientôt nationaliste, et il condamne fermement l’usage de la torture (déjà !) et la violence policière, ce qui lui vaut la haine de bien des Pieds Noirs. Note de René MERLE] 2°) Extraits de la PRÉFACE
MM. les Inspecteurs Primaires et moi-même avons souvent constaté l’ignorance de nos élèves en ce qui concerne certains faits capitaux d’histoire locale. Et cependant, les instructions officielles recommandent expressément aux maîtres et maîtresses d’enseigner l’histoire locale, laquelle apporte clarté, précision, intérêt, vie en un mot, à l’histoire nationale. En 1923, Monsieur le Ministre rappelait que l’Instituteur doit d’abord éveiller l’imagination des élèves et, ensuite, intéresser leur raison. Pour les plus jeunes, l’enseignement historique sera plus descriptif qu’explicatif, mais, on devra déjà illustrer l’histoire générale « par l’histoire locale ». Dans les instructions de 1945 et de 1947 sont renouvelées les mêmes recommandations. L’enseignement de l’histoire consiste essentiellement à observer, décrire, raconter, comparer, expliquer. L’histoire locale doit fournir, chaque fois qu’il se peut, un « point de départ » en vue de l’histoire nationale. Il faut « savoir en explorer et en exploiter toutes les richesses ». « Il est souhaitable, écrit M. le Ministre, que ces richesses soient l’objet d’une étude systématique et que ce qui est utilisable par les Instituteurs pour les besoins de leur enseignement, soit rapidement mis à leur portée ». Telles sont les instructions ministérielles. Comment y satisfaire et procéder à cette « étude systématique » des événements et des personnages locaux et les mettre à la portée de nos maîtres et de leurs élèves ? Où donc, pratiquement, trouver la matière de cet enseignement ? Il n’y a, en ce qui concerne notre département, aucun ouvrage approprié. Il existe certes, beaucoup d’études, d’articles, de travaux, mais disséminés dans les nombreux bulletins, revues, publications diverses. Ces articles, ces travaux ont souvent longs et détaillés et rédigés de façon trop savante. Parfois ils sont d’un accès difficile en raison de la rareté ou de l’ancienneté des organes qui les ont publiés. Ce qui est nécessaire, c’est un recueil de récits très simples, intéressants, présentés dans un style attrayant, récits que nos élèves auront plaisir à lire. Ce recueil, le Comité Technique Départemental l’a réalisé ici, grâce au dévouement et à la compétence de plusieurs membres de l’enseignement que je suis heureux de remercier et de féliciter (…). * **
Notre dernier récit est consacré à la Résistance bas-alpine. Et c’est à vous, nos camarades de combat, ou plutôt à votre glorieuse mémoire, que nous dédions les pages de ce modeste recueil ; vous dont les stèles jalonnent, si nombreuses hélas ! nos routes alpestres, vous les héroïques martyrs de la Résistance qui, pour la Patrie, avez accepté l’ultime sacrifice. Digne, le 10 mai 1950. L’Inspecteur d’Académie, Président du Comité Technique Départemental de l’Enseignement Primaire Gaston COIRAULT
3°) TABLE DES MATIÈRES (extrait)
Vingt-sixième récit : LES INSURGÉS BAS-ALPINS CONTRE LE COUP D’ETAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 …………………………………………………………………………………………… 147 Vingt-septième récit : APRÈS LE COUP D’ETAT DU 2 DÉCEMBRE 1851. UN MINISTRE BAS-ALPIN ENNEMI DE LA LIBERTÉ : HIPPOLYTE FORTOUL, qui mit l’Université « sous le joug » …………………………………………………………………………………………… 153
4° Vingt-sixième récit
LES INSURGÉS BAS-ALPINS CONTRE LE COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 Louis Napoléon Bonaparte, profitant de la gloire de son oncle, fut élu président de la République contre le général Cavaignac le 10 décembre 1848. D’après la Constitution, il était nommé pour quatre ans mais n’était pas rééligible. Il essaya, à plusieurs reprises, de faire réviser cette Constitution par l’Assemblée Législative. Mais cette dernière, en majorité royaliste, refusa. Voulant rester au pouvoir, il prépara un coup d’Etat. L’armée lui était toute dévouée. A plusieurs reprises, au cours de revues, des régiments avaient crié : « Vive l’Empereur ! » Il choisit la date du 2 décembre 1851, anniversaire du sacre de Napoléon 1er et de la victoire d’Austerlitz, pour faire son coup d’Etat. L’Assemblée fut dissoute. Les députés, voulant résister, furent emprisonnés. Le peuple de Paris, qui s’est souvent dressé au cours de l’histoire pour la liberté ne défendit que faiblement la République menacée. Les ouvriers ne voulaient pas se battre pour un gouvernement qui les avait écrasés dans les journées de juin 1848 et qui avait privé beaucoup d’entre eux du droit de vote. Cependant le 3 décembre, à l’appel de Victor Hugo, des ouvriers parisiens élevèrent des barricades pour résister aux soldats de Napoléon Bonaparte. Ils furent vite battus et Victor Hugo dut s’exiler. Mais, contrairement à ce qui s’était toujours passé, la province n’accepta pas ce coup d’Etat. Dans de nombreux départements, et surtout dans le Midi, les républicains essayèrent de sauver la République. LES RÉPERCUSSIONS DU COUP D’ÉTAT DANS LES BASSES-ALPES Notre département qui, jusqu’à cette date, est resté à l’écart des luttes politiques, se met au premier rang pour la défense des libertés. En considérant l’isolement de nombreuses communes, la difficulté des moyens de communication, on ne peut qu’admirer le magnifique soulèvement de la population bas-alpine. Ce soulèvement fut possible grâce à la parfaite organisation du parti républicain dans notre département. Un ancien maire de Manosque – Buisson – a tout préparé afin que les Bas-Alpins se lèvent en masse si la République était en danger. Dans chaque village, les républicains sont groupés. Ils ont un responsable qui reçoit les mots d’ordre. Mais, si la population est républicaine, le Préfet, le Procureur de la République, le Sous-Préfet de Forcalquier sont réactionnaires, c’est-à-dire hostiles à la République. Les forces militaires sur lesquelles ils peuvent compter sont peu nombreuses : un bataillon d’infanterie à Digne, une compagnie à Seyne, une à Entrevaux, une à Sisteron, des gendarmes et des douaniers. Mercredi 3 décembre. – Les dépêches annonçant le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte arrivent à Digne dans la soirée du 3 décembre. Le Préfet s’empresse de les publier et fait arrêter cinq républicains influents de la ville. La nouvelle est connue à Forcalquier le soir même. Dans la nuit, les chefs de la résistance de la ville se réunissent dans une maison de campagne. Le Sous-Préfet, renseigné par un agent secret, essaie de les faire arrêter, mais sa tentative échoue. Jeudi 4 décembre. – La nouvelle du coup d’Etat se propage rapidement dans le département. Les chefs républicains ont fixé le soulèvement général au 5 décembre. Les responsables des villages en informent la population. Dans le canton de Forcalquier, c’est à la foire de Mane, qui a lieu le jeudi, que les paysans sont avertis. Vendredi 5 décembre. – L’insurrection éclate dans le département, surtout dans le sud et l’ouest. Dans la nuit, le tocsin sonne dans presque toutes les communes. Il n’y a pas d’hésitations. La bourgeoisie prend une part active à la résistance : avocats, médecins, notaires, commerçants marchent en tête des paysans, le fusil sur l’épaule. Dans les arrondissements de Forcalquier, Digne, Sisteron, presque toutes les familles de paysans envoient un ou plusieurs de leurs membres pour prendre part à la lutte. Plus de 3 000 hommes se réunissent à Forcalquier pour se rendre à Digne. Sur la rive gauche de la Durance, des contingents de tous les villages des cantons de Valensole, des Mées, se réunissent, se dirigeant sur Malijai. A chaque embranchement de route, dans les villages traversés, de nouvelles bandes viennent grossir la colonne forte de 1 800 hommes. Une autre colonne, formée dans les cantons de Moustiers, Riez, Mézel, marche aussi vers Digne. A Château-Arnoux, un garde-général des Eaux et Forêts, Aillaud, originaire de Volx, révoqué pour ses opinions avancées, quitte le village à la tête de tous les hommes valides. Il désarme la gendarmerie de Volonne et se rend à Sisteron où les insurgés ont déjà pris les armes. Une bande venue des Hautes-Alpes y arrive en même temps. Le Sous-Préfet se réfugie à la Citadelle sous la protection de la garnison. Partout le rassemblement se fait dans un ordre parfait. Il n’y a aucun incident regrettable, si ce n’est à Forcalquier Le Sous-Préfet – qui a fait barricader la porte de la Sous-Préfecture – se met en uniforme au balcon pour recevoir les insurgés. Il doit se rendre. On le conduit à la prison. Quelques exaltés le blessent le menacent de mort. Les chefs républicains interviennent pour le protéger et lui permettre de gagner Avignon. Que se passe-t-il à Digne ce jour-là ? Les courriers n’arrivent pas, les routes de Marseille et Grenoble étant coupées par les insurgés. Des rumeurs fantaisistes circulent dans la ville privée de nouvelles. On connaît le soulèvement général des campagnes du département, mais on raconte que la Révolution a éclaté à Paris, Lyon, Marseille, et que tout le midi est en feu. Des rassemblements se forment pour demander la mise en liberté des républicains emprisonnés. Le Préfet et le Procureur de la République s’y opposent énergiquement. Samedi 6 décembre. – A Digne, les réclamations se font plus vives pour la libération des emprisonnés. Le Maire, Fruchier, insiste pour éviter des troubles. Le Préfet cède. Les républicains sont mis en liberté. La population manifeste une grande joie. Des émissaires, venant des campagnes, annoncent l’arrivée prochaine des insurgés qui se rassemblent à Malijai. La garnison de Digne part pour occuper ce village, point stratégique important. Mais, effrayée par le nombre des insurgés qui y sont déjà réunis, elle revient à la caserne, découragée. Le Préfet quitte la Préfecture dans la soirée. Il se rend au fort de Seyne, puis dans les Hautes-Alpes. Le Procureur de la République va se cacher chez un ami sûr. Un Dignois, Jaubert, qui était écolier à cette époque, raconte que son instituteur, M. Ogereau, presque un vieillard, donna congé à ses élèves pour rejoindre les insurgés. Il écrit : « Nous nous répandons dans les rues en criant : “Les insurgés arrivent” “et, armés de bâtons coupés aux arbres de la route, nous allons sur la route des Sièyes, espérant les rencontrer. Mais nous devons rentrer sans les avoir vus”. ARRIVEE DES INSURGES A DIGNE Dimanche 7 décembre. – A 3 heures du matin, toute la population dignoise se réveille au bruit des tambours et au chant de « La Marseillaise ». C’est la colonne venant de Riez, Moustiers, Mézel, qui arrive par la route de Nice, avec ses 1 500 hommes. Elle occupe la Mairie, la Préfecture, le Palais de Justice. Aucun désordre. La matinée est occupée à préparer le logement et des vivres pour les insurgés qui ont campé à Malijai pendant la nuit. C’est à dix heures du matin qu’ils arrivent. C’est un spectacle extraordinaire ! Les insurgés, précédés de tambours, marchent en ordre par groupes formés des contingents des communes et des cantons. Chaque groupe a son chef, portant le brassard rouge. La foule dignoise reçoit avec enthousiasme cette multitude bariolée. La plupart des paysans ont mis la traditionnelle blouse bleue avec la ceinture rouge. Quelques-uns ont le pantalon rouge avec une veste de soldat s’arrêtant à la taille, d’autres un veston noir avec aiguillettes et parements blancs pris dans les gendarmeries. Les armes sont encore plus variées que les costumes : vieux mousquets, à baïonnette rouillée, fusils de chasse à deux coups, fourches, faux… Malgré la fatigue de leur longue marche, tous ces paysans ont le visage épanoui. Ils accomplissent allègrement leur devoir. Ils ont pour la population des paroles rassurantes, caressent les gamins qui leur demandent à porter leur fusil puis ils reprennent en chœur le refrain de « La Marseillaise ». Les insurgés, qui ont amené avec eux les gendarmes fait prisonniers défilent en ordre et vont se ranger sur le Pré de foire, attendant patiemment qu’on leur indique un logement. C’est un problème compliqué pour loger 8 000 soldats ! Songez que Digne n’à guère plus de 5 000 habitants. Chaque famille en prend six à huit. On en met dans tous les édifices publics : Evêché, Grand Séminaire, Collège, salle d’asile sont réquisitionnés. Auberges et boulangeries sont constamment assiégées. Les fours chauffent sans arrêt. Beaucoup ne paient pas ce qu’ils achètent, disant : « Le Comité paiera ! ». Mais il n’y a ni pillage, ni désordre. Des postes en armes sont installés un peu partout, dans la ville. A tous moments, des hommes à cheval partent pour organiser et visiter les comités de résistance des cantons et des communes. LE COMITE CENTRAL DE RESISTANCE Les chefs de l’insurrection forment un Comité Central de Résistance qui s’installe à la Préfecture. Il se compose de Buisson (Manosque), Ch. Cotte (Digne), Escoffier (Forcalquier), Aillaud (Volx), Barneaud (Sisteron). Les quarante gendarmes concentrés à Digne sont désarmés. La garnison est consignée. Elle doit partager ses munitions avec les insurgés. Les différentes caisses Recette Générale, Indirectes, Enregistrement, Douanes), sont saisies et transportées à la Préfecture. LES COMITES COMMUNAUX Les Comités Communaux doivent désarmer toutes les gendarmeries, faire arrêter tous les individus accusés de crimes, vols ou pillages, les faire juger sans délai et punir de mort les coupables. Ils doivent lever les impôts, amasser des vivres et mobiliser tous les jeunes, gens valides qui n’ont pas encore pris les armes. Ils doivent aussi veiller à la subsistance des familles pauvres dont les soutiens sont partis pour défendre la République. Le Comité Central se charge de l’entretien de tous les insurgés et donne une solde aux plus pauvres. LA RESISTANCE A BARCELONNETTE Le Comité Central envoie l’ordre de soulèvement à Barcelonnette. Il y arrive dans la nuit du dimanche au lundi. Quelques républicains énergiques forment un Comité Cantonal qui, après avoir réuni 3 à 400 hommes, fait arrêter les autorités, les gendarmes et les douaniers. Un incident faillit se produire. 80 douaniers et 2 ou 300 paysans de la haute vallée, où n’avait pas pénétré l’esprit révolutionnaire, marchèrent sur Barcelonnette pour délivrer les autorités. Le curé de Barcelonnette alla au-devant d’eux et finit par les persuader qu’il était préférable qu’ils rentrent chez eux. Lundi 8 décembre. – Le lundi matin, la garde nationale est réorganisée. Le Comité de Résistance, sollicité par les paysans, signe un décret abolissant l’impôt sur les boissons, très impopulaire. Les insurgés saluent ce décret par des farandoles et en brûlant sur le Pré de foire les registres des contributions indirectes (Droits réunis). NOUVELLES ALARMANTES Des nouvelles alarmantes parviennent au Comité : Paris est pacifié, les grandes villes de France tranquilles et Marseille, que l’on croyait aux mains des républicains, ne s’est même pas insurgée. Le lundi soir, on apprend que le colonel Parson, parti de Marseille, marche sur Digne à la tête d’un régiment. Cette nouvelle est peu rassurante. Les membres du Comité comprennent que la République et la Liberté sont perdues. Faut-il continuer la Résistance ou ne pas engager la lutte et renvoyer les insurgés dans leurs foyers ? Le Comité décide qu’une colonne ira à la rencontre du régiment venant de Marseille.
A 7 heures du soir, 5 à 6 000 hommes partent, pleins d’enthousiasme, chantant « La Marseillaise ». Mais la marche de la nuit, par un froid glacial, est terrible. Les mauvaises nouvelles circulent dans les rangs. L’enthousiasme du départ s’éteint peu à peu. Beaucoup de paysans désertent pendant le trajet. Le mardi matin, plus de 1 000 hommes manquent. Mais il reste les plus résolus. COMBAT DES MEES Mardi 9 décembre. – Les chefs décident d’aller attendre aux Mées la troupe venant de Marseille. Ils occupent le village et s’installent sur les hauteurs dominant la ville. C’est Aillaud, de Volx, qui a dû diriger les opérations. Le colonel Parson arrive aux Mées le mardi matin. Les soldats y sont reçus à coups de fusil. Une compagnie s’engage dans un sentier qui conduit au-dessus des crêtes. Elle est surprise et dispersée par les insurgés qui font une vingtaine de prisonniers. Le colonel Parson, voyant que la position sera bien défendue, bat en retraite jusqu’à Vinon pour attendre du renfort. Les pertes sont minimes : quelques hommes morts et blessés de part et d’autre. FIN DE LA RESISTANCE Le colonel Parson a battu en retraite. Mais le commandant de la place de Marseille a envoyé deux autres troupes sur les Basses-Alpes : une par le Var, une autre par le Vaucluse. Le Préfet des Basses-Alpes, arrivé à Gap, a pu disposer d’un bataillon et va descendre sur Sisteron. Après le succès des Mées, les chefs de l’insurrection, connaissant la marche des troupes dirigées contre les Basses-Alpes, décident de cesser la lutte. Les insurgés se séparent pour regagner leurs foyers. Les membres du Comité restés à Digne quittent la ville après avoir renvoyé les hommes qui ne sont pas allés aux Mées. Seul Aillaud de Volx ne voulut pas poser les armes. Avec quelques centaines d’hommes, il traversa la Durance et se dirigea vers la montagne de Lure. LA REPRESSION Les troupes du colonel Parson sont rejointes le 11 à Vinon par celles qui viennent du Var. Elles marchent sur Digne et y arrivent le 13. Manosque et Sisteron sont occupées le 10. La troupe venant d’Avignon est à Forcalquier le 12. Le 15, c’est Barcelonnette qui est occupée par le bataillon conduit par le Préfet. La grande insurrection des Basses-Alpes est finie. Les Bas-Alpins qui se sont levés en masse pour la défense de la République et de la Liberté vont être frappés par une répression impitoyable. Un grand nombre d’insurgés sont arrêtés. A Forcalquier, les prisons et plusieurs autres locaux de la ville sont bondés de prisonniers pendant plusieurs mois. A Digne, tous les jours, des insurgés sont ramenés par les gendarmes et les soldats. La prison est pleine. Sur le boulevard Gassendi, une maison de trois étages, appelée « Caserne des Passagers », regorge de détenus. Les insurgés sont entassés dans des conditions d’hygiène intolérables, n’ayant pas de place pour allonger leur corps brisé de fatigue. Il leur est interdit d’ouvrir les fenêtres. Quelques hommes ayant passé outre à cette interdiction, la sentinelle tire sur eux, tuant un insurgé. La population menace d’écharper la sentinelle. La troupe intervient pour la dégager et disperser la foule exaspérée. Les prisonniers sont jugés par les conseils de guerre ou des commissions spéciales. Plus de 1 000 sont condamnés à la déportation. Ils sont dirigés sur Toulon où des navires les attendent pour les conduire à Lambessa (Algérie), et à Cayenne (Guyanne). Voici quelques condamnations prononcées par le Conseil de guerre de Lyon (28 août 1852) : Rouvier, né et domicilié à Champtercier, 2 ans d’emprisonnement, 100 francs d’amende, interdiction des droits civiques. Langomasino, domicilié à Digne, peine perpétuelle de la déportation. Julien Sauve, avocat à Digne, 1 an de prison, 100 francs d’amende, 2 ans de privation des droits civiques. Beaucoup d’insurgés échappent aux poursuites, mais ne peuvent rentrer chez eux. Ils sont traqués dans tout le département. Une circulaire considère comme complices ceux qui leur donnent asile ou leur viennent en aide. Une autre décide que les biens des insurgés qui ne se rendront pas dans les six jours seront mis sous séquestre, c’est-à-dire confisqués provisoirement. Une autre enfin prévoit que des soldats occuperont les maisons des fugitifs jusqu’à ce qu’ils se constituent prisonniers. Plusieurs villages sont presque dépeuplés. Dans le sud du département, les bras manquent pour la cueillette des olives. PLEBISCITE DU 20 DECEMBRE L’ordre est rétabli rapidement. La répression a brisé le magnifique élan républicain des insurgés. Le plébiscite du 20 décembre donne une majorité écrasante au Prince-Président. Sept cents citoyens à peine ont encore le courage de voter contre le coup d’Etat. DERNIER EPISODE DE LA RESISTANCE Quant à Aillaud, abandonné par ses derniers compagnons, traqué comme une bête fauve, il quitte la montagne de Lure en janvier, se procure un faux passeport pour gagner l’étranger. Mais il est arrêté à Marseille au moment où il allait s’embarquer. Traduit devant un conseil de guerre, il est condamné à la déportation et mourra à Cayenne. Il laissait une veuve et six enfants. BIBLIOGRAPHIE Eugène TÉNOT. – « La Province en décembre 1851 ».
5°) Vingt-septième récit
APRÈS LE COUP D’ÉTAT DU 2 DÉCEMBRE 1851 UN MINISTRE BAS-ALPIN ENNEMI DE LA LIBERTÉ : HIPPOLYTE FORTOUL, QUI MIT L’UNIVERSITE « SOUS LE JOUG »
1. – L’HOMME. – Le Coup d’Etat du 2 décembre donna à la France un nouveau ministre de l’Instruction Publique : Hippolyte Fortoul. Quel était donc l’homme choisi par Louis-Napoléon pour faire sentir à l’Université la poigne de son nouveau maître ? C’était un Bas-Alpin. Son grand-père avait été notaire à Barcelonnette ; son père, maire de Digne, puis secrétaire général de la Préfecture des Basses-Alpes. Lui-même avait commencé au Collège Royal de Digne les études qu’il devait poursuivre, non sans succès, à Lyon, puis à Paris. C’était un universitaire. En 1840, il avait été promu, avec une thèse sur Aristote, docteur ès lettres. L’année suivante, il obtenait la chaire de lettres à la Faculté de Toulouse et entrait ainsi dans cette Université qu’il devait un jour mener en laisse. En 1846, à peine âgé de 35 ans, il était désigné, avec le titre de doyen, pour organiser et diriger la Faculté des Lettres d’Aix, nouvellement créée. C’était aussi un homme politique. En 1849, les électeurs des Basses-Alpes l’avaient choisi comme député à la Constituante. En 1850, ils le renvoyaient siéger à la Législative. C’est à cette époque qu’il prit contact avec le Prince-président et, très habilement, s’en fit suffisamment remarquer pour être nommé, en 1851, Ministre de la Marine. A en croire, d’ailleurs, ses détracteurs, Fortoul aurait dû ce succès, moins à ses mérites, qu’à ses flatteries. A un déjeuner à l’Elysée, ne l’entendit-on pas répondre à Louis-Napoléon, qui projetait des voyages : « Monseigneur, que Votre Altesse n’aille pas en Bourgogne, si vous ne voulez pas être proclamé Empereur ». Quelques articles, abondamment élogieux, auraient fait le reste. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de jeter un coup d’œil sur les antécédents politiques du nouveau ministre : ils éclairent d’un jour étonnant sa personnalité et son œuvre. Fortoul l’autoritaire, Fortoul complice du coup d’état, était un républicain de longue date. Plusieurs des membres du Gouvernement Provisoire de 1848 étaient ses amis, parmi eux Carnot, le fils du grand Lazare, le conventionnel et « organisateur de la victoire ». Ses amis aussi : Béranger, G. Sand, Lamartine, Edgard Quinet, tous écrivains de tendance fortement démocratique. Et il ne s’agissait point là de relations de salons, plus ou moins éphémères, mais d’amitiés solides fondées sur une communion d’opinions; pour être admis dans l’Université, il fallait y être présenté et recommandé par deux de ses membres. Ce furent Carnot et Quinet qui introduisirent Fortoul. Ses écrits sont plus surprenants encore. Dans sa profession de foi aux électeurs des Basses-Alpes, il déclarait sans ambages : « … Ma préoccupation a toujours été de découvrir, sous les formes changeantes dont il est revêtu, le droit éternel de la démocratie ». Il répétait qu’il était « voué à la défense des idées démocratiques », il se flattait d’être « l’ami des républicains et le neveu de Manuel l’expulsé ». Il est difficile de croire que l’homme qui s’exprimait ainsi en 1849, est le même qui, moins de deux ans après, pourchassait la liberté et mettait l’Université « sous le joug ». Il faut dire à sa décharge, que l’histoire offre d’autres exemples d’opportunisme et que les Bas-Alpins, ses contemporains, ne se privèrent pas d’effectuer des revirements aussi complets. Le journal, intitulé sous Louis-Philippe : »Journal des Basses-Alpes », prenait brusquement en mars 1848 le nom de « Socialiste des Basses-Alpes ». Un an après, il reparaissait sous son titre primitif. En 1850, par une nouvelle mue, il devenait « L’Ami de l’Ordre », avec pour devise : « Guerre au Socialisme révolutionnaire » ! L’instabilité politique de Fortoul n’en fut pas moins copieusement raillée par la presse, lors de sa nomination au Ministère de la Marine, le 26 octobre 1851. Le « National » écrivait : « La diversité des opinions qu’il a tour à tour suivies et combattues prouve, sinon la flexibilité de son talent…, du moins la flexibilité de son épine dorsale ». D’autres journaux l’appelaient « l’Amiral Fortoul » ou le montraient « frappé d’admiration devant un bateau à voile lancé par un gamin sur le bassin des Tuileries ». Quelques jours plus tard c’était le 2 décembre : le général de Saint-Arnaud occupait dans la nuit la capitale, Louis-Napoléon lançait son appel au peuple. Le lendemain, la troupe tiraillait dans Paris, les députés républicains étaient emprisonnés, Baudin s’écroulait sur une barricade, V. Hugo, pourchassé, réussissait à s’enfuir. Fortoul, lui, s’installait au Ministère de l’Instruction Publique. Mais cette nouvelle promotion ne lui suscita aucune critique, ne lui valut aucune allusion désobligeante : la liberté de la presse était morte et les journaux hostiles muselés. II. – L’ŒUVRE. – La répression qui suivit le coup d’Etat s’exerça dans tous les domaines. L’Université ne pouvait espérer y échapper. Elle fut frappée et d’autant plus durement que d’elle dépendait « que les jeunes gens fissent confiance à l’Empereur ». On crut bon de préparer à l’oppression par l’oppression elle-même. « L’ancien professeur de Faculté haïssait-il l’Université ? C’est peu probable. Néanmoins, il a déployé tant de violence, tant de mépris pour les intérêts et la dignité des professeurs, qu’il personnifie à nos yeux le régime de persécution commencé trois ans avant lui » (3). Sous son autorité, l’oppression sévit avec une violence continue, un vent de tempête souffla sur l’Université. Discipline et brimades. – La discipline, bien que déjà peu libérale, connut une rigueur inaccoutumée. Dès le 4 décembre, une circulaire du Ministre signifiait aux Recteurs les « Actes » du 2 décembre : avertissement sans réplique. A l’Ecole Normale de la rue d’Ulm, pépinière de professeurs, dans le nouveau règlement, appliqué jusqu’aux virgules, le mot grave revenait sans cesse. Tout était grave : les études, le ton, les fautes. Certains proviseurs et principaux furent choisis, de préférence en dehors de l’Université, uniquement sur leur renom d’hommes « à poigne », capables de mater les récalcitrants. Un Recteur ne craignait pas d’ordonner aux Proviseurs de « punir sévèrement » les élèves qui ne chantaient pas aux offices. Les circulaires abondent. Celle du 12 mars 1852 précise « la discipline nouvelle » à appliquer désormais, celle du 20 mars traite « de la tenue du Corps Universitaire », celle du 2 novembre exige « la prompte obéissance aux ordres donnés ». D’autoritaire, la règlementation se faisait profondément humiliante. Rédigée avec une extrême minutie, elle en vint à dénier aux professeurs le droit de juger et de se conduire par eux-mêmes. Les horaires prescrits, stricts et uniformes, leur ôtaient toute initiative et tout plaisir d’agir. On raconte, d’ailleurs, que Fortoul, regardant sa montre, disait : « A cette heure, dans toute la France, on fait une version latine ». Si le mot n’est pas certain, il n’en symbolise pas moins un état de choses réel. Puis on obligea les membres de l’enseignement à se faire couper la barbe. Des Recteurs zélés firent aussi couper la moustache. Arborer un système pileux développé, c’était, dès lors, faire figure révolutionnaire. Enfin, peu à peu s’établit toute une paperasserie aussi absurde qu’inutile. Il fallut tenir des « journaux de classe détaillés, il fallut noter quotidiennement les élèves. Un jeune professeur d’alors, qui devait laisser dans la critique dramatique un nom célèbre, Sarcey, déféra à l’ordre avec humour. Il notait pour ses élèves des progrès : incessants, le lundi ; extraordinaires, le mardi ; inouïs, le mercredi ; incroyables, le jeudi ; stupéfiants, le vendredi ; renversants, le samedi. Ce qui lui valut, bien sûr, quelques désagréments. Surveillance et sanctions. – Une pénible atmosphère de suspicion entourait les membres de l’Université. Elle n’était pas nouvelle. La Seconde République, réactionnaire et méfiante, avait déjà pratiqué l’épuration préventive. Des jeunes gens que « l’examen moral » faisait considérer comme peu sûrs, s’étaient vu interdire l’Ecole Normale. Avec Fortoul, la défiance pénétra jusqu’au cœur de l’Université; et elle était telle qu’on refusait au professeur la confiance avant même de lui avoir permis de se faire connaître. La paperasserie imposée n’était pas seulement tracassière, elle rendait possible un contrôle permanent des établissements ; elle permettait de trouver à bon compte des prétextes à suspendre, à déplacer, à révoquer. Sarcey, entre autres, tenu pour suspect, échoua à l’agrégation, fut déplacé quatre ou cinq fois et finit par démissionner. Taine, grand nom de la philosophie, n’obtint pas davantage l’agrégation et son échec fit scandale ; envoyé à un rythme accéléré aux quatre coins de la France, à Chaumont, à Lesneven en Bretagne, à Rodez, à Grenoble, il n’eut d’autre ressource que de se retirer. Le nouveau régime avait eu soin de placer dans chaque collège, dans chaque institution (collège privé) un homme à sa dévotion, généralement l’aumônier, qui y faisait la pluie et le beau temps. Qu’un directeur de collège signalât une imprudence de cet important personnage, il risquait sa situation ; plus d’un se fit taper sur les doigts pour bien moins, pour avoir voulu discuter un point ardu de théologie. Le climat d’étroite surveillance policière pénétrait tous les établissements, environnait tous les professeurs, pesait sur les plus soumis et les plus prudents, n’en laissait aucun en repos. Ils faisaient leurs cours dans la crainte permanente d’une disgrâce. Ne vit-on pas des Principaux expulsés par les gendarmes, renvoyés avec ordre de quitter leur collège du jour au lendemain ? La dénonciation et la délation étaient officiellement encouragées, la moindre imprudence était immédiatement châtiée. Un professeur était déplacé s’il déplaisait à l’aumônier, déplacé s’il risquait une allusion au manque de liberté, déplacé s’il ne dénonçait pas les élèves rebelles à l’ordre officiel, déplacé s’il discutait, déplacé s’il lisait Voltaire… Le despotisme. – Où était donc cette liberté, dont Fortoul disait en 1849 « qu’elle était le fondement de l’activité individuelle » et qu’il voulait « unir à jamais à l’Egalité et à la Fraternité » ? On l’eût vainement cherchée dans l’Université. Elle était traquée dans les examens, dans les cours, dans la conduite, dans les écrits, dans les paroles. Les agrégations spéciales étaient redoutées du gouvernement pour avoir la réputation de développer et propager l’esprit critique, surtout celle de philosophie. Comme on ne pouvait empêcher les étudiants de s’y présenter et que le filtrage était difficile, on les supprima purement et simplement. C’était un moyen radical de prévenir la formation des « esprits forts ». On n’enseignait point ce que l’on voulait. Taine avait été déplacé pour avoir loué, paraît-il, Danton ; Sarcey, pour avoir lu Voltaire. A travers les hommes, on visait les idées. La cognée s’en prenait à la pensée elle-même, à la vérité. Il fallait oublier le passé républicain, les écrivains non orthodoxes. Les interdictions étaient nombreuses. Défense d’approuver Robespierre comme Danton. Défense de citer et de lire Diderot et ses « Salons », Rousseau et son « Contrat Social », Voltaire et ses « Contes ». Défense de lire les « Provinciales ». Défense de parler librement et de murmurer, défense de juger librement et de critiquer. Défense, bien entendu, d’exprimer et de soutenir ses propres opinions politiques: pour le plébiscite, ordre fut donné d’employer des bulletins de vote bien transparents, si bien que, pour les professeurs, le suffrage universel ne fut qu’une immense farce. C’était pourtant Fortoul qui avait dit aux électeurs bas-alpins : « Donnez-moi le mandat de représenter à côté de mes amis ce parti qui voit dans la République la réalisation des idées les plus hautes de l’esprit humain ». Il l’avait bien oublié. On s’en aperçut mieux encore lorsque, le 12 avril 1852, il signa la révocation de Michelet et d’Edgard Quinet. Michelet, poète et historien, occupait au Collège de France la chaire de morale et d’histoire; il était aussi chef de la section historique aux Archives Nationales. Les pages magnifiques où il avait chanté, avec passion, le peuple de France, ne réussirent point à faire oublier les passages jugés subversifs, ni cette « Histoire de la Révolution » qu’il était sur le point d’achever. Chassé du Collège de France, chassé des Archives, l’auteur du « Peuple » se retira, avec sérénité, aux environs de Paris. Quant à Edgard Quinet, pour mesurer le degré d’amertume qu’il ressentit à la nouvelle de sa disgrâce, il suffit de relire les lignes qu’il écrivit à Fortoul, alors candidat à la Constituante de 1848 : « Vous ne pouvez vous douter des vœux que je fais pour vous. Je crois avoir rendu un grand service à l’Université en vous aidant à en faire partie. Je suis certain que je servirais la République s’il m’était donné de contribuer à votre nomination à l’Assemblée ». Si Quinet était un excellent cœur, il faut convenir qu’il était un bien mauvais prophète. La prestation du serment, imposée .par la circulaire du 28 avril 1852, fut bien pour le Corps Enseignant la plus dure épreuve. « Ce fut la source de drame intimes chez les hommes, révoltés par l’obligation de promettre fidélité au Président parjure et effrayés par l’idée de briser leur carrière » (3). La plupart se résignèrent et abdiquèrent, sans grand plaisir, on s’en doute, leur indépendance. Fortoul n’aimait pas les demi-mesures et il leur refusa jusqu’au droit de manifester leurs sentiments. Sur la feuille des signatures du serment figurait une colonne « Observations ». Un Proviseur, ayant demandé au Sous-Préfet de quoi il s’agissait, s’entendit répondre : « Vous noterez ceux qui ont prêté serment d’un air content et ceux qui l’ont prêté avec un air rechigné ». Mais il faut croire que la rigueur de la mesure ne fit pas illusion sur la qualité du serment prêté, car en 1853, le Ministre réclamait encore les noms des fonctionnaires « sur lesquels l’Administration pouvait compter ». III. – L’UNIVERSITE A LA MORT DE FORTOUL. – Fortoul mourut en 1856, non sans regretter, dit-on, l’œuvre de compression brutale qui demeure attachée à son nom. L’Université, elle, bien que méprisée et affaiblie, subsistait. Ses membres continuaient à montrer leurs qualités habituelles, tant cette institution avait en elle de vitalité, tant le corps de ses professeurs était, par un vieil esprit de tradition, animé du zèle de l’enseignement, tant ils en avaient le talent à la fois et le goût. Bon nombre de collèges, d’ailleurs, sous l’impulsion d’habiles et énergiques directeurs, avaient survécu à la tempête. Quelques-uns; allant contre vents et marées, avaient prospéré. Ainsi, la vie et le progrès demeurèrent possibles, dans l’Université, même aux pires jours de l’empire autoritaire.
BIBLIOGRAPHIE 1. « Biographie des Hommes remarquables des Basses-Alpes », édition 1850, page 124. 2. Revue « La Révolution de 1848 », numéro de décembre 1930. (Article de Paul RAPHAEL). 3. G. WEILL. – « Histoire de l’Enseignement secondaire ».
|